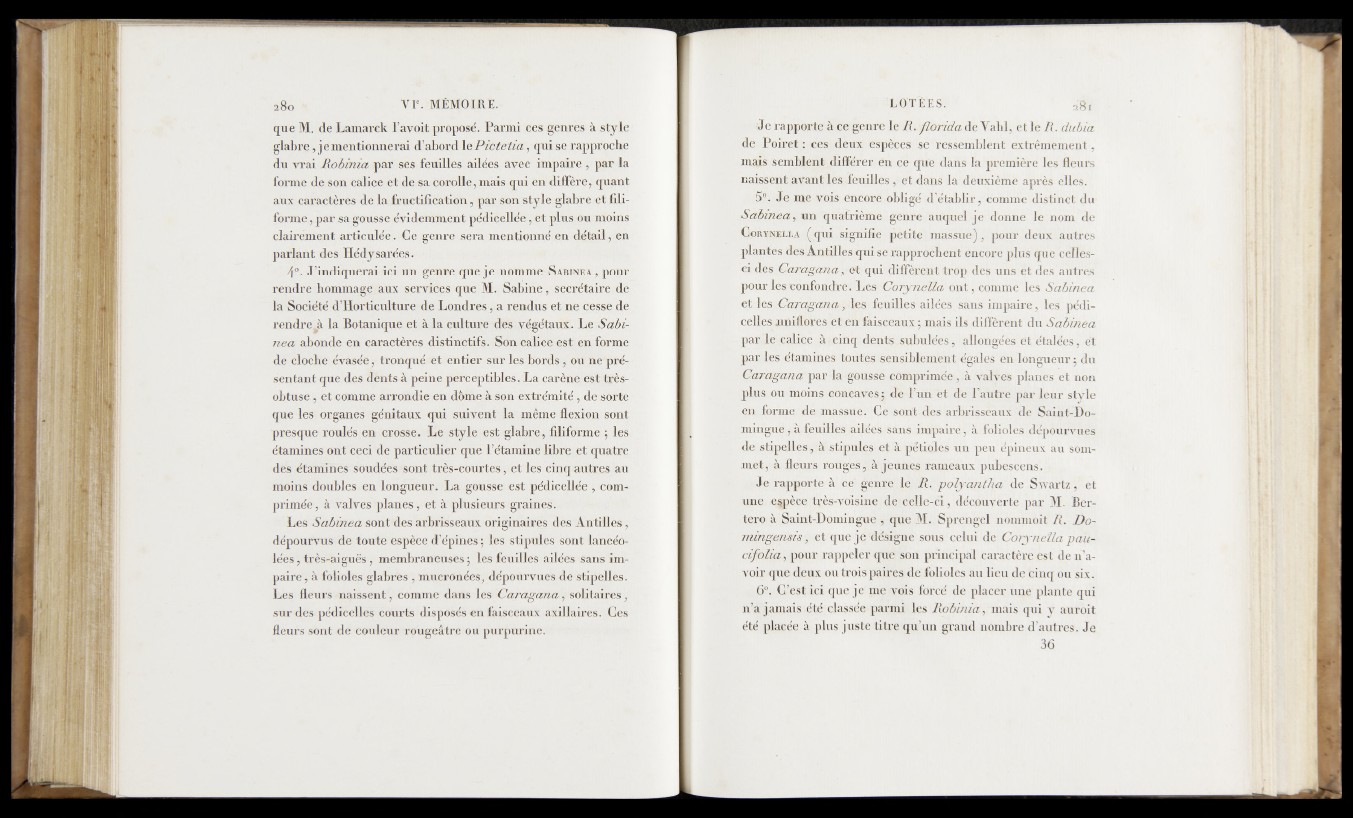
que M. de Lamarck l ’avoit proposé. Parmi ces genres à.style
glabre, je mentionnerai d’abord le P éctetia , qui se rapproche
d u vrai Robàzia par ses feuilles ailées âVeë impaire-, par la
forme de son calice et de sa;corolle, mais qui en*diffère, quant
aux caractères de la .fructification, par sou'style glabre et filiforme.,
par sagousse évidemînent pédàcellée, et plus Ou. moins
clairement articulée. Gegenre sera mentionné en détail ,;en
parlant des HédysaKépssv.'t
. 4°'* J’indiquerai ici un genre qûe je nomme^SABii-jf a , pour
rendre hommage aux services que M*. Sabine y'sec^étaire-fcfe'
la Société d’Horticulturerde Londres rendus
rendrejà la Botanique et à-la cidtnre'des végétaux. LeïçÇtié^?
nea abonde en caractères distintçtifs'.vSôn 'calieC'estff.p, forme
de cloche évasé룮rnnqwé$iit entier stÊrî-les bords, ou rie’pré-
sentant que des (lents à peine perfc eptiblesvLa carène; ejt t|^s-
obtuse -, et comme arrondie en dôme à^pmextrémité, de1 Sorte
que les organes génitaux qui suivent -1»>îmême,flexionsfjæfct
presque roulés en crosse. Le slÿle^^^/glâh'rè-, filiforme; les.
étamines ont ceci de particulier que l ’étammè’ libre et quatre
dès étairiïnès soudéesSsont très-courtes, et lés cinqaufregau
moins doubles en longueur. La gousse;-est pe'dicellée pjpbm--
primée , à salv es p la n a i et à plusieurs graines^ *r
Les Sàbinea. sont*Ûes arbrisseaux originaires d'ès'Anti'lles,
dépourvus de toute espèce d’épines ; les stipules sont lancéolées
, très-aiguës, membraneuses ; les feuilles atilèS’èâns impaire
; à folioles glabres , mucronées, dépourvues de stipelles.
Les fleurs-naissent, comme dans le^^^ûsg^êd^soiitaàxes,
sur des pédicelles courts disposés en faisceaux axillaires. Ces
fleurs sont de couleur rougeâtre ou purpurine.
de rapporte à ce genre le R^/loridc/, de Yahl, et le R. dubîa
de Poiret : cesi deux espèces se ressemblent extrêmement,
mqis semblent- différer'ën ce-que dans la première les fleurs
naissent avant-dès »feuilles, et dans ladëuxième après elles.
tkM0 Je me vois encore obligé -d’établir, comme distinct du
Scbfyinea, un quatrième genre auquel je donne le nom de
(^qui signifie petite massue) pour deux autres
plantes des Antilles qui sé rapprochent encore plus que eeïles-
, ■ et- qui diffèrent trop des. uns et des autres
pour les confondrë.'Les’ 'O'ofynéÉka ont, comme les Sàbinea
î^tilesh^f^ ^ ^ ^ , -les feuilles ailées sans impaire, les pédi-
cellesjnniflores-et ehffàisceaux ; mais ils diffèrent du Sabbiea
par ile calice à^cinq dents subulées, allongées et étalées, et
par les étamines toutes sensiblement égales en longueur ; du
%mèêganaparia-gousse comprimée ,>à valies planes et non
plfTs-eu moins concaves; de l ’un et de l ’autre par leur style
en forme d*.massue. Ce sont des arbjâ^sëàux île Saint-Do-
îmingoeî-, à feuilles ailéeis sans impaire, à folioles dépourvues
;idfel stipelles ^à-stipules%et'à pétioles un peu épineux au sommet,
à fleurs rouges , ;à jeunes rameaux pùbeseens. |
Je rapporte à eei genre le R . pofyantha de Swartz, et
une espèce très-voisine de?celle-ci, découverte par M. Ber-
tero à Saint-Domingue , que M. Sprengel nommoit R. Do-
mingeTtsis ÿ que je désigne sous celui de Corynetla pau-
c ifo lia , pour rappeler que son principal caractère est de n ’avoir
que deux ou trois paires de folioles au lieu de cinq ou six.
6°. C’est ici que je pie vois forcé de placer une plante qui
n’a jamais , été classée parmi les Robinia, mais qui y auroit
été placée à plus juste titre qu’un grand nombre d’autres. Je
36