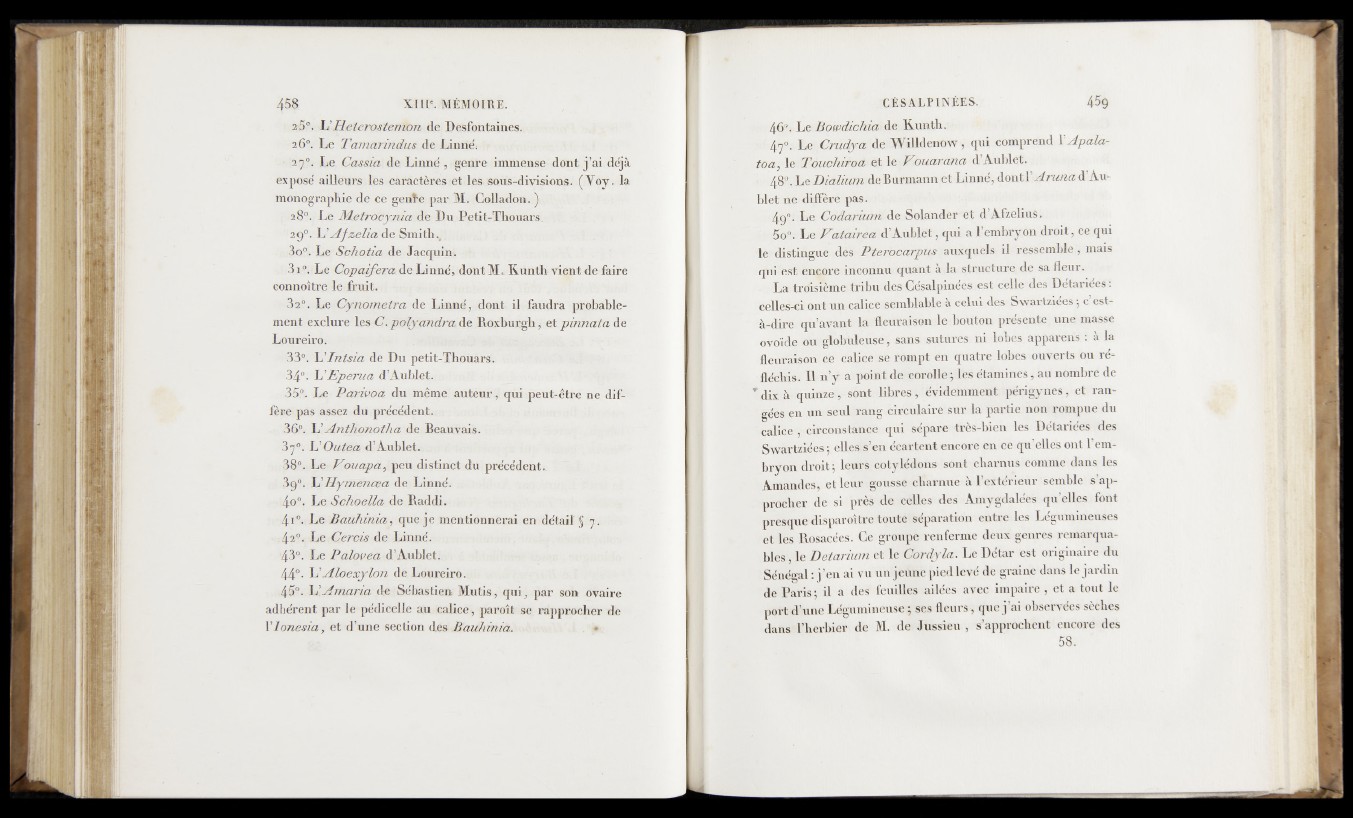
3s5°. hTIeterosterrgon de Dèsfontaines..
26“. Le Tamar indus, de Linné; <
• 25,?;: Le Cassia de L in n é , genre immense dont j ’ai.déjà
exposé ailleurs ifes caractères set les. sous-divisions.(s^oy. la
monographie de ce gente pat: M. GoUadon,
, 28®.; Le M,etrocyj%iaA^ Du -Peti l-Thouars.
‘*29-°. L ' A fz e lia de Smithy . ;
/: 3o> H^e Schotia de Jacquim Ü
J;3i°.fLe Copaifera.de Linné, dont M.Kiinth-vient de faire
eonnoître le fruit.
3a?. lie Cynomctra de Linné, dont, il faudra probablement
exclure les C,<p&iyandra, de Roxburgh, aCpinhata de
Loureiro.
33°. L T htsia dé Du petit-Thoùàrslî
34°. luE perua d’Aublet. jj
35.“. Le Parivoa du même auteur, qui peut-être ne diP-’
fère pas assez du précédent., !
36°. \TAntIionotha de Beauvais.
37°. \jO u tea d’Aublet..
38°. Le Eouapa, peu distinct du précédente
,;i ,3§°- Hymëtioea de Linné.
-,;4o°. Le Sch&eïla de Raddi.
4 i°. Le Ba uhin ia , que je mentionnerai en détail § 7.
. ;4&9' Le Qçrois de Linné. :
43°. Le Pàlovea d’Aublet;
44°. \ÀAloexylon dé. Loureiro..
45°. \*.Amaria de Sébastien Mutis, qui, par son ovaire
adhérent par le pédicelle au calice, paroît se rapprocher de
l ’lo n e sia , et d’une section djes JÿaiMméài -^
46° i Le BomâioMa àe Kunth.
4^?. Le ;Cmdya;àe' Wilddenow, qui comprend YApala-
iQaYX^M chü&Âi et le Eouam na d’Aublet.
48fe.îLe D ialium de B urmann e t Linné, dontl 'A n tn a d’Aublet
ne diffère pas.
4gQ î L e Codariurrv de Solànder’ et d’Afzeliuà.
* >- ÇjQp-i-Yl&tTgsftzzreâ!'d’Aublet, qui a l ’embryon droit, Ce qui
M distingue dé§* Pterocarpuf auxquels: il ressemble , mais
qui'esfrèncore inconnu quant à la structure de sa fleur.
La trdisieme tribu des Cdsalpinéès est celle des Detariees
celles-câ^rït un calice semblable*^ celui des Swartziees-, c’est-
à-dire qu’avant la fleüraison le bouton présente une masse
ovoïde ou globuleuse, sans sutures ni lobes appareils : à la
fleüraison éS" calice^se rompt en quatre lobes ouverts ou réfléchis.
Il n’ÿ a point de corolle ; les étamines, au nombre de
'd ix àtiquinze, sont libres, évidemment périgynes, et rangées
en un seul rang circulaire sur la partie non rompue du
'fcalice ,~ circonstance qui séparerfêès-bien les Détariées des
Swârtziées ; elles s’en écartent encore en ce quelles ont l’embryon
droit ; leurs cotylédons sont charnus comme dans les
Amandes, et leur gousse charnue à l ’extérieur semble s’approcher
de si prèà de celles des Amygdalées qu e lle s ■ font
presque disparoître toute séparation entre les Légumineuses
et les Rosacées. Ce groupe renferme deux, genres remarquables,
le Detarium et le Cordyla. Le Détar est originaire du
Sénégal : j ’en ai vu un jeime pied levé de graine dans le jardin
de Paris ; il a d e f feuilles ailées avec impaire , et a tout le
port d’une Légumineuse ; ses fleurs^ que j ’ai observées sèches
dans l ’herbier de M. de Jussieu , s’approchent encore des
58.