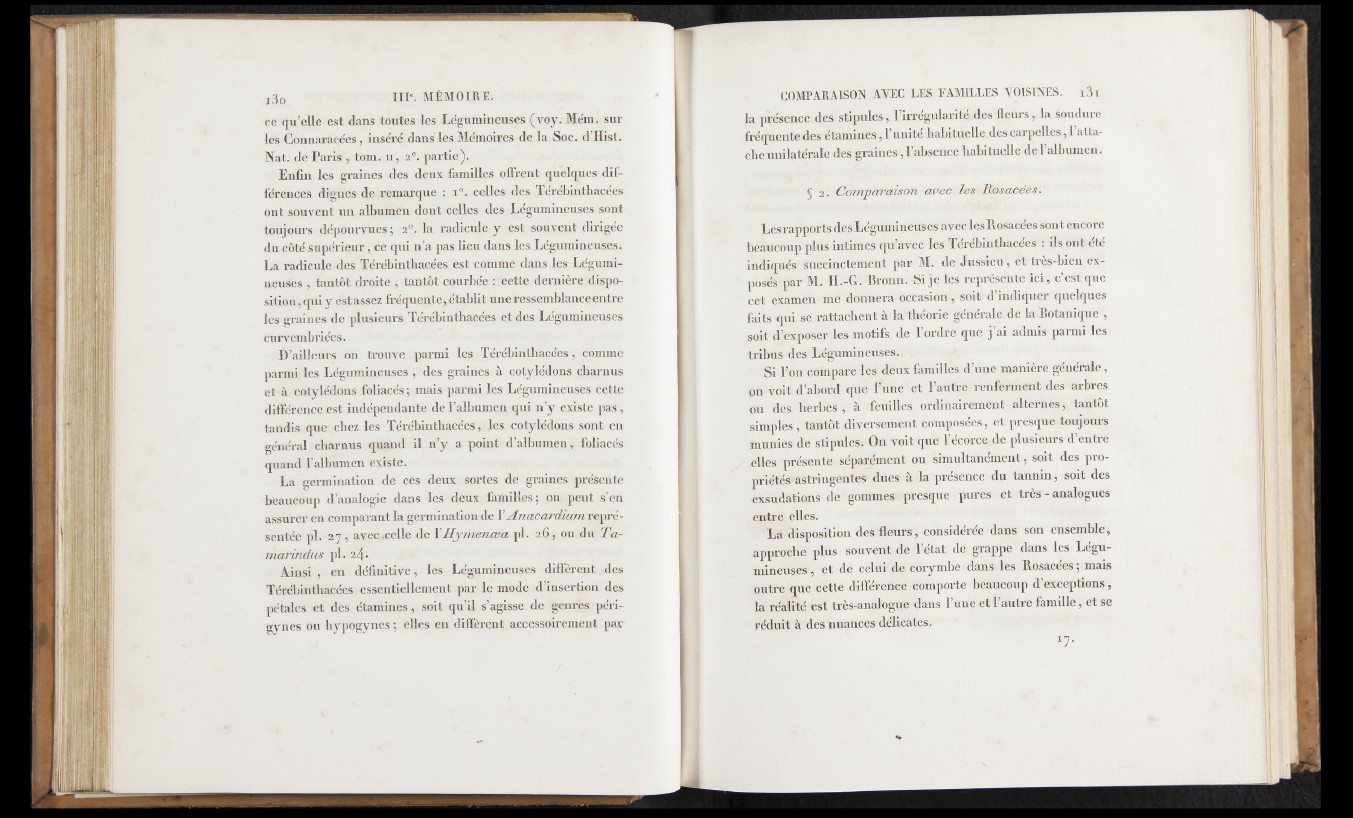
te qu’elle est dans toutes les Légumineuses (Hçqy.- Menu su*
les Ctannarâcdes, inséré dans les Mémoires de la Soc. d’Hist.
Nat. de Pafd^¥uBX4|'P-ÿ'a?- parti^f^*.
v ;Enfin les graines des deux familles offrent quelques différences
dignes» deîremarque : Jjptk- sci^ td siFSâcdH i^k a^ !^ .
ont Souvent un albumen dont celles de» Légumineuses -sont
toujours dépourvues 5 fâC la radicule y ^ S t souvient diligée-
du'.t^té£upérieu£;, ,ëë q u i n ’a pas lieu dans les.Légurnineuses.
La radicule-d^ ïérébinthacées.est .cumulé dans les Légumineuses
, tantôt droite , tantôt courbée HÉÉÉj dernière disposition,
qui y estassez fréquente,établit une Èessemblaneeentre
lesngraiùe^de plusieurs Térébinthaèées Légumineuses
eurvembriées.
D ’ailleurs on trouve parmi le^Ægl^InîJïaeées, comme
pa>B$piles, légumineuses ya;dès graine^ à cnjydédmais çbarnus
et 4- eotylédonSfMiacés^mais parmiyîes Légumineuses 'I4tte
différence est indépendante de l ’albumen qui ^pexi-ste pas ,
tandis, que ^chez les Térébintfeceef^le? cotylédons sont .en
génétôl5ebyârnus q«pnd ilaary-.a point4 d’albumen^tôliacés
quand l ’albumen existe.
La germination de ces deux .sortes de' graxne& ïpfcésente
beaucoup d’analogie dans les. deux*datôilles q om peut s’en
assmler «a^Oïnparant là germination de YA na ca r&m t i^pré -
«entée pl. 2 7 , avec .celle de 1 ’ . $<§* ou du Taiïktâwfëéus
pL/^|i-ï:..
Mnsi , en déânitive , les Légumineuses diffèrent,des
Térébinthaêées essentiellement par le mode d ’insertion des
pétales4 et des étamines, soit qu’il s’agisse de meures péri-
■ gynes on bypôgynes *, eûtes- eudiffèrent accessoirement par
CO'MPàM^N 8É|EC LES>*‘FMOLLES VOïS-INES. 1B1
la présencedes:stipules,, rirrégularité^des.deurs, la àoudure
fréquente des éMmid'es, l ’unité babifcuellqdes.carpelles, l ’attache
unilatérale des graines, Mabsenee habituelle de l ’albumen.
$1 '«^ÿaÿports d'esIlîég-uMneüses âvèc lésïtôsacées-son t encoie
bëàuètôtjéplus intimes (jîr’avèÉ: les^Lèrebinthàcee§-*$ ils ont etc
^i^iqdés SUccinctetôetlt pkr M. dé Jussieu, et*très-bien exj
poS#'pàr ?Bronn. i§lqé l|;s^rèprëSéiite 'ici", c’est'que
c'ét' éfa'meïi'' ^ ^ â^n èrâ^ fe^sa îoft^ ^^d’mdiquer quelques
faits qui-se ràttahhènt'-àda^tbéôriét g'è^ alè .de la .Botanique ,
soit 4^pWsérles motifs de l ’ordre que j ’âi admise parmi les
tribus des^Légumincusës,« |
4 Si l ’on compare les deux1 familles d ’üne manière généMe,
on voit d’abOrd^què- Puîudët l ’autre^' renferment dès-marbres
où dM herbes , a'.‘feuilles ordinairement alternes, tantôt
simples , tantôt diversement composées, et presque toujours
munies de stipule». On voit qué' l ’écorce^e plusieurs d’entre
elles.présent&*séparément ©u simultanément, soit des pro*
priété9*àstringéntefl dues à laèpfésence du tannin, soit des
exsudations de1 gommes*-presque pures e t très - analogues
entrer elles.
La disposition deS'ffëUts, considérée dans son ensemble,
approche plus souvent deCétat de grappe dans les Légumineuses
^ et de celui de èorymbe dans les Rosacéesq mais
outre que cette différence--Comporte beaucoup d’exceptions,
la réédité -est très-anatôgWe?dans l ’une et l ’autre famille, et se
réduit à des nuances délicates; ^
Ifr