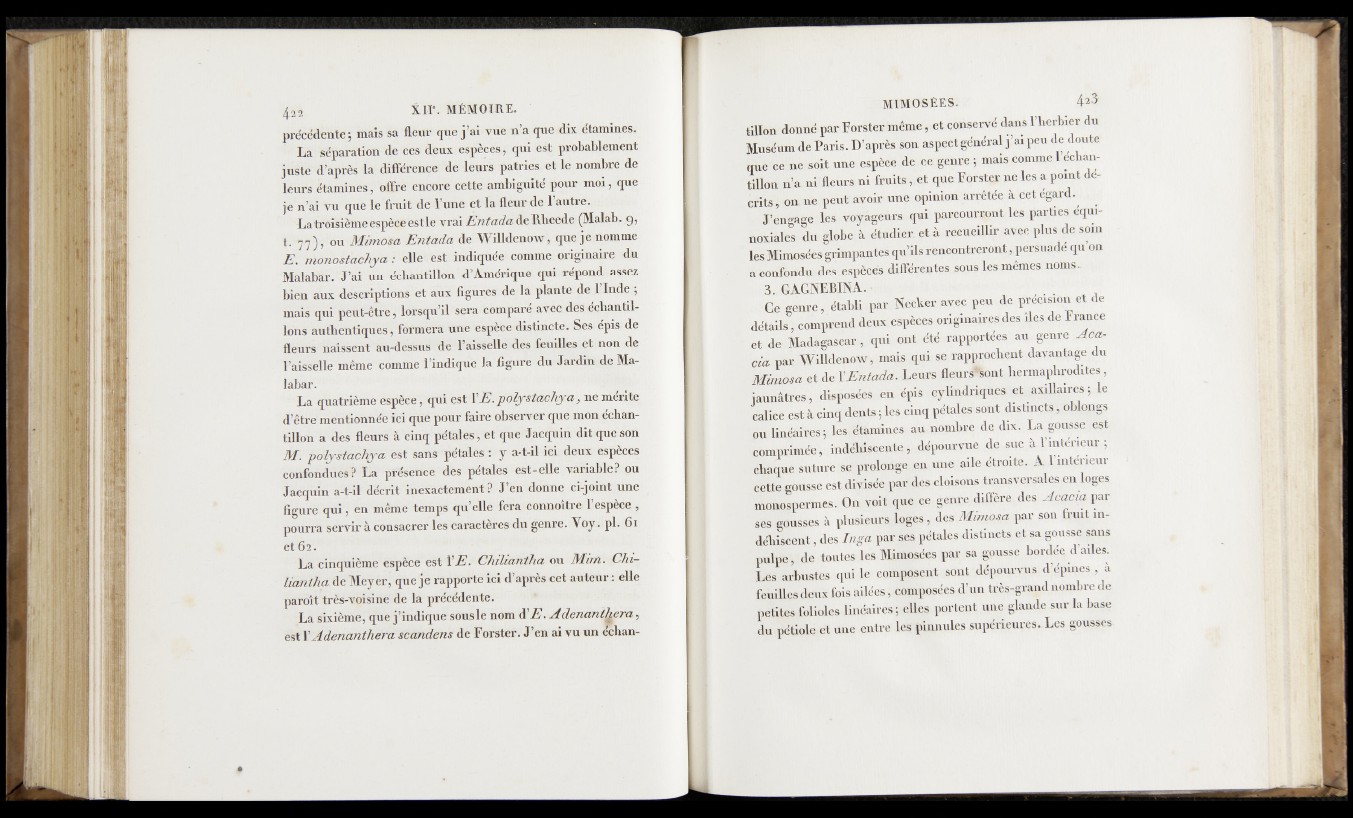
précédente ; mais sa leu r que j ’ai vue n’a que dix étamines.
La séparation dè ces deux espèces, qui est probablement
juste d’après la différence de leurs patries et le nombre de
leurs étamines, offre encore cette ambiguité pour moi, que
je n’ai vu que le fruit de l ’une et la fleur ded autre.,
La troisième espèfip est lè vrai Èntada de Bheede (Malab.
t. 77) , ou Mimosa E ntad a dèWillden aw, que je nomme
E . monostachya : elle . est indiquée comme originaire du
Malabar. J’ai un échantillon d’Amérique qui répond assez
bien aux descriptions'et aux figures de la plante de l ’Inde ;
mais qui peut-être, lorsqu’il sera comparé aVec des échantillons
authentiques, formera une espèce distincte. Sesyepis de
fleurs naissent au-dessus de l ’aisselle des feuilles, et non de
l ’aisselle même comme l ’indiqué la figure du Jardin de Malabar.
La quatrième espèce, qui est V E . polystacfaya| ne mente
d’être mentionnée ici que pour faire observer que mon échantillon
a des fleurs à cinq pétales, et que Jacquin ditqueson
M . polystachya est sans pétales : y a-t-il ici; deux espèces
confondues? La présence des pétales est-elle variable &f>u
Jacquin a-t-il décrit inexactement ? J’en donne cirjoint une
figure q u i, en même temps qu’elle fera connoitre 1 espèce.,
pourra servir à consacrer les caractères du genre. Vqy, pl. 61
e t62. ” -■v * ■ "v“ ; ' '"f.
La cinquième espèce est V E . Qhiliatif-ha ou Mirfi* £hi*-
liantha. de Meyer, que je rapporte ici d’après cet auteur : elle
paroît très-voisine de là précédente.
La sixième, que j ’indique sous le nom d E . A denanthera,
est l ’Adenanthera scandens de Forster. J’en ai vu un echantiUon
donné par Forster toême, et conservé dans l ’herbier du
Muséum de Paris . D’après son aspect généralj’ai peu de doute
que ce ne soit une- espèce-de ce. genre ; mais comme 1 échantillon
n’a ni fleurs ni fruits ,,et que Forstgpne les a point décrits
, on ne peut avoir une opinion arrêtée à cet égard.
J’engage les Vnyâgeèrs - qui parcourront les parties équinoxiales
du globe: à'étudier. et à recueillir av^c plus de sprn
lesMimosées grimpantes qu’ils rencontreront ^persuadé qu on
a confondu d é s ^ c e s différentes sous les mêmes noms.
;.,3..GAGNEBINA.*
B genre, établi par a^écpeu de précision et de * 8MB compr end deux espèces originaires dos des de France
M B Madagascar, qui ont été ^apportées au genre A ca -
L § par Willdenow , s mais qui,se vapmochent davantage du
M ùm sa et de 1E n ta d a . Leurs É ^ r â b n t hermaphrodites,
jaunâtres, déposées: en épis cylindriques et. axiffaires ; le
calice est àrcihqjdents ;les cinq pétalf^on* distincts, oblongs
ou linéaires les. étâmines^au nombre de dix. La gousse est
Comprimée, indéhiscente, dépourvue de suc à l ’intérieur ;
chaque suture.se prolonge en une aile étroite. A l ’mterieur
cette gousse est divisée par des cloisons transversales^n loges
monospermes. On voit que ce-genre:diffère des A ca cia par
ses gousses à plusieurs-loges, des Mimosa par son fruit indéhiscent
, des Ingu par ses pétales distincts et sa gousse sans
pulpe , de toutes les Mimosées par sa gousse bordee d ailes.
Lès arbustes qui le composent sont dépourvus d’épiqes , à
feuilles deux fois ailées ^composées d’un très-grapd nombre de
petites folioles linéaires ; elles, portent une glande sur la base
du pétiole et une entre? les pinnules supérieures-Les gousses