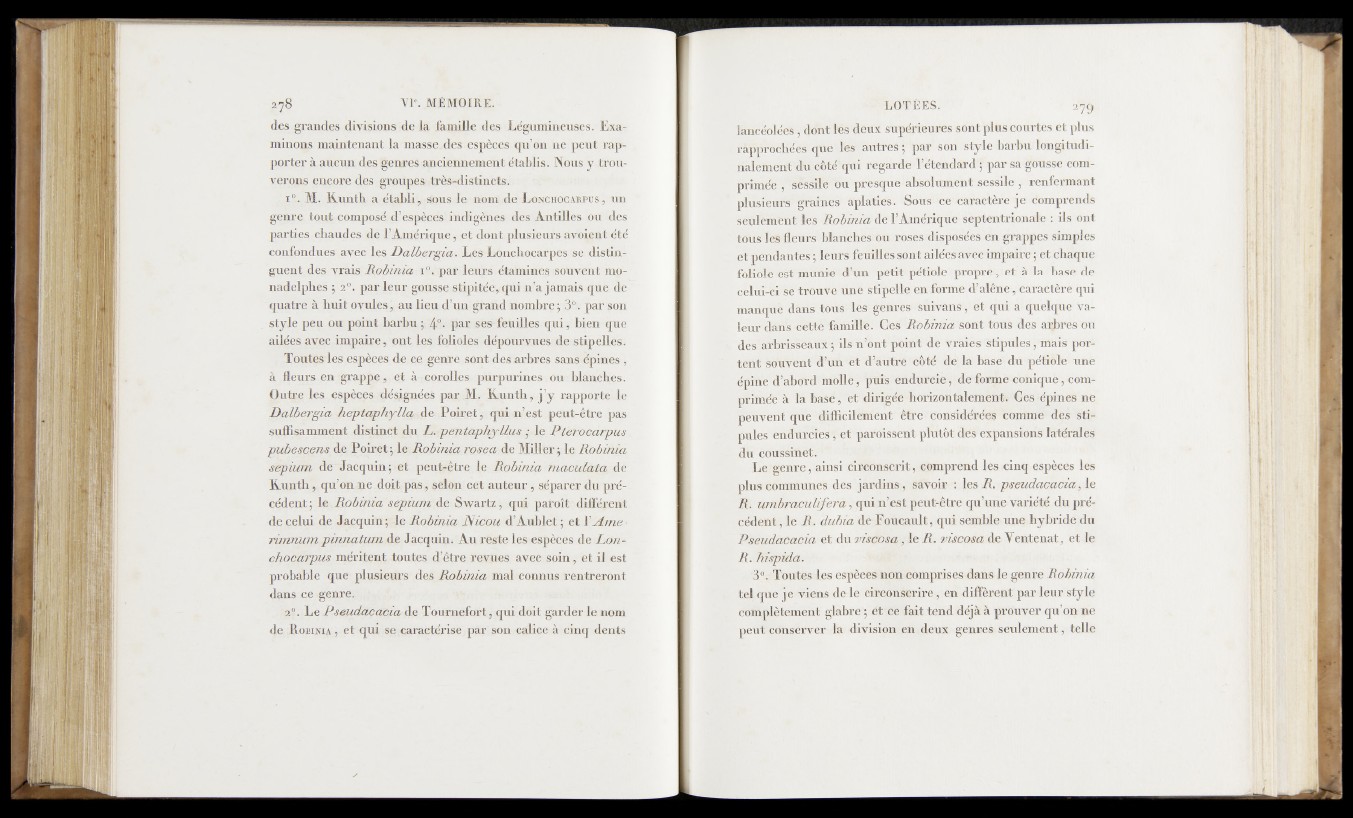
des grandes divisions :de la famille des Légumineuses. Examinons
maintenant la'masse^d^^espèces qu’dhÀ^peut rap'-
porter à aucun des ■ genres anciennement' établis l 3$4m«.|^tron-
veropg en$pre <|es: groèpesatrès^isEnets. .
M. Knnth a établi ,-sÿms le nom .de dtaseHaoAïipus^ un
genre tout eompesé^d’espèceV;indigènes, des Antilles, «ou Mes
parties chaudes de F Amérique ^ét' dpnLpbisieufs avouent-été
confondues-avecdes Dalb.ergia•. LèS'bônchocanpes/seaâistin-
guent des vrais Ro^inia rj^.par leurs étamines [souvent îmo-
nadelphes 5 / 2 par leur gopsse;stipitéei, qui n’ajjamais que de
quatre à huit ovules,au lieu d’ungtand nombre ; 3êp'haf^on
stpfe pep; ouï point barbu ;.‘4â» ^ajf-sesHfeuiUes'-qui,! biemquè-
ailées a^ep impaire, ont les folioles dépoûrvuesndeM^pellesî
Toutes les espèces defpe genre sont desturbres sansnpmes ,
à Meurs en ^grappe: :ef àjjÉs§fi^fes. purpurines ou blanches. :
Outre les, espèces ’^é^gnées par M. Runth^jgp; rapporte le
Jfyalbergia Meptc^hÿllg&$L& Poiret, qui n’est peut-être pas
suffisamment distinct du £^pf^tfygphylàes ?vle R^thn&edxp,us,
^ï^e^^mdejPoiret; leï^Â%|^^ÿje^,de Miller 5 lu Rtùbihia
stgpium de' Jacquin 5 et peulfêtre-, [e Robinia rnaculata de
RuntÊ^I qu’on.me.dpit pasi, selon cet auteur, répare* du'îgré-.
codent j le Æpbmm s.f0 i^ ld e j Swartz, qui paloîtftdâfféjent
de celui de Jacquin y-le Robinia- Nic&^\ d’Aublet.; et ŸAme>
rirmiumpüvnatum de Jacquini Au reste les*espôèes de Jjon-
efyocdrpus méritent toutes-d’être revues avec soin, et ib.est
probable que plusieurs des Robinia mal connus rentreront
dans cçAgenre, |
_ Le P.s^idaçasbiia de Tournefort, qui disât garder le nom
de Robinia , et qui se;caractérise par son calice à cinq dents
IffecéoléêS y ddnt'Msdeux supérieures sdnt plus courtes et plus
les aufrfe&ïj par son’ StyteMarbu longftùdi-
iiàleihei^,^a|ébté,‘ qui regardbf4l ’étendctrdî|' par^sai^Ülsse com-
brîméb^-ffe^lfe ou presque absolumentoessile l renfermant
plùsieuf^’fFaïnes- aplaties. ?Sdiis^ce ' ”<n»aCïèrV*je éomprends
sefil^mîêht les ‘M'ÉÉiriM à t l'’Améri^mte ’sëpteiitrionafe : ils Ont
fcb%sdd&fleurs blanches'oû..r0s^ld^®^àâ»^àppes simples
dt pendant^^fexi^feuillês sont ail^^É^edmpaire ; èrêfchaque
folTdl^Sfeiuflie^ d’un petit^pdKfelB/propre*, ?et? >à la^fasi^dè'
"êll^^Sl^trouVePd'iâi stipeM|rênïfoïme d* alêne/-eafenétèrè qui
manqtfê dans t^yf^si^^^^bli®v^ini^ ^ .q u i a quelqûelva^
leur‘5^ |^ P |^ ^m illeL ,,ife^‘JÎ,6ÂS*,rf sont Wül deb1 avares on
dbâMfb^tss%âui:; point de Vraïêsf'stip'ilfes /mais portant
sèffirWàt%’un et d’autréfïéb# de lahà&ê? du pétale une
épine1 d’ahdfd^ mollet en durcie, (feformeooniquè, eomwjffeêê
; e ^ l î ’asu,J 'et dîrmê^horizOntelemênt.vGës-épines ne
peuve nt^if^difficilêfeï ent être considérées c'onftné* dès stipules4
en^ n f^ e^w 1 paraissent plutôt! dés1 expansions’ latérales
ducoussffièt.^44
Lelggnre,-ainsi circonscrit, comprend les cinq espèces les
plus contitiuné& ddü'jardins, sifvpir •: les R. psmdac&ciai,le
R . umbraculiferâ, qui n’èslpeuteêtre qu’une variéié du précédent
, le R . dubm dé-Faùcault, qui semble uneshybride du
Pkmtdaôacia et du le R . pi-scm® de Ventenat ^ et le
R. Wmpéla.
Vi^â'V-Toutes Les espècèsmon comprises dans le genbe Râhinia
tel que je viens dele èireonsinrire , en diffèrent par leur style
complètement glabre ; ét'Cé feit tenddéjà à prduver qu’on ne
peuf?cOnserver la division en. deux genres* seulement, telle