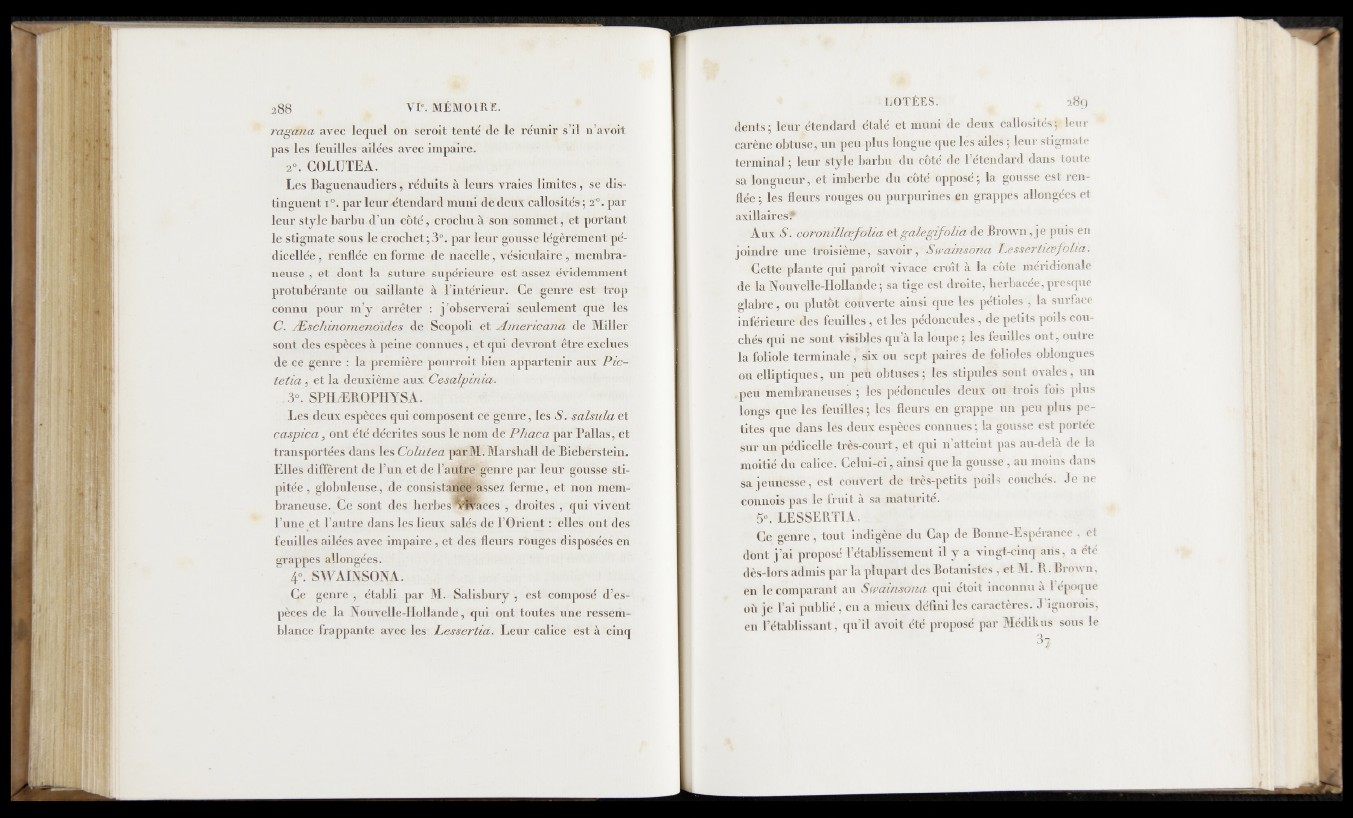
ragana avec lequel on serôit tenté de le réunir s’il n’avoit
pas les feuilles•uilées avec impaire.
2°. COLTJTEA,
Les Baguenaudiers, réduits à leurs vraies lixnites-f 'se 'distinguent^,.
par leur .étendard muni de deux callosités ; 2®. par
leur style barbu, d’un côté pcrdchu à son sommet H et portant
le stigmate sous le crochet; 3°. par ledr'goiIsSë- légèrCmenfpé-
diceUée, renflée en forme de nàcené^Vésiculâiré ^■’membraneuse
et dont la suture supérieure- est 'àsSèz évidemment
protubérante ou saillante -à l ’intérieurlÉfil'é ègenre est trop
connu pour m’y 1 arrêter : j ’observerai*' seulement que les
C . Æschinomenoides de Scopoli ëtizêineriGarm' de . Miller
sont dès espèces à peine connues et qui devrontiêtre exclues
de ce genre : la première pôurroit bîefl appartenir fjixr F fo -l
tétià ) et la deuxième aiatf Ce&alpinjà».
SPlIÆlt01)11Y SA ;
Les deux espèces qui composent ce"'genre, l e s è ÿ
caspica, ont été décrites sous le nom de Pk&çà par Pallas ] et
transportées dans lés CoUitea par]p.Marshall de Biebérstein.
Elles different de l ’un et de l ’aufréfigenrè par leur-gousSe' sti-
pitée, globuleuse,idë cônsista^^Hssez ferme, ét'ïüdri'mem-
braneuseüüe sont dès herbes^^mces , drortés., qui vivent
l ’une et l ’autre dans les lieux salés de l ’0rient : elles ont des
feuilles ailées avec impaire, et des' »fleurs rouges disposées éri
grappes allongées.
4°. SWAINSONA. ;
Çe genre , établi par M. Salisbùry , est composé d’espèces
de la Nouvelle-Ilollandé, qui ont toutes une ressemblance
frappante avec les Lessertidi Leur calice est à cinq
dents; lëUr étendard étalé etmünêde deux callosités*^leur -
carène obtuse? un peu plus longue que lés ailes ; leur stigmate
terminal ; leur Style'barbu du ébté de l ’étfendard dans toute
Sà longueur, et imberbe du . cMé^y>pposé ; la gousse est renflée
; lëS fleurs rô tie s ou purpurines #n grappes allongées et
axiBaire^
Aux Y. coronilloefûïia et galegifolia deBrown, je puis en
joindre tó e troisième, savoir f 'Swûârlèôfia T^essertioefôLia.
CettC;'planté qui paroît vivace croîtra la cote meridionale
de la^tiYéïle-Hollaide ; sa tige est droite} herbacée, presque
glabre, Ou^plutet êouVërte ainsi que lfes pétioles , la surface
i i i f ë ^ f rendes feuilles j et lëS pédonciiies-, de petits poils cou-
. cbés-qui ne sont visibles qu’à la loupe ; les feuilles ont, outre
la&IWe terminal^ |^ x ou sept paires de folioles oblongues
@0 elliptiqttès, un peft obtuses ; lès stipulés sont ovales, un
peu membraneuses ; les pédoncules deux ou trois fois plus
longs-quedé^ feuilles*;, les fleurs en grappe un peu plus petites
que dans les deux espèces connues ; la gousse est portée
sur un pédicell©- très-court, et qui n’atteint pas au-delà dé la
moitié du calice. Celui-ci, ainsi que la gousse, au moins dans
sa jeuiïèsse, est couvert de très-petits poils couchés. Je ne
töhnoÉs pas leHfruit à sa maturité.
LESSERTIA.
Ce genre, tout indigène du Cap de Bonne-Espérance , et
dont j ’ai proposé l ’établissement il y a vingt-cinq ails, a été
dès-lors admis par la plupart des Botanistes, et M. R. Brown,
en le comparant au Swàitisdna qui étoit inconnu à l ’époque
dît je l’ai publié, en a mieux défini les caractères. J’ignorois,
en 1’établissant, qu’il a voit été proposé par Médikus sous le
3?