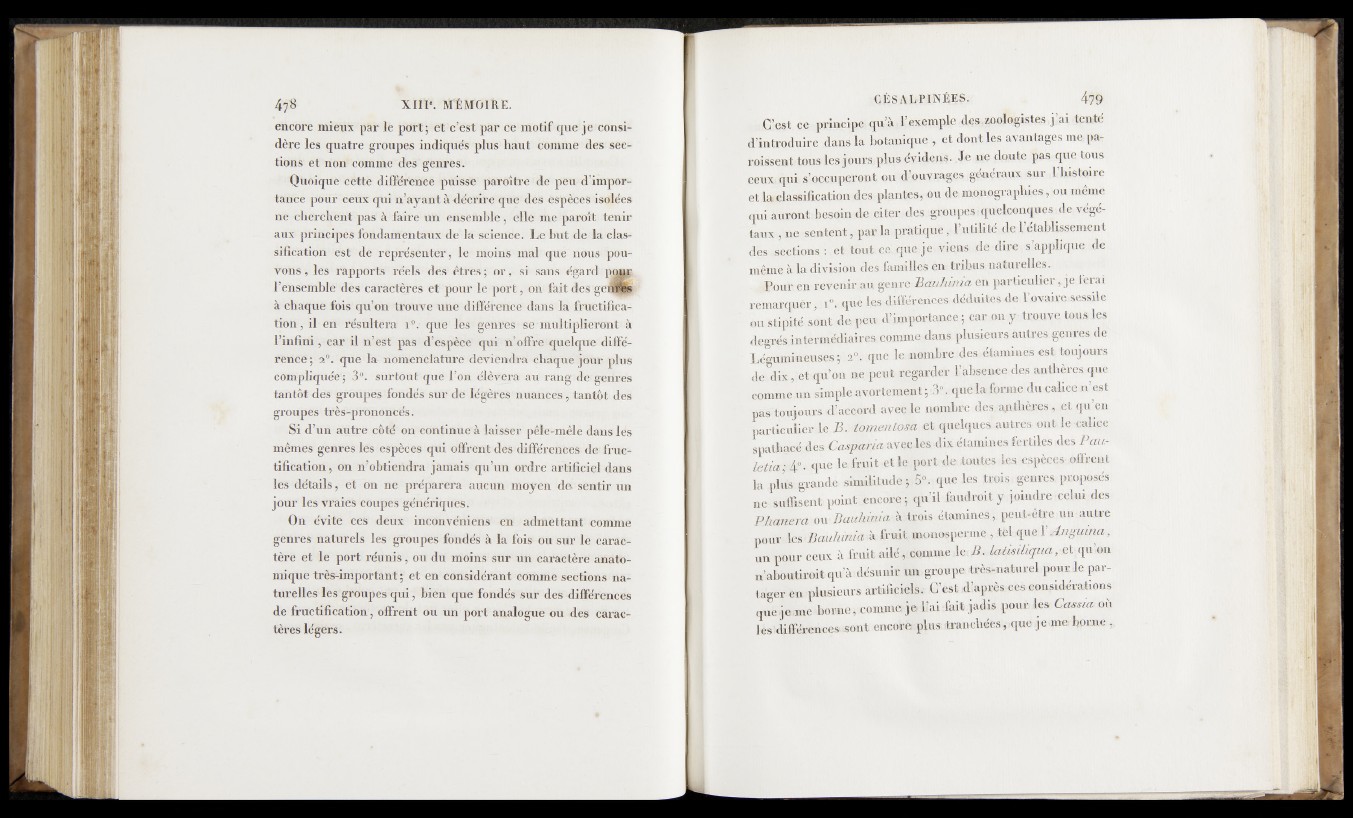
m XIII". ^ÉaïOIRE.
encore mièux pâr lfe pdttjeHPc’est par ce motif qne-je-considère
les quatre groupes indiqués plus haut eotflme dewsèe^
tions et non* coimnëhïesi' genres.
Quoique' eêttë difïPrëriéë 'puisse parOîtrè! do peu- d’impor-
tanèe pourcëttix qui n’ayant à décrire que des êspèiceSisdiées
ne cherchient^iii^feîi’ë un eiisOftibre, elle Été paraît -tenir
aux pririeipès' fondamentaux de là science. lie but de -laclas-
sifîcation est de reprÉàOtïter, le - moins mal que nous "pou-
vous ÿ lesI rapport®" reèls dès5 étirés j or ÿ. siv sanSfc5^ a rd pour
rensemblW dès çaefetèÿes e t pour port
à chaque fois qu?'Ott trouve une différences dans^lM^-teL^fiflea^
® ü fï il é#-résÉlteraf r®. que’ lé s {geïii?esj'se ifitilt^pliêrOnt- à
l ’infini , ‘caë il ïtMst pas d^espèeë qüè^^offrei'qüelqtaîesdàffë'-
rfence’} 2® jqüë*Itt^nOffiéùelhïure 'détiendra chaque jour plus
compliquée 5 3,°. sùrtout que l ’ohj^lê^ra àlu^rângÉleïgejÎEë's
tantôt des groupes fondes sur de‘ légères nuances, tantôt, de^
groupes très-prononcés. .
S ld ’un autre cô® otfrOntinueàlaïsser p##anêle danslèf
mêmes genres lês/eS^èé^ qui offrent deSjdifférenhes dte&iies
tification, on n'obtieftdra jàmaiÉqu’tMordre artificiel dans
lëSrdëtails, ef 'on ne préparera aûCun mOyéû de^stittir un
jour les vràiefe ebupes généfiqttêâi ; fa
On évifë cfes’ deux incbn%ëhiëns en* -admët-tâWcomme
geni*eS naturels M groupes fondés à la fois ou sur le caractère
et 'le port- réunis | UÉ-du1 moinS’sUr?'U1É.eWâëfère ahâtO-
ntique très-importànf;! et en considérant eo'ïàme sections naturelles
les gro tip e s^ i, bien que fondés sur des différences
de fructification1, offrent ou un port analogue ou des caractères
légers.
IlÉBiËriaMift p i
M.C’ost ce
d’introdujcc dans la botanique * e t dont l,es avantages me, paraissent
tous les jours, plus c ^ f t s - J « m M s q u e d u u s
ceux,qui, s’occuperont H A’w i W ,généraux sur l’bist^re
etiMaseifmafiamdes. plan te s^ u ieiîÉwmgrapMes, -ou meme
qùi .auront ibe soin-de:xâtendes groupes f quelconques d e s-végé-
taux 'm e t t e n t , par la p r a t i q u e ^ « » de rétablissement
dés je tio n s , : ,e t to u t ce,qu%je^viensii[de * dire» A p plique de
mémo à. la division des familles en tribustnaturelies. | M f r*
JPnunen revenir.au g ç m e ï B d i i à w m en partkulier ,-. je ferai
remarquer, 1°. que les différences déduites de 1 ovamrscssde
« s t ip it é ^ t -d e r p e u ' d’importasme ; M | g | t o u s l e s
I degrés-intermédiaires, comme dans pludeurs,autres genres »
Légumineuses ÿ& l que
de dix ,:et-qü’on ne peut regarder L’ahsenoexdes anthèresqne
comme .un'simple avortement ; *%.que‘aaiÉ)rme du calice n ’ est
pas»toujours.d’acoord avec le nombre des. anthères , .et qu’en
particulier 1e .B ^ m e n tom efc qnelqueskautres-ontle calme
Ipatbaeé des Clasp&ria aveedes dix étamines fertiles des PctiM
l e t ia ^ . que le f r u i t s Leportde: toutes ies^pères;,oftrent
la plus grande s im ilitu d e ,^ que les trois : genres, proposés
nat suffisent p o in ta c o r e ; qu’il faudrait y joindreteelui des,
Plumera ou BavhunaxA trois étamines,.peut-être un autre
pour les Bauhinkrà: fruit monosperme, tel que YAngum a,
un pour cèux à fEuxtndé^mommède{|Sa^^%ié«n^qu,’OU
a ’^K^Bodtqiï’àxiaésmBk jift,giïiupetAjrèsima*urelpo»dlep^|
tager ën plusieurs artificiels,; G’êst diaprée ees ^n^ulératiotts-
que ,jeaneaboraie gcw«siftefcj*fllai fa it jadis pour le» Géasia* où
l é s î d i f f é r ! m c e s ) S o n f c encoiB&plusiîtraMMèsiÿ»quef®imfâ Épi»e ».