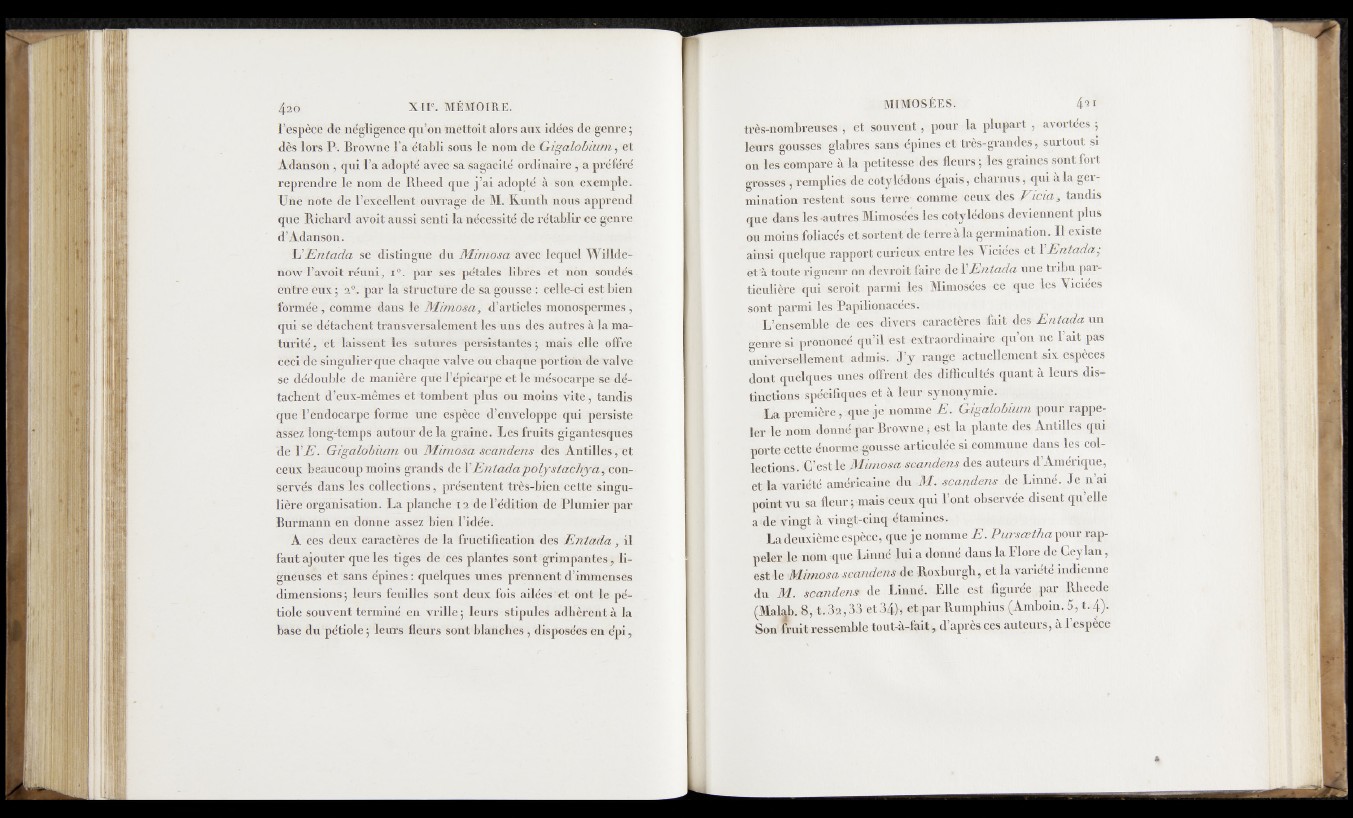
F'éspèçte de.négïigértce qu’onmettoit alors aUx idées de genre ;
dès fors P*. Browne l ’a établi sous le nom de ^Cxêgeiï&biuM ^et
AdâUsOü, qui l ’a adoptékŸëè*sa sa gacilé ordinaire, a préféré
reprendre le nom de llheed que j ’ai adopté'à sou exemple,
üùé pote dé Përéëïléïrt CWfagé dé M. Kunth nous apprend
que lliebard àvoit aussi senti lanéeéSsitédé rétablir eegenre
d’Adanson.
\a E ntad a sè;idistingïiè du J®|Éltl WMïdénow
l ’avoit réuni, -iad pat ses pétâtes llbrés ^ in o n soudés
entre eux ; 2°>. par la ^ truéOfté de ^IgiUësW ééfié-éi est Rien
fôïméé, comme dans lé Mrfid&sa-, d’ârticlés monospérmes,
qui:sè détachent trarïsyersàleméntdels -uns dés autres# la maturité
, et laissent lés sutures persistantes:; mais eMe offre
ceci d e sin gufi erque ehaqtré vâlré^o'Udhâqiie pôrtitod’ê'yMteé
se dédouble de manière qué?l !épieârpé ;e|dé^ë'sOMfpf ^#!dé-
taéhent d’euX-niêmes et tombent plus ou moins vitey tandis
que P endoeàrpe forme une espèce d é v e lo p p e qui-persiste
âssez long-temps autour de la grahofé'. liés fruits gigâ%tesqtiéS
de 1’E.^JM^Wbtum ou MiinSêh*1ffltiï8fénà ■ dés Antilles, et
ceùx beaucoup moins grands de YE n ta d a p o ly s ta ch y a , con-
serrés dans"les-colleétions, présentent ti,ès-'bien<cetteysitigu-
lière organisation. La planche 12 defFéditien de Plumier par
Burinânn en donne assëz bien Fidéëi
A ces deux caractères de la frtiétifîèation deis E tiïU êa , il
faut ajouter que les tiges de 'ces plantés sUnt grimpantes^ ligneuses
e t’sans épines : quelques unes prennent d’immenses
dimensions 5 leurs feuilles sont deux fois ailées-'Ct ont le pétiole
souvent terminé en vrille; leurs stipules adbièrent-à la
base du pe'tiole ;leu ïs fleurs sontblanches, disposées en épi,
très-nombreuses , et sou veiatt,-; pour : la plupart , avortées,y
leurs’fu s s e s 5 glabres sans-épines et* très-grandes-, surtout si
on lms mmpfcè M% rpetiterée^des fleurs; t e l §$*teés sontfort
grosses ^ remplies'de‘Cotylédons épater qhâmus 5 -qjua àla.ger-
mination Testent sous terre- Gomme ceux des tandis
que dans les-autres Minorées tescéfcytedpus deviennent .plus
OU moins foKaréyerferéfetènft’d ^ ^ ^ Il existé
ainsi quelque rapport curreufe^ntre les
e fà toute riguenr onîdévjroit faire d ê s f o n t t i tribu ;par-
ticteiëfé^fpii séroit g parmi -les Mim osées Ce que tes Viciées
soût'parmidcsti^piflaanaeées.
L ’ensemble du-dès* divers caractères fait des'Eiatada un
g'enrersi»prontÎHoé qu’il est extraordinaire qu’on -ne Lait pas
universellement »admis. lly/raitge actuellement ,six espèces
dont quelqué^vpne^^ffrent des difficultés quant à leursf distinctions
spécifiquessf^t^tejir' synonymie.
L a première > que.je&hQmme J 2fyî^a$pfâum poui£fca®pe-
ler lemcUn donnéapâr Browne*; -est la plante des Antilles qui
portecette-eteormégousseaKtienlé^LGommune dans le i collections.
dtestte Mim&m'S'G&ndBns des.-auteurs d’Amérique,
et-laivadiété amuÉc^fté du^M.rV^wwdiswf.jde^inné. Je n’ai
point vu sa fleur-; maiseeUxqui 1L’ont observetedisent qu’elte
ad e vingt à vin^eifefdtamines;,
La deuxième espèce, que je nomme E . Pursætha pour rappeler
le nom -que Linné dui a donné dans laE-loi;e ^ ^ y l à n ', *
est le Mimosa Jtexburgh,,et la^griétfiiinddpqny
du M * fêçqndenm de, Linné. Elle est iflgurée ,par Kheede
(Malab. 3, et-par Eumphius^Amboin .:§* | | g j
Son l u i t Héssémhte tout-Mü** diaprés | | § auteurs, à J’çspèce