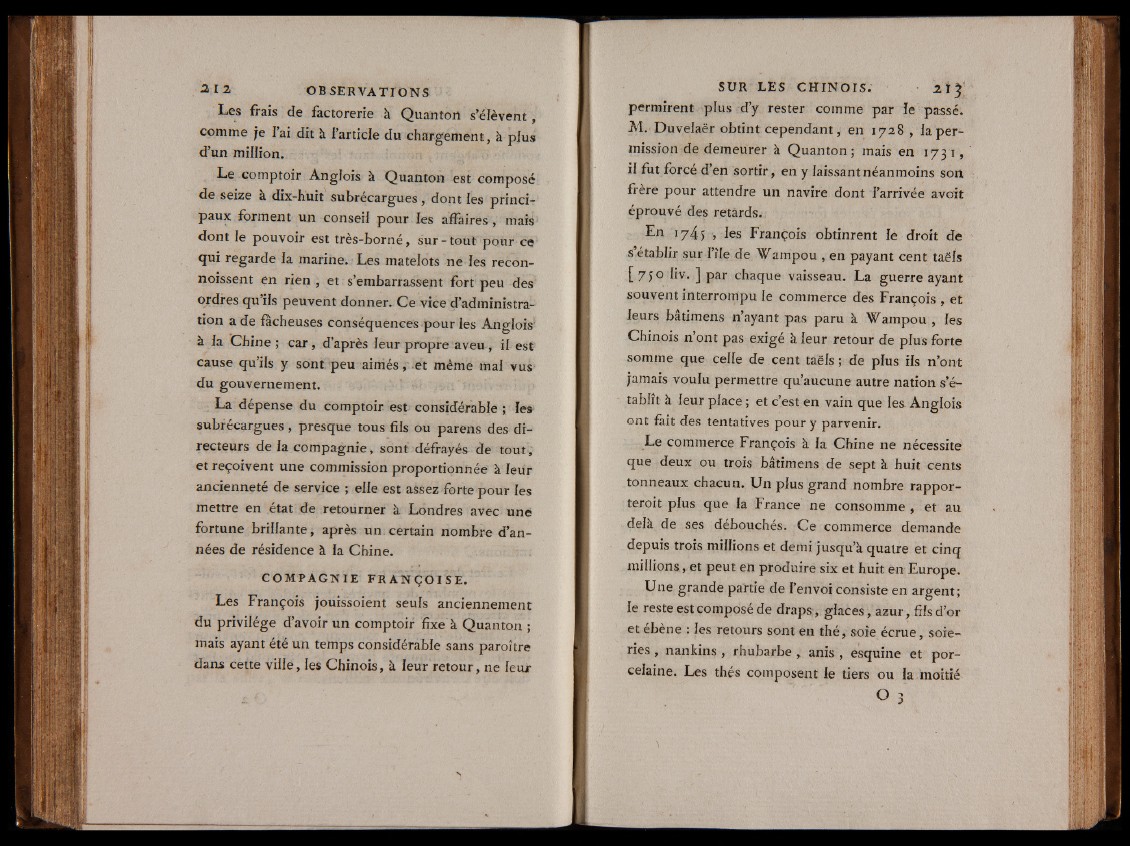
Les frais de factorerie à Quantort s’élèvent,
comme je l’ai dit à l’article du chargement, à plus
d’un million.
Le comptoir Anglois à Quanton est composé
de seize à dix-huit subrecargues, dont les principaux
forment un conseil pour les affaires, mais
dont le pouvoir est très-borné, sur-tout pour ce
qui regarde la marine. Les matelots ne les recon-
noissent en rien , et s’embarrassent fort peu des
ordres quils peuvent donner. Ce vice d’administration
a de fâcheuses conséquences pour les Anglois’
à la Chine; car, d’après leur propre aveu, il est
cause qu’ils y sont peu aimés, et même mal vus
du gouvernement.
La dépense du comptoir est considérable ; les
subrécargues, presque tous fils ou parens des directeurs
de la compagnie, sont défrayés de tout ;
et reçoivent une commission proportionnée à leur
ancienneté de service ; elle est assez forte pour les
mettre en état de retourner à Londres avec uné
fortune brillante, après un.certain nombre d’années
de résidence à la Chine.
COMPAGNIE FRANÇO I S E .
Les François jouissoient seuls anciennement
du privilège d’avoir un comptoir fixe à Quanton ;
mais ayant été un temps considérable sans paroître
dans cette ville, les Chinois, à leur retour, ne leur
SUR LÈS CHINOIS.
permirent plus d’y rester comme par le passé.
M. Duvelaër obtint cependant, en 1728, la permission
de demeurer à Quanton; mais en 173 1,
il fut forcé d’en sortir, en y laissantnéanmoins son
frère pour attendre un navire dont l’arrivée avoit
éprouvé des retards.
En 1745 , les François obtinrent le droit de
s’établir sur l’île de Wampou , en payant cent taëÎs
[ 75° hv. ] Par chaque vaisseau. La guerre ayant
souvent interrompu le commerce des François , et
leurs bâtimens n’ayant pas paru à Wampou , les
Chinois n ont pas exigé à leur retour de plus forte
somme que celle de cent taëls ; de plus ils n’ont
jamais voulu permettre qu’aucune autre nation s’établit
à leur place ; et c’est en vain que les Anglois
ont fait des tentatives pour y parvenir.
Le commerce François à la Chine ne nécessite
que deux ou trois bâtimens de sept à huit cents
tonneaux chacun. Un plus grand nombre rappor-
teroit plus que la France ne consomme , et au
delà de ses débouchés. Ce commerce demande
depuis trois millions et demi jusqu’à quatre et cinq
millions, et peut en produire six et huit en Europe.
Une grande partie de l’envoi consiste en argent;
le reste est composé de draps, glaces, azur, fils d’or
et ébène : les retours sont en thé, soie écrue, soieries
, nankins, rhubarbe, anis, esquine et porcelaine.
Les thés composent le tiers ou la moitié