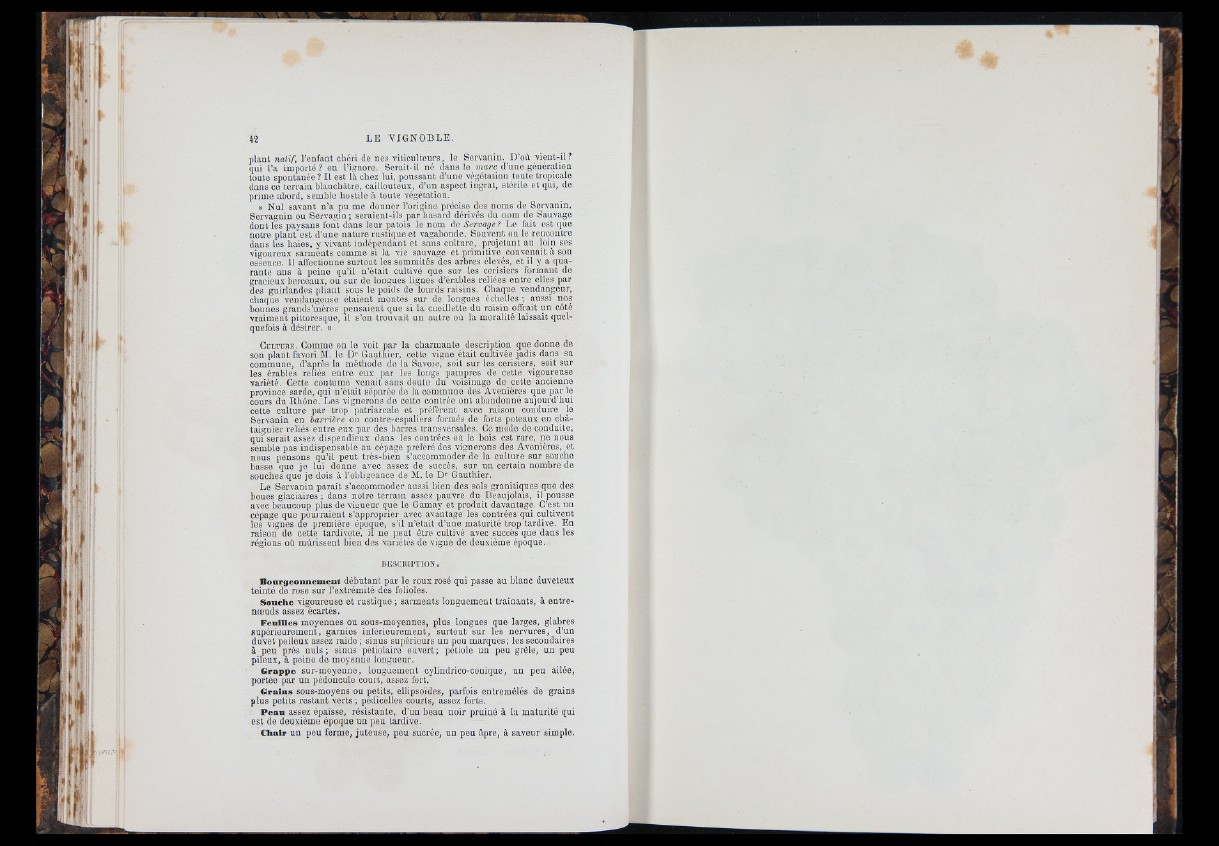
'î.
ï ’
H
d i
d
! l
plant natif, l ’onfant chéri do nos v iticu lten r s, le Servanin. D ’où ■vient-il?
qui l ’a importé? on l ’ignore. Serait-il né dans le w a r c d’imo génération
toute spontanée ? Il est là chez lui, poussant d’uoo végétation toute tropicale
dans ce terrain blanchâtre, caillouteux, d ’un aspect ingrat, stérile et qui, de
primo abord, semble h o stile à toute végétation.
» Nu l savant n ’a pu me donner l ’origine précise des noms do Servanin,
Servagnin ou Servagin ; sera ient-ils par hasard dérivés du nom de Sauvage
dont les paysans font dans leur patois le uom do Servage? Le fait est que
notre plant e st d ’une nature rustique et vagabonde. Souvent on le rencontre
dans les h a ie s, ■y vivant indépendant et sans culture, projetant au loin scs
vigoureux sarments comme si la vie sauvage et primitive convenait â son
essen c e . 11 alfectionne surtout les sommités des arbres élevés, et il y a quarante
an.s à peine qu’il n ’était cultivé que sur les cerisiers formant de
gracieux berceaux, ou sur de longues lign e s d ’érahics reliées entre e lle s par
des guirlandes pliant sous le poids de Îourds raisins. Chaque vendangeur,
chaque vendangeuse é ta ien t montés sur de longues é chelles ; aussi nos
i s ’mères p en sa ien t que si la cu e illette du raisin oOrail u n côté
il o’nn tvnnvnit bonn es grands
v raiment pittoresque, il s ’cn trouvait un autre où la moralité la issa it quelquefois
à désirer. «
C u l t u r e . Comme on le voit par la charmante description (¡ue donne de
son plant favori M. le D*- Gauthier, cette vigne était cultiv ée jadis dans sa
comm une, d’après la méthode de la Savoie, so it sur les cerisiers, soit sur
le s érables reliés entre eux par le s longs pampres de cette vigoureuse
variété. Cette coutume v en a it sans doute du vo isina g e de cette ancien ne
province sarde, qui n ’était séparée de la commune des A v enières que par le
cours du Rh ône. Les vignerons de cette contrée ont abandonné aujourd’hui
ce tte culture par trop patriarcale et préfèrent avec raison conduire le
Servanin cn b a rriè re ou contre-espaliers formés de forts poteaux en châtaignier
reliés entre eux par des barres transversales. Ce mode de conduite,
qui serait a ssez dispendieux dans les contrées où le bois e st rare, n e nous
semble pas indispensable au cépage préféré des v ignerons des Av en iè r es, et
nous pensons qu’il peut trè s-b ien s’accommoder de la culture sur souche
basse que je lui donne avec assez de succès, sur_ un certain nombre de
souches que je dois à l’obligeance de M. le D ‘‘ Gauthier.
Le Servanin parait s ’accommoder aussi bien des sols granitiques que des
boues glaciaires ; dans notre terrain assez pauvre du Beaujolais, il pousse
avec beaucoup plus de vigueur que le Gamay et produit davantage. G e st un
cépage que pourraient s ’approprier avec avantage le s contrées qui cultivent
’ y • " Ar\/M-r,iQ o ’il /-I’n r . n m n t n i . i f le s -V ign e s de première épôqu*e, s il n ’était d’une maturitQé ttrrnonp ttaair’ddiixvr ûe . PE’nn
raison de cette tardiveté, il n e peut être cultiv é avec succès que dans les
régions où mûrissent bien des variétés de vigne de deux ième époque.
DESCRIPTIOiV.
B ourgeonnement débutant par le roux rosé qui au blanc duveteux
tein té de rose sur l ’e.xtrémilé des folioles.
Souche v igoureuse et rustique ; sarments lon gu emen t traînants, à entre-
noeuds assez écartés.
Feu ille s m o y en n e s ou sou s-m o y en n e s, plus longues que larges, glabres
su périeurem en t, g arnies in fé r ieu rem en t, surtout sur le s nervures, d’un
duvet poileux assez ra id e; sin us supérieurs uu peu marqués; le s secondaires
à peu près n u ls ; sin us pétiolaire ouvert; pétiole u n peu grôle, un peu
p ileu x , à peine de m o y en n e longueur.
G rap p e su r -m o y en n e , lon gu emen t cylindrico-conique, uu peu a ilé e ,
portée par u n pédoncule court, assez fort.
G r a in s sous-moyens ou petits, ellipso ïdes, parfois entremêlés de grains
p lu s p etits restant verts ; pedicelIes courts, assez forts.
P e a u a ssez épa isse, r é sistan te , d’un beau noir pruiné â la maturité qui
e st de deux ième époque un peu tardive.
C h air un peu ferme, ju teu se , peu sucrée, un peu âpre, â saveur simple.