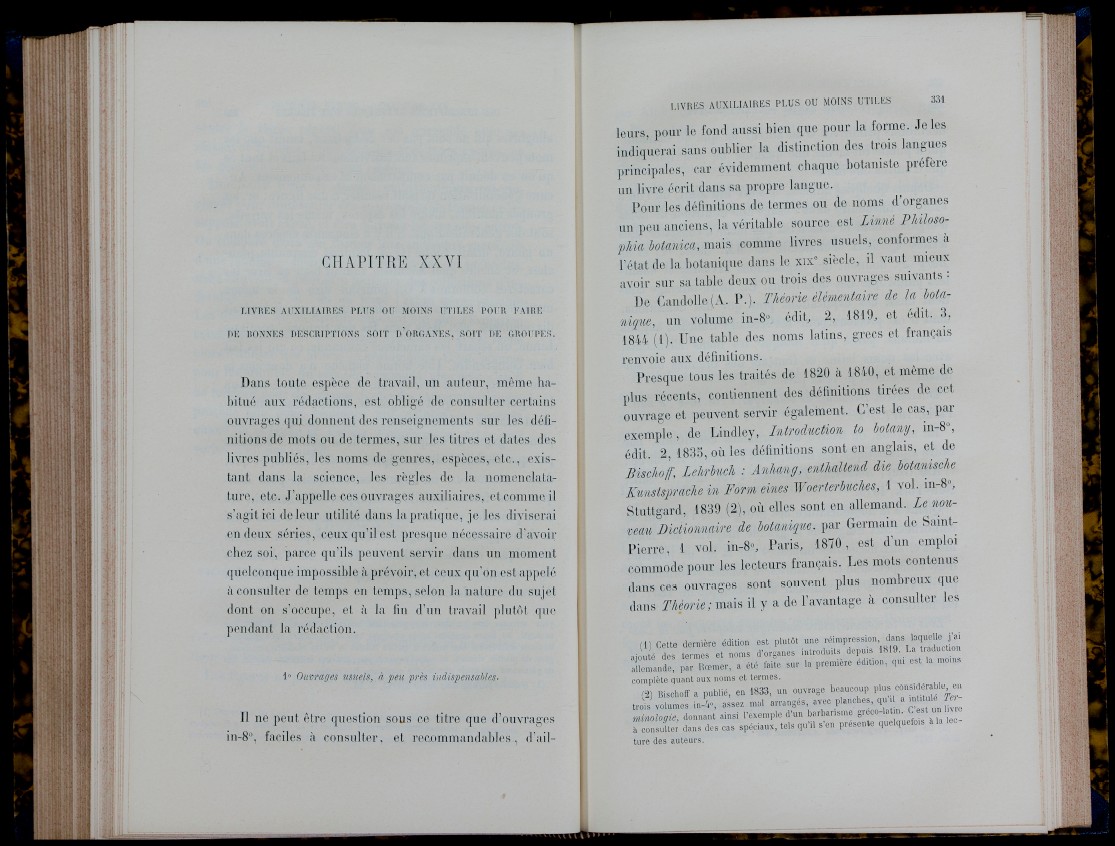
s h-m
iilii
, » -
A
h i i w Uiîf B
'.it
i
•ë
J -
CHAPITRE XXVI
LIVBES AT'XITJÂTRES PLUS OTT MOTNS UTILES POT'R l^UF.E
DE BONNES DESCRIPTIONS SOTT D'ORCtANES, SOIT DE GROTiPES.
Dans toute espèce de travail, un auteur, môme ha-
])ilué aux rédactions, est obligé de consulter certains
ouvrages qui donnent des renseignements sur les définitions
de mots ou de termes, sur les titres et dates des
ivres publiés, les noms de genres, espèces, etc., existant
dans la science, les règles de la nomenclatature,
etc. J'appelle ces ouvrages auxiliaires, et comme il
s'agitici de leur utilité dans la pratique, je les diviserai
on deux séries, ceux qu'il est presque nécessaire d'avoir
chez soi, parce qu'ils peuvent servir dans un momeirt
quelconque impossible à prévoir, et ceux qu'on est appelé
à consulter de temps en temps, selon la nature du sujet
dont on s'occupe, et à la lin d'un travail plutôt que
pendant la rédaction.
1° Ouvrages, usuels, à peu près indispensaUes.
Il ne peut être question sous ce titre que d'ouvrages
in-8°, faciles à consulter, et rec.ommandables , d'ai-
LIVRES AUXILIAIRES PLUS OU MOINS UTILES
331
leurs, pour le fond aussi bien que pour la forme. Je les
indiquerai sans oublier la distinction des trois langues
principales, car évidemment chaque botaniste préfère
un livre écrit dans sa propre langue.
Pour les défmitions de termes ou de noms d'organes
un peu anciens, la véritable source est U%nè PMlosopUa
hotcmica, mais comme livres usuels, conformes à
l'état de la botanique dans le xix" siècle, il vaut mieux
avoir sur sa table deux ou trois des ouvrages suivants :
De Candolle(A. P.). Théorie élémentaire de la botanique,
un volume in-8". édit, 2, 1819. et édit. 3,
1844 (1). Une table des noms latins, grecs et français
renvoie aux définitions.
Presque tous les traités de 1820 à 1840, et même de
plus récents, contiennent des définitions tirées de cet
ouvrage et peuvent servir également. C'est le cas, par
exemple, de Lindley, Introduction to botany, in-8°,
édit. 2, 1835, où les définitions sont en anglais, et de
BiseJw}, Lehrbuch : Anhang, enthaltend die botanische
Kunstsprache in Form eines Woerterbuches, 1 vol. in-8^
Stuttgard, 1839 (2), où elles sont en allemand. Le nouveau
Dictionnaire de botaniciue. par Germain de Saint-
Pierre, 1 vol. in-8o, Paris. 1870, est d'un emploi
commode pour les lecteurs français. Les mots contenus
dans ces ouvrages sont souvent plus nombreux que
dans Théorie il y a de l'avantage à consulter les
(1) Cette dernière édition est plutôt ^"-Pf
. i ou é des termes et noms d'organes introduits depuis 1819 La t.aduction
X m a n d e ! ^ar Roemer, a été faite sur la première édition, qui est la moins
complète quant aux noms et termes.
C2) Bisehoir a publié, en 1833, un ouvrage beaucoup
trois volumes in-4o, assez mal arrangés, avec planches, ^^
minologie, donnant ainsi l'exemple d'un barbarisme greco-lat n- G « ^ un Ime
Tc^nsuUei- dans des cas spéciaux, tels qu'il s'en présente quelquefois Ala lec
t u r e des auteurs.
il f t
ri feui
•¡mil