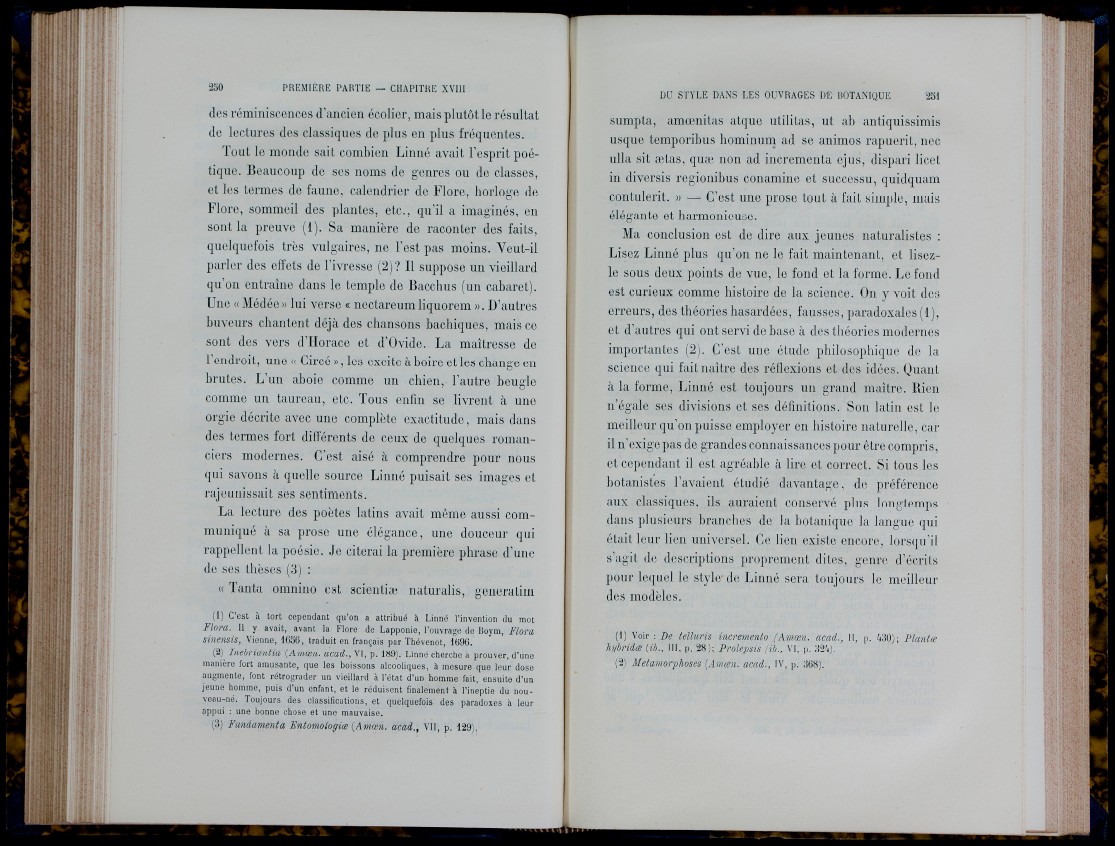
• il
h '
I
.i-.i il
'fv "l^í-BÁ^.f.»-if ^
li ^ • '
il
"if-- li'
250 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE XVIll
des réminiscences d'ancien écolier, mais plutôt le résultat
de lectures des classiques de plus en plus fréquentes.
Tout le monde sait combien Linné avait Tesprit poétique.
Beaucoup de ses noms de genres ou de classes,
et les termes de faune, calendrier de Flore, horloge de
Flore, sommeil des plantes, etc., qu'il a imaginés, en
sont la preuve (1). Sa manière de raconter des faits,
quelquefois très vulgaires, ne Test pas moins. Veut-il
parler des effets de Tivresse (2)? Il suppose un vieillard
qu'on entraîne dans le temple de Bacchus (un cabaret).
Une (( Médée» lui verse « nectareumliquorem ». D'autres
buveurs chantent déjà des chansons bachiques, mais ce
sont des vers d'Horace et d'Ovide. La maîtresse de
l'endroit, une « Circé », les excite à boire et les change en
brutes. L'un aboie comme un chien, l'autre beugle
comme un taureau, etc. Tous enfm se livrent à une
orgie décrite avec une complète exactitude, mais dans
des termes fort différents de ceux de quelques romanciers
modernes. C'est aisé à comprendre pour nous
qui savons à quelle source Linné puisait ses images et
rajeunissait ses sentiments.
La lecture des poètes latins avait même aussi communiqué
à sa prose une élégance, une douceur qui
rappellent la poésie. Je citerai la première phrase d'une
de ses thèses (3) :
(c Tanta omnino est scientia; naturalis, generatim
(1) C^est à tort cependant qu'on a attribué à Linné l'invention du mot
Flora. Il y avait, avant la Flore de Lapponie, l'ouvrage de Boym, Flora
sinensis, Vienne, 1656, traduit en français par Thévenot, 1696.
Inehriantia (Amoen. acad,, VI, p. 189). Linné cherche à prouver, d'une
manière fort amusante, que les boissons alcooliques, à mesure que leur dose
augmente, font rétrograder un vieillard à l'état d'un homme fait, ensuite d'un
jeune homme, puis d'un enfant, et le réduisent finalement à l'ineptie du nouveau
né. Toujours des classifications, et quelquefois des paradoxes à leur
appui : une bonne chose et une mauvaise.
(3) Fundamenta Fntomologioe (Amoen. acad., VII, p. 129),
DU STYLE DANS LES OUVRAGES DE BOTANIQUE m
sumpta, amoenitas atque utilitas, ut ab antiquissimis
usque temporibus hominuni ad se ánimos rapuerit, nec
ulla sit setas, quae non ad incrementa ejus, dispari licet
in diversis regionibus conamine et successu, quidquam
contulerit. » — C'est une prose tout à fait simple, mais
élégante et harmonieuse.
-Vía conclusion est de dire aux jeunes naturalistes :
Lisez Linné plus qu'on ne le fait maintenant, et lisezle
sous deux points de vue, le fond et la forme. Lefonc.
est curieux comme histoire de la science. On y voit des
erreurs, des théories hasardées, fausses, paradoxales (1),
et d'autres qui ont servi debase à des théories modernes
importantes (2). C'est une étude philosophique de la
science qui fait naître des réflexions et des idées. Quant
à la forme, Linné est toujours un grand maître. Rien
n'égale ses divisions et ses définitions. Son latin est le
meilleur qu'on puisse employer en histoire naturelle, car
il n'exige pas de grandes connaissances pour être compris,
et cependant il est agréable à lire et correct. Si tous les
botanistes l'avaient étudié davantage, de préférence
aux classiques, ils auraient conservé plus longtemps
dans plusieurs branches de la botanique la langue qui
était leur lien universel. Ce lien existe encore, lorsqu'i.
s'agit de descriptions proprement dites, genre d'écrits
pour lequel le style de Linné sera toujours le meilleur
des modèles.
(1) Voir : Be telluris incremento (Amoen, acad.,
hyhridoe [ih., ill, p. 28); Prolepsis (ib., VI, p. 324).
(2) Metamorphoses [Amoen. acad., IV, p. 368).
p. 430); Plantoe
if
ï |
h ¡ I
I t i
i l l
ft h
r '
11!;
, ! I Si M
'il î'H'f '
^^ • lîii:
( iiJ' y
Jf' fl'