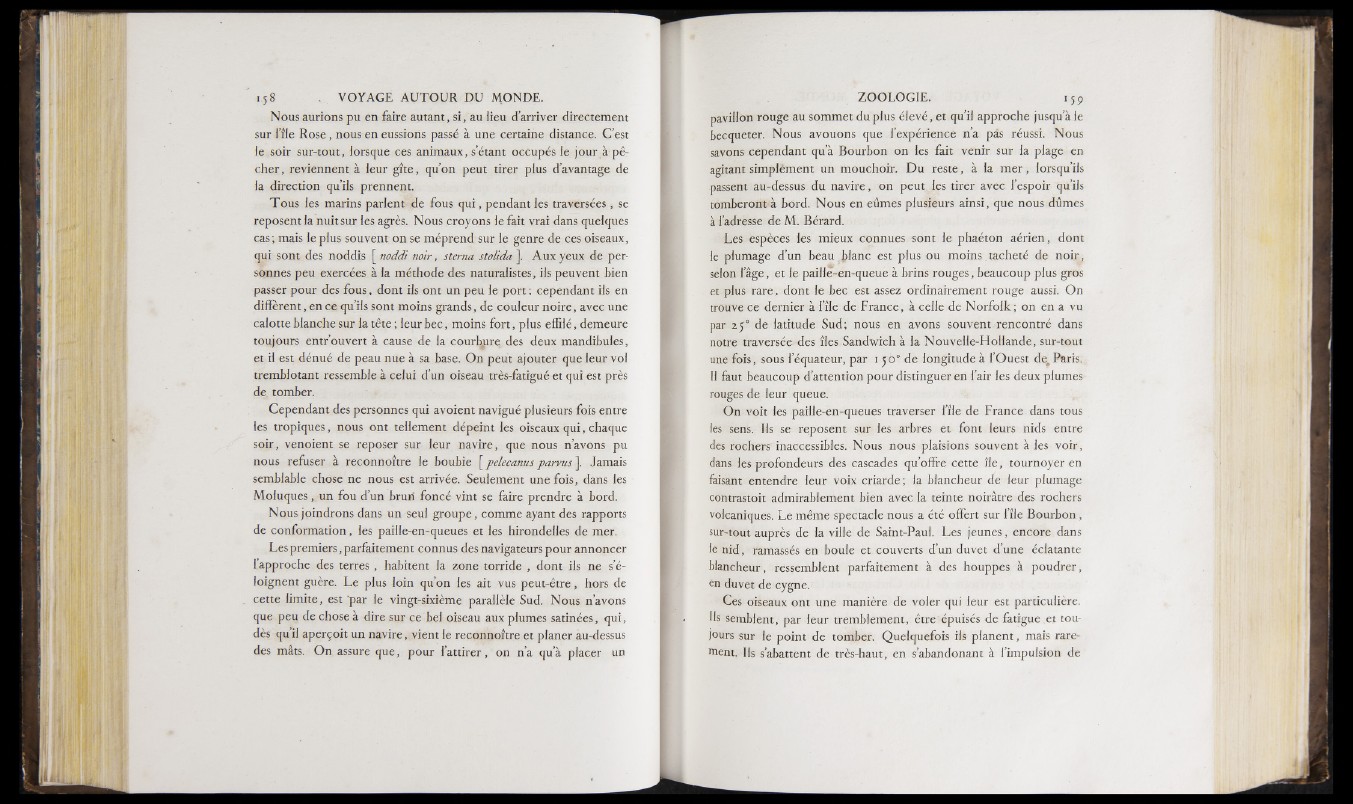
Nous aurions pu en faire autant, si, au lieu d’arriver directement
sur l’île R o se , nous en eussions passé à une certaine distance. C ’est
le soir sur-tout, lorsque ces animaux, s’étant occupés le jour à pêcher
, reviennent à leur g îte , qu’on peut tirer plus d’avantage de
la direction qu’ils prennent.
Tous les marins parlent de fous q u i, pendant les traversées , se
reposent la nuitsur les agrès. Nous croyons ie fait vrai dans quelques
cas; mais le plus souvent on se méprend sur le genre de ces oiseaux,
qui sont des noddis [ noddi noir, stenia stolida ]. Aux yeux de personnes
peu exercées à la méthode des naturalistes, ils peuvent bien
passer pour des fous, dont ils ont un peu le port ; cependant ils en
diffèrent, en ce qu’ils sont moins grands, de couleur noire, avec une
calotte blanche sur la tête; leur bec, moins fort, plus effilé, demeure
toujours entrouvert à cause de la courbure des deux mandibules,
et il est dénué de peau nue à sa base. On peut ajouter que leur vol
tremblotant ressemble à celui d’un oiseau très-fatigué et qui est près
de tomber.
Cependant des personnes qui avoient navigué plusieurs fois entre
ies tropiques, nous ont tellement dépeint les oiseaux qui, chaque
soir, venoient se reposer sur leur navire, que nous n’avons pu
nous refuser à reconnoître le boubie [ pelecanus parvus ]. Jamais
semblable chose ne nous est arrivée. Seulement une fois, dans les
Moluques, un fou d’un brun foncé vint se faire prendre à bord.
Nous joindrons dans un seul groupe, comme ayant des rapports
de conformation, les paille-en-queues et les hirondelles de mer.
Les premiers, parfaitement connus des navigateurs pour annoncer
1 approche des terres , habitent ia zone torride , dont ils ne s’éloignent
guère. L e plus loin qu’on les ait vus peut-être, hors de
cette limite, est par le vingt-sixième parallèle Sud. Nous n’avons
que peu de chose à dire sur ce bel oiseau aux plumes satinées, qui,
dès qu’il aperçoit un navire, vient le reconnoître et planer au-dessus
des mâts. On assure que, pour l’attirer, on n’a qu’à placer un
pavillon rouge au sommet du plus élevé, et qu’il approche jusqu’à le
becqueter. Nous avouons que l’expérience n’a pas réussi. Nous
savons cependant qu’à Bourbon on les fait venir sur la plage en
agitant simplement un mouchoir. Du reste, à la m e r , lorsqu’ils
passent au-dessus du navire, on peut les tirer avec l’espoir qu’ils
tomberont à bord. Nous en eûmes plusieurs ainsi, que nous dûmes
à l’adresse de M. Bérard.
Les espèces les mieux connues sont le phaéton aérien, dont
le plumage d’un beau blanc est plus ou moins tacheté de noir,
selon l’âge, et le paille-en-queue à brins rouges, beaucoup plus gros
et plus rare, dont le bec est assez ordinairement rouge aussi. On
trouve ce dernier à l’île de France, à celle de Norfolk; on en a vu
par 25° de latitude Sud; nous en avons souvent rencontré dans
notre traversée des îles Sandwich à la Nouvelle-Hollande, sur-tout
une fois, sous l’équateur, par i 50° de longitude à l’Ouest de Paris.
Il faut beaucoup d’attention pour distinguer en l’air les deux plumes
rouges de leur queue.
On voit les paille-en-queues traverser l’île de France dans tous
les sens. Ils se reposent sur les arbres et font leurs nids entre
des rochers inaccessibles. Nous nous plaisions souvent à les voir,
dans les profondeurs des cascades qu’offre cette île , tournoyer en
faisant entendre leur voix criarde; la blancheur de leur plumage
contrastoit admirablement bien avec la teinte noirâtre des rochers
volcaniques. Le même spectacle nous a été offert sur l’île Bourbon ,
sur-tout auprès de la ville de Saint-Paul. Les jeunes, encore dans
le nid, ramassés en boule et couverts d’un duvet d’une éclatante
blancheur, ressemblent parfaitement à des houppes à poudrer,
en duvet de cygne.
Ces oiseaux ont une manière de voler qui leur est particulière.
Ils semblent, par leur tremblement, être épuisés de fatigue et toujours
sur le point de tomber. Quelquefois ils planent, mais rarement.
Ils s’abattent de très-haut, en s’abandonant à l’impulsion de