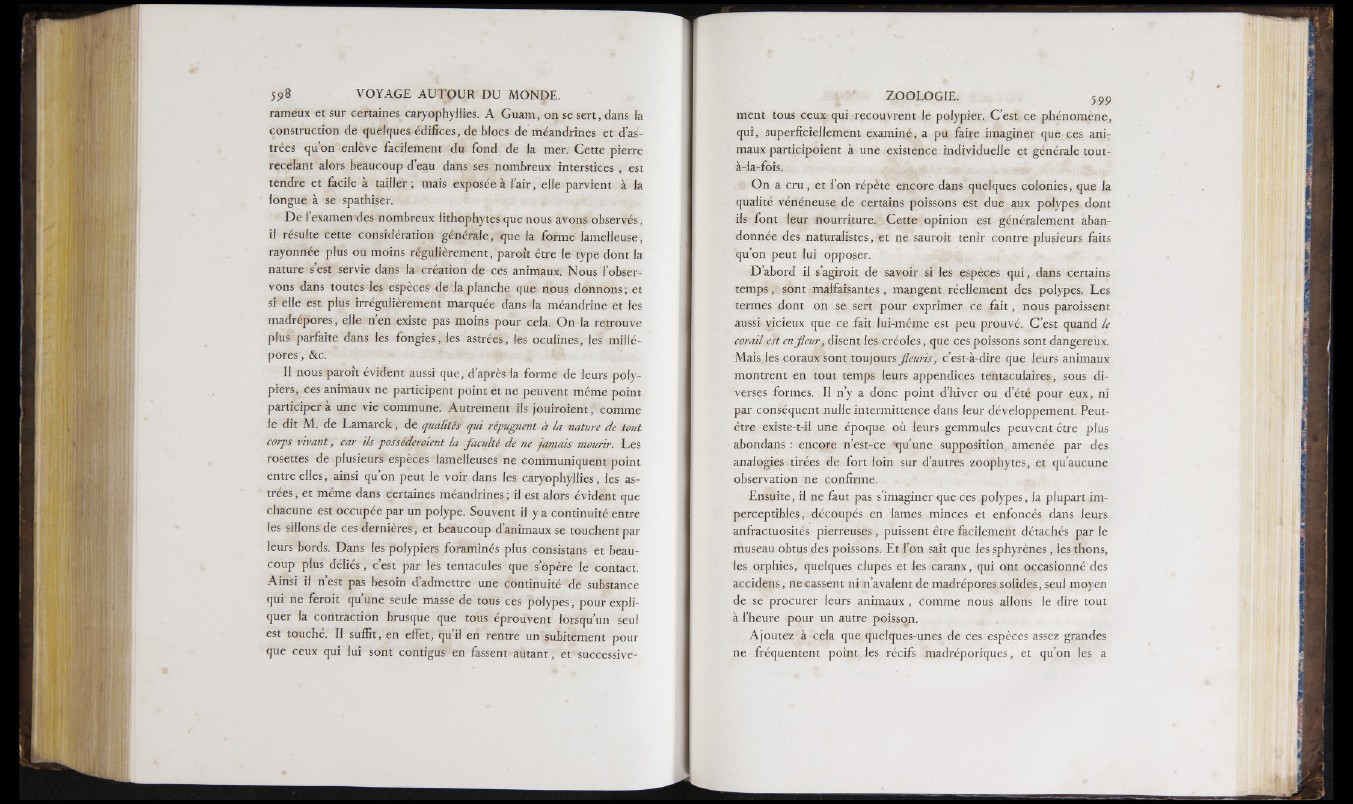
rameux et sur certaines caryophyJlies. A Guam, on se sert, clans la
construction de quelques édifices, de hlocs de méandrines et d’as-
trées qu’on enlève facilement du fond de Ja mer. Cette pierre
recelant alors beaucoup d’eau dans ses nombreux interstices , est
tendre et facile à tailler ; mais exposée à l’a ir, elle parvient à la
longue à se spathiser.
De l’examen des nombreux lithophytes que nous avons observés,
il résulte cette considération générale, que la forme lamelleuse,
rayonnée plus ou moins régulièrement, paroît être le type dont la
nature s’est servie dans la création de ces animaux. Nous l’observons
dans toutes les espèces de la planche que nous donnons; et
si elle est plus irrégulièrement marquée dans la méandrine et Jes
madrépores, elle n’en existe pas moins pour cela. On Ja retrouve
plus parfaite dans les fongies, ies astrées, les oculines, les miJJé-
pores, &c.
Il nous paroît évident aussi que, d’après la forme de leurs polypiers,
ces animaux ne participent point et ne peuvent même point
participer à une vie commune. Autrement ils jouiroient, comme
Je dit M. de Lamarck, de qualités qui répugnent à la nature de tout
corps vivant, car ils posséderaient la faculté de ne jamais mourir. Les
rosettes de plusieurs espèces lamelleuses ne communiquent point
entre elles, ainsi qu’on peut Je voir dans ies caryophyllies, les astrées,
et même dans certaines méandrines; il est alors évident que
chacune est occupée par un polype. Souvent il y a continuité entre
les sillons de ces dernières, et beaucoup d’animaux se touchent par
leurs bords. Dans les polypiers foraminés plus consistans et heaucoup
plus déliés, c’est par les tentacules que s’opère le contact.
Ainsi il n’est pas besoin d’admettre une continuité de substance
qui ne feroit qu’une seule masse de tous ces polypes, pour expliquer
la contraction brusque que tous éprouvent lorsqu’un seul
est touché. Il suffit, en effet, qu’il en rentre un subitement pour
que ceux qui lui sont contigus en fassent autant, et successivement
tous ceux qui recouvrent le polypier. C ’est ce phénomène,
qui, superficiellement examiné, a pu faire imaginer que ces animaux
participoient à une existence individuelle et générale tout-
à-la-fois.
On a cru, et l’on répète encore dans quelques colonies, que Ja
qualité vénéneuse de certains poissons est due aux polypes dont
ils font leur nourriture. Cette opinion est généralement abandonnée
des naturalistes, et ne sauroit tenir contre plusieurs faits
qu’on peut lui opposer.
D ’abord il s’agiroit de savoir si les espèces qui, dans certains
temps, sont malfaisantes, mangent réellement des polypes. Les
termes dont on se sert pour exprimer ce f a i t , nous paroissent
aussi vicieux que ce fait lui-méme est peu prouvé. C ’est quand le
corail est en fleur, disent les créoles, que ces poissons sont dangereux.
Mais les coraux sont toujours^cz/m, c’est-à-dire que leurs animaux
montrent en tout temps leurs appendices tentaculaires, sous diverses
formes. Il n’y a donc point d’hiver ou d’été pour eux, ni
par conséquent nulle intermittence dans leur développement. Peut-
être existe-t-il une époque où leurs gemmules peuvent être plus
abondans : encore n’est-ce qu’une supposition amenée par des
analogies tirées de fort loin sur d’autres zoophytes, et qu’aucune
observation ne confirme.
Ensuite, il ne faut pas s’imaginer que ces polypes, Ja plupart imperceptibles,
découpés en lames minces et enfoncés dans leurs
anfractuosités pierreuses, puissent être facilement détachés par le
museau obtus des poissons. Et l’on sait que les sphyrènes, les thons,
les orphies, quelques clupes et les caranx, qui ont occasionné des
accidens, ne cassent ni n’avalent de madrépores solides, seul moyen
de se procurer leurs animaux , comme nous allons Je dire tout
à l’heure pour un autre poisson.
Ajoutez à cela que quelques-unes de ces espèces assez grandes
ne fréquentent point les récifs madréporiques, et qu’on les a