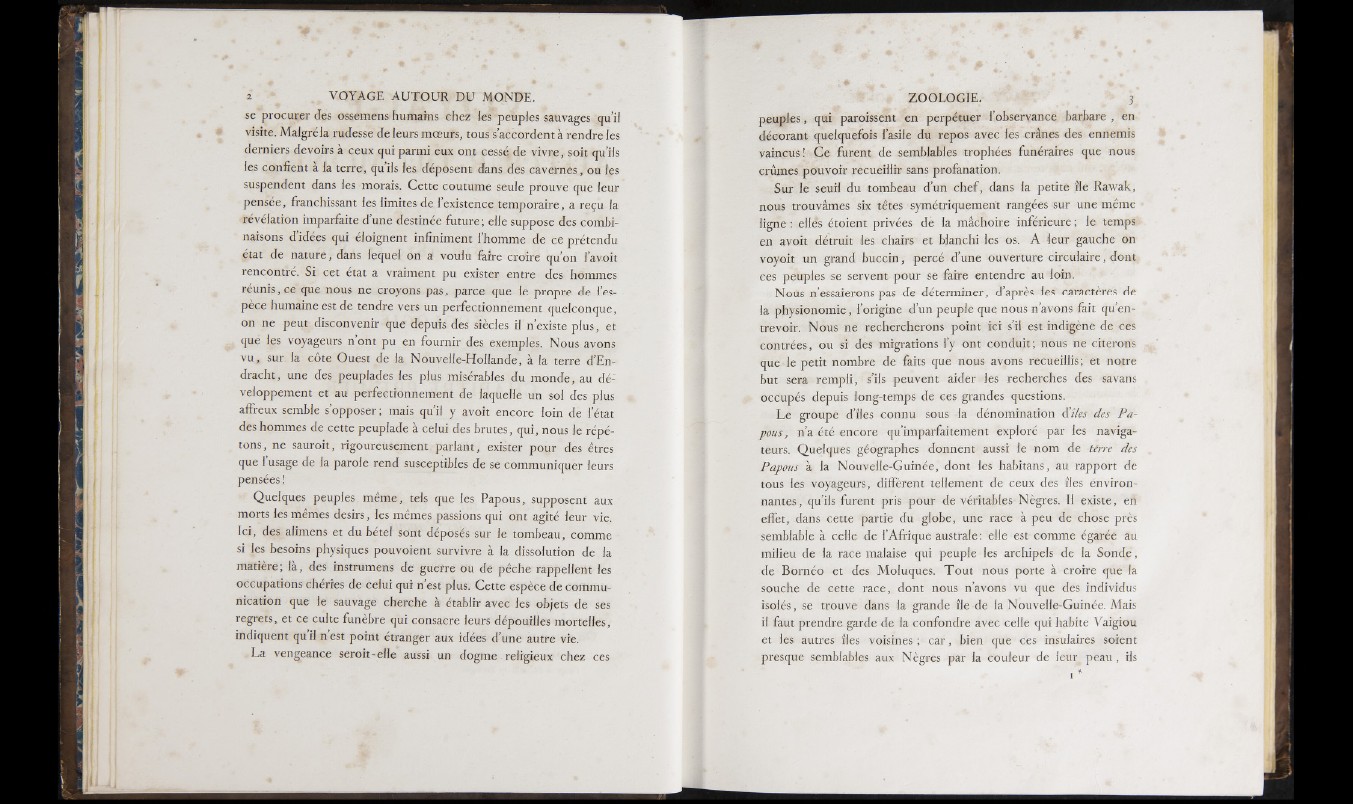
se procurer des ossemens humains chez les peuples sauvages qu’il
visite. Malgré la rudesse de leurs moeurs, tous s’accordent à rendre les
derniers devoirs à ceux qui parmi eux ont cessé de vivre, soit qu’ils
les confient à la terre, qu’ils les déposent dans des cavernes, ou les
suspendent dans les moráis. Cette coutume seule prouve que leur
pensée, franchissant les limites de l’existence temporaire, a reçu la
révélation imparfaite d une destinée future; elle suppose des combinaisons
d’idées qui éloignent infiniment l’homme de ce prétendu
état de nature, dans lequel on a voulu faire croire qu’on l’avoit
rencontre. Si cet état a vraiment pu exister entre des hommes
réunis, ce que nous ne croyons pas, parce que le propre de l’espèce
humaine est de tendre vers un perfectionnement quelconque,
on ne peut disconvenir que depuis des siècles il n’existe plus, et
que les voyageurs n’ont pu en fournir des exemples. Nous avons
vu , sur la côte Ouest de la Nouvelle-Hollande, à la terre d’En-
dracht, une des peuplades les plus misérables du monde, au développement
et au perfectionnement de laquelle un sol des plus
affreux semble s’opposer ; mais qu’il y avoir encore loin de l’état
des hommes de cette peuplade à celui des brutes, qui, nous le répétons,
ne sauroit, rigoureusement parlant, exister pour des êtres
que l’usage de la parole rend susceptibles de se communiquer leurs
pensées !
Quelques peuples même, tels que les Papous, supposent aux
morts les mêmes désirs, les mêmes passions qui ont agité leur vie.
Ici, des alimens et du bétel sont déposés sur le tombeau, coimne
si les besoins physiques pouvoient survivre à la dissolution de la
matière; la, des instrumens de guerre ou de pêche rappellent les
occupations chéries de celui qui n’est plus. Cette espèce de communication
que le sauvage cherche à établir avec les objets de ses
regrets, et ce culte funèbre qui consacre leurs dépouilles mortelles,
indiquent qu il n est point étranger aux idées d’une autre vie.
L a vengeance seroit-elle aussi un dogme religieux chez ces
peuples, qui paroissent en perpétuer l’observance barbare , en
décorant quelquefois l’asile du repos avec les crânes des ennemis
vaincus î Ce furent de semblables trophées funéraires que nous
crûmes pouvoir recueillir sans profanation.
Sur le seuil du tombeau d’un chef, dans la petite île Rawak,
nous trouvâmes six têtes symétriquement rangées sur une même
ligne : elles étoient privées de la mâchoire inférieure ; le temps
en avoit détruit les chairs et blanchi les os. A leur gauche on
voyoit un grand buccin, percé d’une ouverture circulaire, dont
ces peuples se servent pour se faire entendre au loin.
Nous n’essaierons pas de déterminer, d’après les caractères de
la physionomie, l’origine d’un peuple que nous n’avons fait qu’entrevoir.
Nous ne rechercherons point ici s’il est indigène de ces
contrées, ou si des migrations l’y ont conduit; nous ne citerons
que le petit nombre de faits que nous avons recueillis; et notre
but sera rempli, s’ils peuvent aider les recherches des savans
occupés depuis long-temps de ces grandes questions.
L e groupe d’îles connu sous la dénomination &îles des P a pous,
n’a été encore qu’imparfaitement exploré par les navigateurs.
Quelques géographes donnent aussi le nom de terre des
Papous à la Nouvelle-Guinée, dont les habitans, au rapport de
tous les voyageurs, diffèrent tellement de ceux des îles environnantes,
qu’ils furent pris pour de véritables Nègres. 11 existe, en
effet, dans cette partie du globe, une race à peu de chose près
semblable à celle de l’A frique australe; elle est comme égarée au
milieu de la race malaise qui peuple les archipels de la Son de,
de Bornéo et des Moluques. Tout nous porte à croire que la
souche de cette race, dont nous n’avons vu que des individus
isolés, se trouve dans la grande île de la Nouvelle-Guinée. Mais
il faut prendre garde de la confondre avec celle qui habite Vaigiou
et les autres îles voisines; c a r, bien que ces insulaires soient
presque semblables aux Nègres par la couleur de leur peau , ils