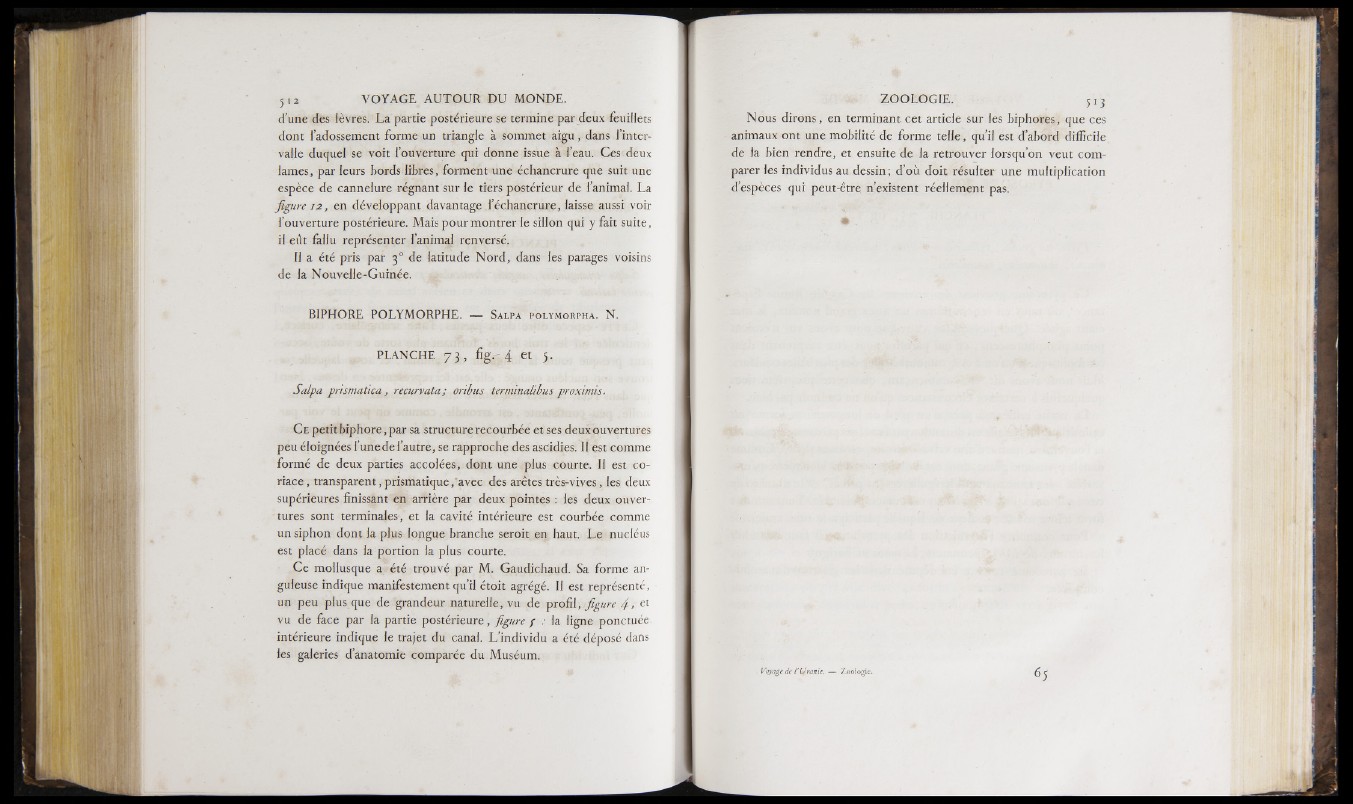
d’une des lèvres. La partie postérieure se termine par deux feuillets
dont l’adossement forme un triangle à sommet aigu, dans l’intervalle
duquel se voit l’ouverture qui donne issue à l’eau. Ces deux
lames, par leurs bords libres, forment une échancrure que suit une
espèce de cannelure régnant sur le tiers postérieur de l’animal. La
figure 1 2 , en développant davantage l’échancrure, laisse aussi voir
l’ouverture postérieure. Mais pour montrer le sillon qui y fait suite,
il eut fallu représenter l’animal renversé.
Il a été pris par 3° de latitude Nord, dans les parages voisins
de la Nouvelle-Cuinée.
BIPHORE POLYMORPHE. — S a l p a p o l y m o r p h a . N.
PLANCHE 7 3 , figv- 4 e t 5.
Salpa prismatica, recurvata; oribus terminalibus proximis.
Ce petit biphore, par sa structure recourbée et ses deux ouvertures
peu éloignées l’une de l’autre, se rapproche des ascidies. Il est comme
formé de deux parties accolées, dont une plus courte. Il est coriace
, transparent, prismatique, avec des arêtes très-vives, les deux
supérieures finissant en arrière par deux pointes : les deux ouvertures
sont terminales, et la cavité intérieure est courbée comme
un siphon dont la plus longue branche seroit en haut. Le nucléus
est placé dans la portion la plus courte.
Ce mollusque a été trouvé par M. Caudichaud. Sa forme anguleuse
indique manifestement qu’il étoit agrégé. Il est représenté,
un peu plus que de grandeur naturelle, vu de profil, figure 4> e*
vu de face par la partie postérieure, figure / ,■ la ligne ponctuée
intérieure indique le trajet du canal. L’individu a été déposé dans
les galeries d’anatomie comparée du Muséum.
Nous dirons, en terminant cet article sur les hiphores, que ces
animaux ont une mobilité de forme telle, qu’il est d’abord difficile
de ia bien rendre, et ensuite de la retrouver lorsqu’on veut comparer
les individus au dessin; d’où doit résulter une multiplication
d’espèces qui peut-être n’existent réellement pas.
%
I J
J