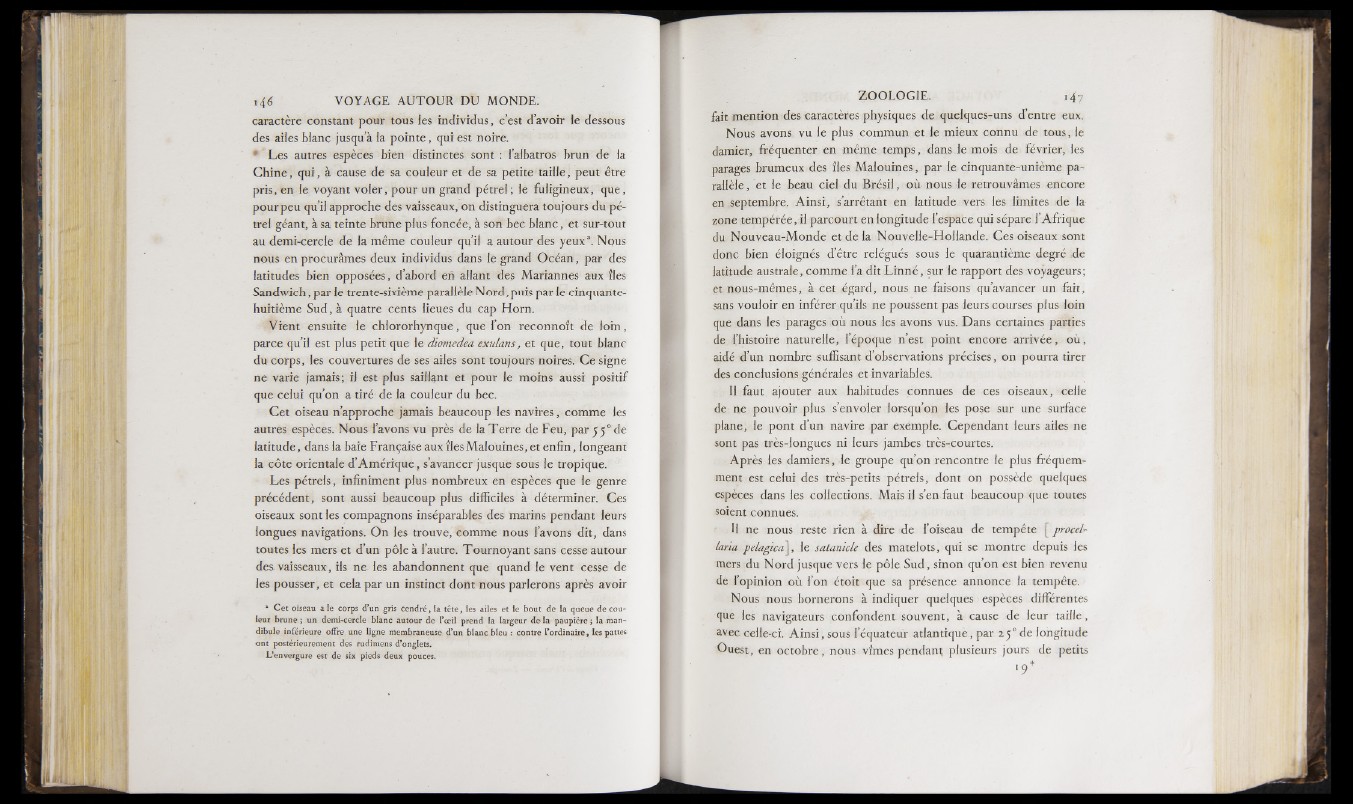
, 4 6 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
caractère constant pour tous les individus, c’est d’avoir le dessous
des ailes blanc jusqu’à la pointe, qui est noire.
Les autres espèces bien distinctes sont : l’albatros brun de la
Chine, qui, à cause de sa couleur et de sa petite taille, peut être
pris, en le voyant voler, pour un grand pétrel; le fuligineux, que,
pour peu qu’il approche des vaisseaux, on distinguera toujours du pétrel
géant, à sa teinte brune plus foncée, à son bec blanc, et sur-tout
au demi-cercle de la même couleur qu’il a autour des yeux*. Nous
nous en procurâ,nes deux individus dans le grand Océan, par des
latitudes bien opposées, d’abord en allant des Mariannes aux îles
Sandwich, par 1e trente-sixième parallèle Nord, puis par le cinquante-
huitiè,ne Sud, à quatre cents lieues du cap Horn.
Vient ensuite ie chlororhynque, que l’on reconnoît de lo in ,
parce qu’il est plus petit que le diomedea exulans, et que, tout blanc
du corps, les couvertures de ses ailes sont toujours noires. Ce signe
ne varie jamais; ii est plus saillant et pour le moins aussi positif
que celui qu’on a tiré de la couleur du bec.
Cet oiseau n’approche jamais beaucoup les navires, comme les
autres espèces. Nous l’avons vu près de la Terre de Feu, par 5 5° de
latitude, dans la baie Française aux îles Malouines, et enfin, longeant
la côte orientale d’Amérique, s’avancer jusque sous le tropique.
Les pétrels, infiniment plus no,nbreux en espèces que le genre
précédent, sont aussi beaucoup plus difficiles à déterminer. Ces
oiseaux sont les compagnons inséparables des marins pendant leurs
longues navigations. On ies trouve, co,n,ne nous l’avons dit, dans
toutes les mers et d’un pôle à l’autre. Tournoyant sans cesse autour
des vaisseaux, ils ne les abandonnent que quand le vent cesse de
les pousser, et cela par un instinct dont nous parlerons après avoir
* C e t oiseau a le corps d’ un gris cendré, la tê te , íes ailes et le bout de la queue de couleur
brune ; un demi-cercle blanc autour de Toeil prend la largeur d e !a paupière ; la mandibule
inférieure offre une ligne membraneuse d’un blanc bleu : contre l’ ordinaire, les patte«
ont postérieurement des rudimens d’onglets.
L ’envergure est de six pieds deux pouces.
fait mention des caractères physiques de quelques-uns d’entre eux.
Nous avons vu le plus commun et le mieux connu de tous, le
damier, fréquenter en même temps, dans le mois de février, les
parages brumeux des îles Malouines, par le cinquante-unième parallèle,
et ie beau ciel du Brésil, où nous le retrouvâmes encore
en septembre. Ainsi, s’arrêtant en latitude vers les limites de la
zone tempérée, il parcourt en longitude f espace qui sépare l’A frique
du Nouveau-Monde et de la Nouvelle-Hollande. Ces oiseaux sont
donc bien éloignés d’être relégués sous le quarantième degré de
latitude australe, comme l’a dit Lin n é , sur le rapport des voyageurs;
et nous-mêmes, à cet égard, nous ne faisons qu’avancer un fait,
sans vouloir en inférer qu’ils ne poussent pas leurs courses plus loin
que dans les parages où nous les avons vus. Dans certaines parties
de fhistoire naturelle, l’époque n’est point encore arrivée, où,
aidé d’un nombre suffisant d’observations précises, on pourra tirer
des conclusions générales et invariables.
Il faut ajouter aux habitudes connues de ces oiseaux, celle
de ne pouvoir plus s’envoler lorsqu’on les pose sur une surface
plane, le pont d’un navire par exemple. Cependant leurs ailes ne
sont pas très-longues ni leurs jambes très-courtes.
Après les damiers, le groupe qu’on rencontre le plus fréquemment
est celui des très-petits pétrels, dont on possède quelques
espèces dans les collections. Mais il s’en faut beaucoup que toutes
soient connues.
Il ne nous reste rien à dire de l’oiseau de tempête [ procellaria
pelagica\, le satanicle des matelots, qui se montre depuis ies
mers du Nord jusque vers le pôle Sud, sinon qu’on est bien revenu
de l’opinion où l’on étoit que sa présence annonce la tempête.
Nous nous bornerons à indiquer quelques espèces différentes
que les navigateurs confondent souvent, à cause de leur taille,
avec celle-ci. Ainsi,sous l’équateur atlantique, par i5 °d e longitude
Ouest, en octobre, nous vîmes pendant plusieurs jours de petits