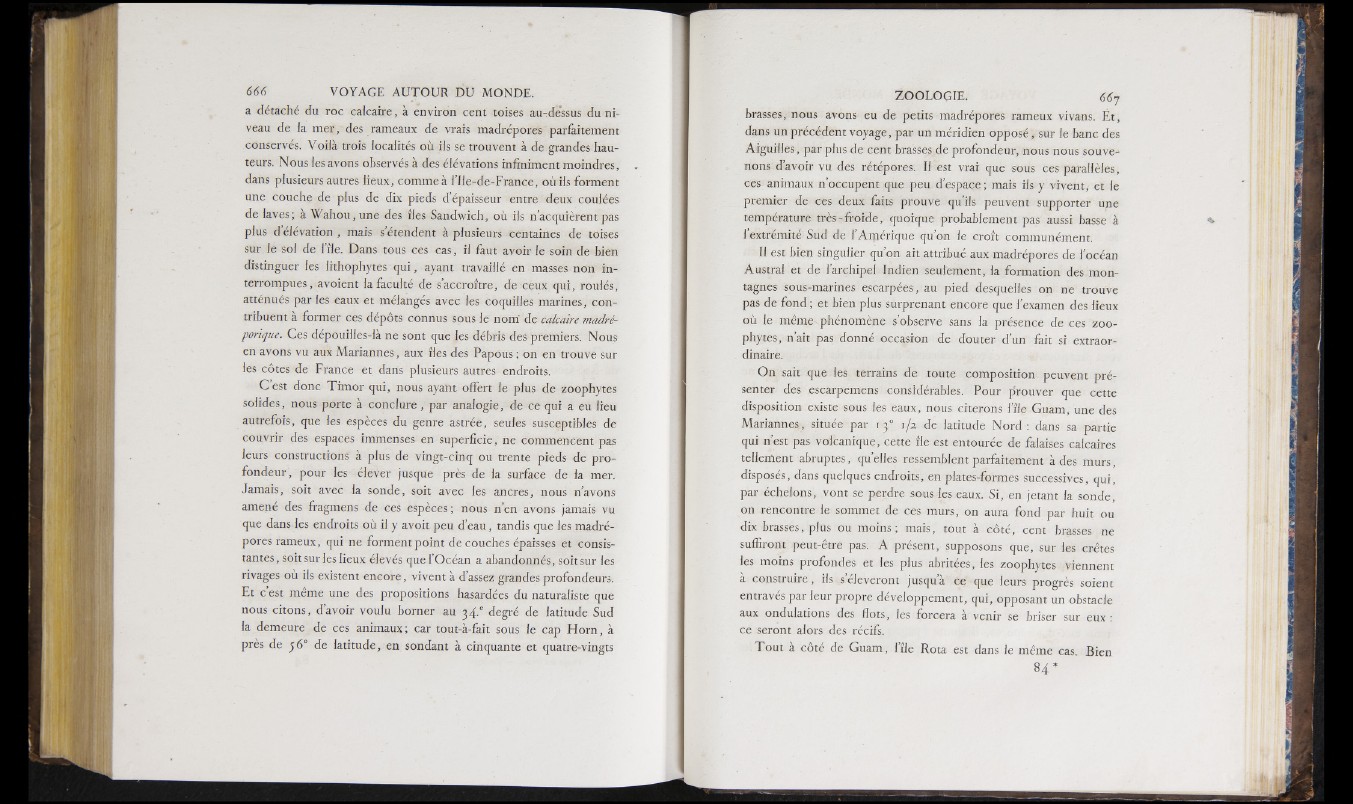
a détaché du roc calcaire, à environ cent toises au-dessus du niveau
de la mer, des rameaux de vrais madrépores parfaitement
conservés. Voilà trois localités où ils se trouvent à de grandes hauteurs,
Nous les avons observés à des élévations infiniment moindres,
dans plusieurs autres lieux, comme à l’Ile-de-France, où ils forment
une couche de plus de dix pieds d’épaisseur entre deux coulées
de laves; à Wahou, une des îles Sandwich, où ils n’acquièrent pas
plus d’élévation , mais s’étendent à plusieurs centaines de toises
sur Je sol de l’île. Dans tous ces cas, il faut avoir le soin de Lien
distinguer les lithophytes q u i, ayant travaillé en masses non interrompues,
avoient la faculté de s’accroître, de ceux qui, roulés,
atténués par les eaux et mélangés avec Jes coquilles marines, contribuent
à former ces dépôts connus sous le nom' de calcaire madréporique.
Ces dépouilles-là ne sont que ies débris des premiers. Nous
en avons vu aux Mariannes, aux îles des Papous; on en trouve sur
les côtes de France et dans plusieurs autres endroits.
C est donc Timor qui, nous ayant offert le plus de zoophytes
solides, nous porte à conclure , par analogie, de ce qui a eu lieu
autrefois, que les espèces du genre astrée, seules susceptibles de
couvrir des espaces immenses en superficie, ne commencent pas
leurs constructions à plus de vingt-cinq ou trente pieds de profondeur,
pour les élever jusque près de la surface de la mer.
Jamais, soit avec la sonde, soit avec les ancres, nous n’avons
amené des fragmens de ces espèces ; nous n’en avons jamais vu
que dans les endroits où il y avoit peu d’e au, tandis que les madrépores
rameux, qui ne forment point de couches épaisses et consistantes,
soit sur les lieux élevés que fOcéan a abandonnés, soitsur les
rivages où ils existent encore, vivent à d’assez grandes profondeurs.
Et c’est même une des propositions hasardées du naturaliste que
nous citons, d’avoir voulu borner au 34.° degré de latitude Sud
la demeure de ces animaux; car tout-à-fait sous le cap Horn, à
près de 56° de latitude, en sondant à cinquante et quatre-vingts
brasses, nous avons eu de petits madrépores rameux vivans. E t,
dans un précédent voyage, par un méridien opposé, sur le banc des
Aiguilles, par plus de cent brasses de profondeur, nous nous souvenons
d’avoir vu des rétépores. Il est vrai que sous ces parallèles,
ces animaux n’occupent que peu d’espace ; mais ils y vivent, et le
premier de ces deux faits prouve qu’ils peuvent supporter une
température très-froide, quoique probablement pas aussi basse à
l’extrémité Sud de l’Amérique qu’on ie croît communément.
Il est bien singulier qu’on ait attribué aux madrépores de l’océan
Austral et de l’archipel Indien seulement, la formation des montagnes
sous-marines escarpées, au pied desquelles on ne trouve
pas de fond ; et Lien plus surprenant encore que l’examen des lieux
où le même phénomène s’observe sans la présence de ces zoophytes,
n’ait pas donné occasion de douter d’un fait si extraordinaire.
On sait que ies terrains de toute composition peuvent présenter
des escarpemens considérables. Pour prouver que cette
disposition existe sous les eaux, nous citerons i’île Guam, une des
Mariannes, située par 13 ° 1/2 de latitude Nord : dans sa partie
qui n’est pas volcanique, cette île est entourée de falaises calcaires
tellement abruptes, qu’elles ressemblent parfaitement à des murs,
disposés, dans quelques endroits, en plates-formes successives, qui,
par échelons, vont se perdre sous les eaux. Si, en jetant Ja sonde,
on rencontre le sommet de ces murs, on aura fond par huit ou
dix brasses, plus ou moins; mais, tout à côté, cent brasses ne
suffiront peut-être pas, A présent, supposons que, sur les crêtes
les moins profondes et les plus abritées, les zoophytes viennent
à construire, ils s’élèveront jusqu’à ce que leurs progrès soient
entravés par leur propre développement, qui, opposant un obstacle
aux ondulations des flots, ies forcera à venir se briser sur eux :
ce seront alors des récifs.
Tout à côté de Guam, l’île Rota est dans le même cas. Bien