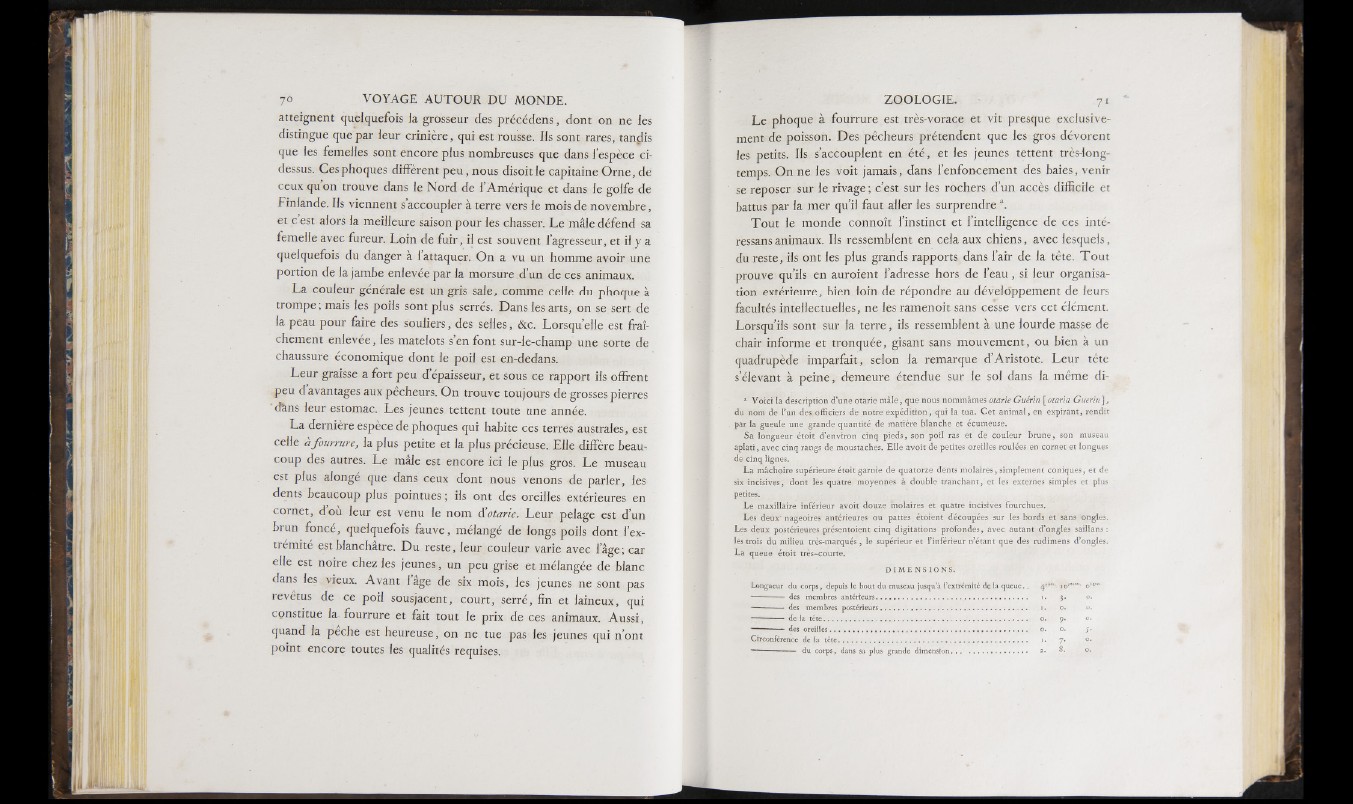
atteignent quelquefois ia grosseur des précédens, dont on ne les
distingue que par leur crinière, qui est rousse. Ils sont rares, tandis
que les femelles sont encore plus nombreuses que dans l’espèce ci-
dessus. Ces phoques diffèrent peu, nous disoit le capitaine Orne, de
ceux quon trouve dans le Nord de l’Amérique et dans le golfe de
Finlande. Ils viennent s’accoupler à terre vers le mois de novembre,
et c est alors la meilleure saison pour les chasser. L e mâle défend sa
femelle avec fureur. Loin de fuir, il est souvent l’agresseur, et il y a
quelquefois du danger à 1 attaquer. On a vu un homme avoir une
portion de la jambe enlevée par Ja morsure d’un de ces animaux.
L a couleur générale est un gris sale, comme celle du phoque à
trompe; mais les poils sont plus serrés. Dans les arts, on se sert de
la peau pour faire des souliers, des selles, &c. Lorsqu’elle est fraîchement
enlevée, les matelots s’en font sur-le-champ une sorte de
chaussure économique dont le poiJ est en-dedans.
Leur graisse a fort peu d’épaisseur, et sous ce rapport ils offrent
peu d’avantages aux pécheurs. On trouve toujours de grosses pierres
dans leur estomac. Les jeunes tettent toute une année.
L a dernière espèce de phoques qui habite ces terres australes, est
celle à fourrure, la plus petite et la plus précieuse. Elle diffère heaucoup
des autres. L e mâle est encore ici le plus gros. L e museau
est plus alongé que dans ceux dont nous venons de parler, les
dents beaucoup plus pointues ; ils ont des oreilles extérieures en
cornet, dou leur est venu le nom Éotarie. Leur pelage est d’un
brun foncé, quelquefois fauve, mélangé de longs poils dont l’ex-
trémite est blanchâtre. Du reste, leur couleur varie avec l’âge; car
elle est noire chez les jeunes, un peu grise et mélangée de blanc
dans les vieux. Avant l’âge de six mois, les jeunes ne sont pas
levétus de ce poil sousjacent, court, serré, fin et laineux, qui
constitue Ja fourrure et fait tout le prix de ces animaux. Aussi,
quand la pèche est heureuse, on ne tue pas les jeunes qui n’ont
point encore toutes les qualités requises.
L e phoque à fourrure est très-vorace et vit presque exclusivement
de poisson. Des pêcheurs prétendent que les gros dévorent
Jes petits. Ils s’accouplent en été, et les jeunes tettent très-longtemps.
On ne les voit jamais, dans l’enfoncement des haies, venir
se reposer sur le rivage ; c’est sur les rochers d’un accès difficile et
battus par la mer qu’il faut aller les surprendre *.
Tout le monde connoît l’instinct et l’intelligence de ces inté-
ressans animaux. Ils ressemblent en cela aux chiens, avec lesquels,
du reste, ils ont les plus grands rapports dans l’air de la tête. Tout
prouve qu’ils en auroient l’adresse hors de l’e au , si leur organisation
extérieure, bien loin de répondre au développement de leurs
facultés intellectuelles, ne les ramenoit sans cesse vers cet élément.
Lorsqu’ils sont sur la terre, ils ressemblent à une lourde masse de
chair informe et tronquée, gisant sans mouvement, ou bien à un
quadrupède imparfait, selon la remarque d’Aristote. Leur téte
s’élevant à peine, demeure étendue sur le sol dans la même di-
^ V oic i la description d’une otarie m â le , que nous nommâmes otarie Guérin \ otaria Giierin'\,
du nom de l’un des officiers de notre e xpédition, qui ia tua. C e t anim a l, en expirant, rendit
par la gueule une grande quantité de matière blanche et écumeuse.
S a longueur étoit d’ environ cinq pieds, son poil ras et de couleur brune, son museau
aplati, avec cinq rangs de moustaches. E lle avoit de petites oreilles roulées en cornet et longues
de cinq lignes.
L a mâchoire supérieure étoit garnie de quatorze dents molaires, simplement coniques, et de
six incisives, dont les quatre moyennes à double tranchant, et les externes simples et plus
petites.
L e maxillaire inférieur avoit douze molaires et quatre incisives fourchues.
Les deux' nageoires antérieures ou pattes étoient découpées sur les bords et sans ongles.
Les deux postérieures présentoient cinq digitations profondes, avec autant d’ongles sailians :
les trois du milieu très-marqués, le supérieur et l’ inférieur n’étant que des rudimens d’ongles.
L a queue étoit trés-courte.
D I M E N S I O N S .
Longueur du corps, depuis le bout du museau jusqu’à l’extrémité de la queue.. V '“ ' 'o'’'’““ '- o*’**'’-
------------ des membres antérieurs...................................................................................
—--------- des membres postérieurs.......................... ..................................................
■---------— de la tète.............................. o
------------des oreilles...........................................................................................................
Circonférence de la tète......................................................... .........................................
--------------- du corps, dans sa plus grande dimension............................................