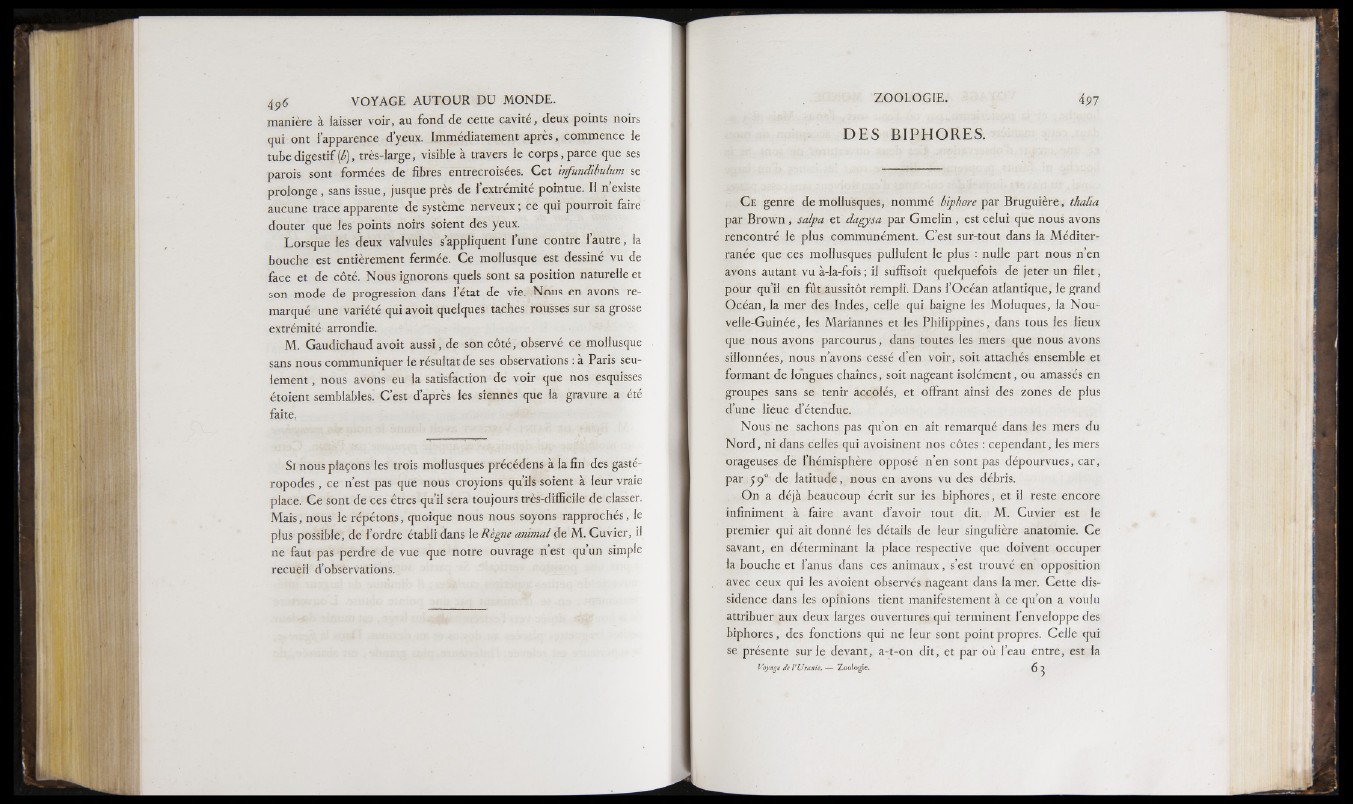
manière à laisser voir, au fond de cette cavité, deux points noirs
qui ont l’apparence d’yeux. Immédiatement après, commence le
tube digestif (i5), très-large, visible à travers le corps, parce que ses
parois sont formées de fibres entrecroisées. Cet infimdihulum se
prolonge, sans issue, jusque près de l’extrémité pointue. Il n’existe
aucune trace apparente de système nerveux ; ce qui pourroit faire
douter que les points noirs soient des yeux.
Lorsque les deux valvules s’appliquent l’une contre l’autre, la
bouche est entièrement fermée. Ce mollusque est dessiné vu de
face et de côté. Nous ignorons quels sont sa position naturelle et
son mode de progression dans l’état de vie. Nous en avons remarqué
une variété qui avoit quelques taches rousses sur sa grosse
extrémité arrondie.
M. Gaudichaud avoit aussi, de son côté, observé ce mollusque
sans nous communiquer le résultat de ses observations ; à Paris seulement
, nous avons eu la satisfaction de voir que nos esquisses
étoient semblables. C’est d’après les siennes que la gravure a été
faite.
Si nous plaçons les trois mollusques précédens à la fin des gastéropodes
, ce n’est pas que nous croyions qu’ils soient à leur vraie
place. Ce sont de ces êtres qu’il sera toujours très-difficile de classer.
Mais, nous le répétons, quoique nous nous soyons rapprochés, le
plus possible, de l’ordre établi dans \e Règne animal de M. Cuvier, il
ne faut pas perdre de vue que notre ouvrage n est qu un simple
recueil d’observations.
D E S B I P H O R E S .
Ce genre de mollusques, nommé biphore par Bruguière, thalia
par Brown, salpa et dagysa par Gmelin , est celui que nous avons
rencontré le plus communément. C’est sur-tout dans la Méditerranée
que ces mollusques pullulent le plus : nulle part nous n’en
avons autant vu à-la-fois; il suffisoit quelquefois de jeter un filet,
pour qu’il en fût aussitôt rempli. Dans l’Océan atlantique, le grand
Océan, la mer des Indes, celle qui baigne les Moluques, la Nou-
velle-Guinée, les Mariannes et les Philippines, dans tous les lieux
que nous avons parcourus, dans toutes les mers que nous avons
sillonnées, nous n’avons cessé d’en voir, soit attachés ensemble et
formant de longues chaînes, soit nageant isolément, ou amassés en
groupes sans se tenir accolés, et offrant ainsi des zones de plus
d’une lieue d’étendue.
Nous ne sachons pas qu’on en ait remarqué dans les mers du
Nord, ni dans celles qui avoisinent nos côtes : cependant, les mers
orageuses de l’hémisphère opposé n’en sont pas dépourvues, car,
par 59° de latitude, nous en avons vu des débris.
On a déjà heaucoup écrit sur les biphores, et il reste encore
infiniment à faire avant d’avoir tout dit. M. Cuvier est le
premier qui ait donné les détails de leur singulière anatomie. Ce
savant, en déterminant la place respective que doivent occuper
la bouche et l’anus dans ces animaux, s’est trouvé en opposition
avec ceux qui les avoient observés nageant dans la mer. Cette dissidence
dans les opinions tient manifestement à ce qu’on a voulu
attribuer aux deux larges ouvertures qui terminent l’enveloppe des
biphores, des fonctions qui ne leur sont point propres. Celle qui
se présente sur le devant, a-t-on dit, et par où l’eau entre, est la
Voyage de l'Uranic. — Zoologie. ^