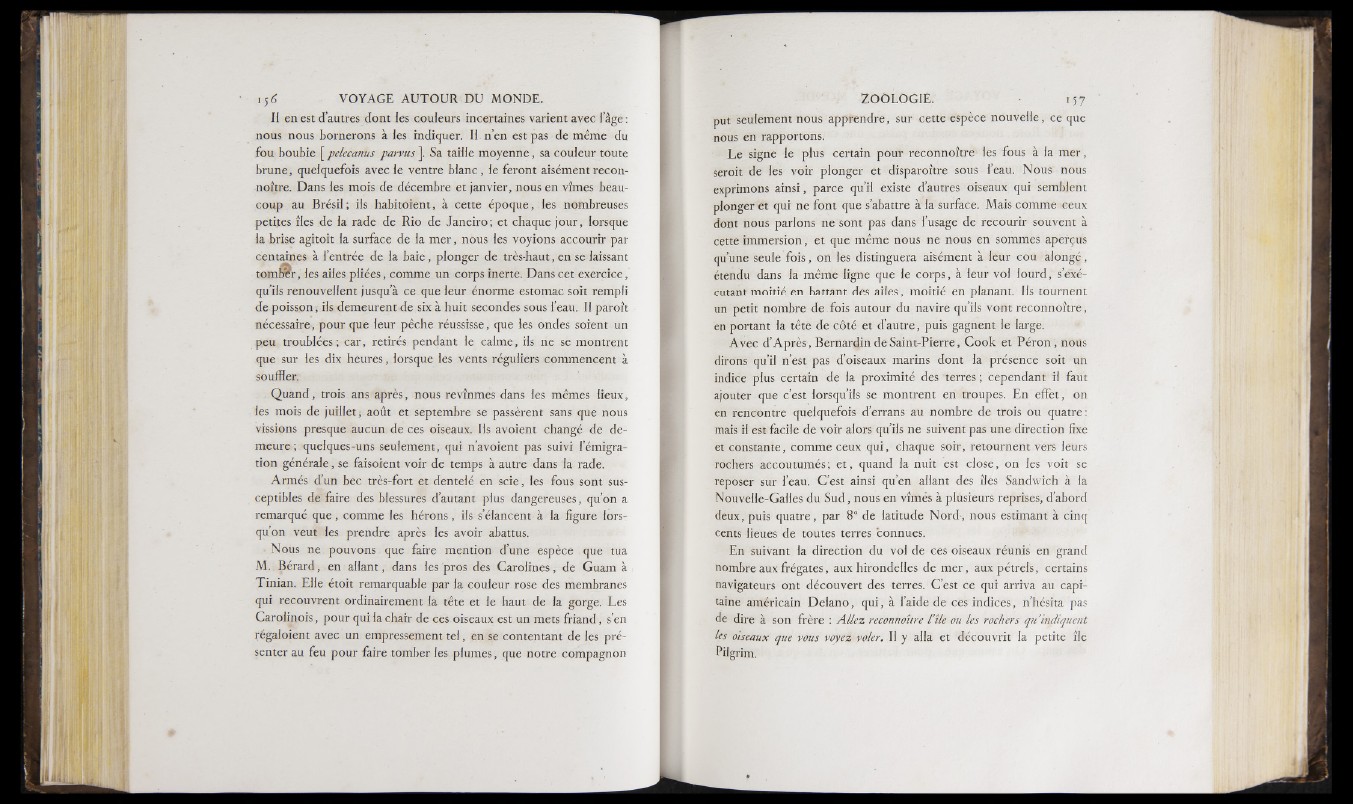
11 en est d’autres dont les couleurs incertaines varient avec l’âge :
nous nous bornerons à les indiquer. 11 n’en est pas de même du
fou boubie [ pelecanus parvus ]. Sa taille moyenne, sa couleur toute
brune, quelquefois avec le ventre blanc, le feront aisément reconnoître.
Dans les mois de décembre et janvier, nous en vîmes beaucoup
au Brésil; ils habitoient, à cette époque, les nombreuses
petites îles de la rade de Rio de Janeiro; et chaque jour, lorsque
la brise agitoit la surface de la m e r, nous les voyions accourir par
centaines à l’entrée de la baie, plonger de très-haut, en se laissant
tomber, les ailes pliées, comme un corps inerte. Dans cet exercice,
qu’ils renouvellent jusqu’à ce que leur énorme estomac soit rempli
de poisson, ils demeurent de six à huit secondes sous l’eau. 11 paroît
nécessaire, pour que leur pêche réussisse, que ies ondes soient un
peu troublées; car, retirés pendant le calme, ils ne se montrent
que sur les dix heures, lorsque les vents réguliers commencent à
souffler.
Quand, trois ans après, nous revînmes dans les mêmes lieux,
les mois de juillet, août et septembre se passèrent sans que nous
vissions presque aucun de ces oiseaux. Ils avoient changé de demeure
; quelques-uns seulement, qui n’avoient pas suivi l’émigra-
tion générale, se faisoient voir de temps à autre dans la rade.
Armés d’un bec très-fort et dentelé en scie, les fous sont susceptibles
de faire des blessures d’autant plus dangereuses, qu’on a
remarqué q u e , comme les hérons, ils s’élancent à la figure lorsqu’on
veut les prendre après les avoir abattus.
Nous ne pouvons que faire mention d’une espèce que tua
M. Bérard, en allant, dans les pros des Carolines, de Guam à
Tinian. Elle étoit remarquable par la couleur rose des membranes
qui recouvrent ordinairement la tête et le haut de ia gorge. Les
Carolinois, pour qui la chair de ces oiseaux est un mets friand, s’en
régaloient avec un empressement te l, en se contentant de les présenter
au feu pour faire tomber les plumes, que notre compagnon
put seulement nous apprendre, sur cette espèce nouvelle, ce que
nous en rapportons.
L e signe ie plus certain pour reconnoître les fous à la mer,
seroit de les voir plonger et disparoître sous l’eau. Nous nous
exprimons ainsi, parce qu’il existe d’autres oiseaux qui semblent
plonger et qui ne font que s’abattre à la surface. Mais comme ceux
dont nous parlons ne sont pas dans l’usage de recourir souvent à
cette immersion, et que même nous ne nous en sommes aperçus
qu’une seule fo is , on les distinguera aisément à leur cou alongé,
étendu dans la même ligne que le corps, à leur vol lourd, s’exécutant
moitié en battant des ailes, moitié en planant. Ils tournent
un petit nombre de fois autour du navire qu’ils vont reconnoître,
en portant la tête de côté et d’autre, puis gagnent le large.
Avec d’Après, Bernardin de Saint-Pierre, Cook et Péron, nous
dirons qu’il n’est pas d’oiseaux marins dont la présence soit un
indice plus certain de la proximité des terres ; cependant il faut
ajouter que c’est lorsqu’ils se montrent en troupes. En effet, on
en rencontre quelquefois d’errans au nombre de trois ou quatre :
mais il est facile de voir alors qu’ils ne suivent pas une direction fixe
et constante, comme ceux qui, chaque soir, retournent vers leurs
rochers accoutumés; e t, quand la nuit est close, on les voit se
reposer sur l’eau. C ’est ainsi qu’en allant des îles Sandwich à la
Nouvelle-Galles du Sud , nous en vîmés à plusieurs reprises, d’abord
deux, puis quatre, par 8° de latitude Nord, nous estimant à cinq
cents lieues de toutes terres connues.
En suivant la direction du vol de ces oiseaux réunis en grand
nombre aux frégates, aux hirondelles de mer, aux pétreis, certains
navigateurs ont découvert des terres. C ’est ce qui arriva au capitaine
américain Delano, qui, à l’aide de ces indices, n’hésita pas
de dire à son frère ; Allez reconnoître l ’île ou les rochers qu ’indiquent
les oiseaux que vous voyez voler. 11 y alla et découvrit la petite île
Pilgrim.