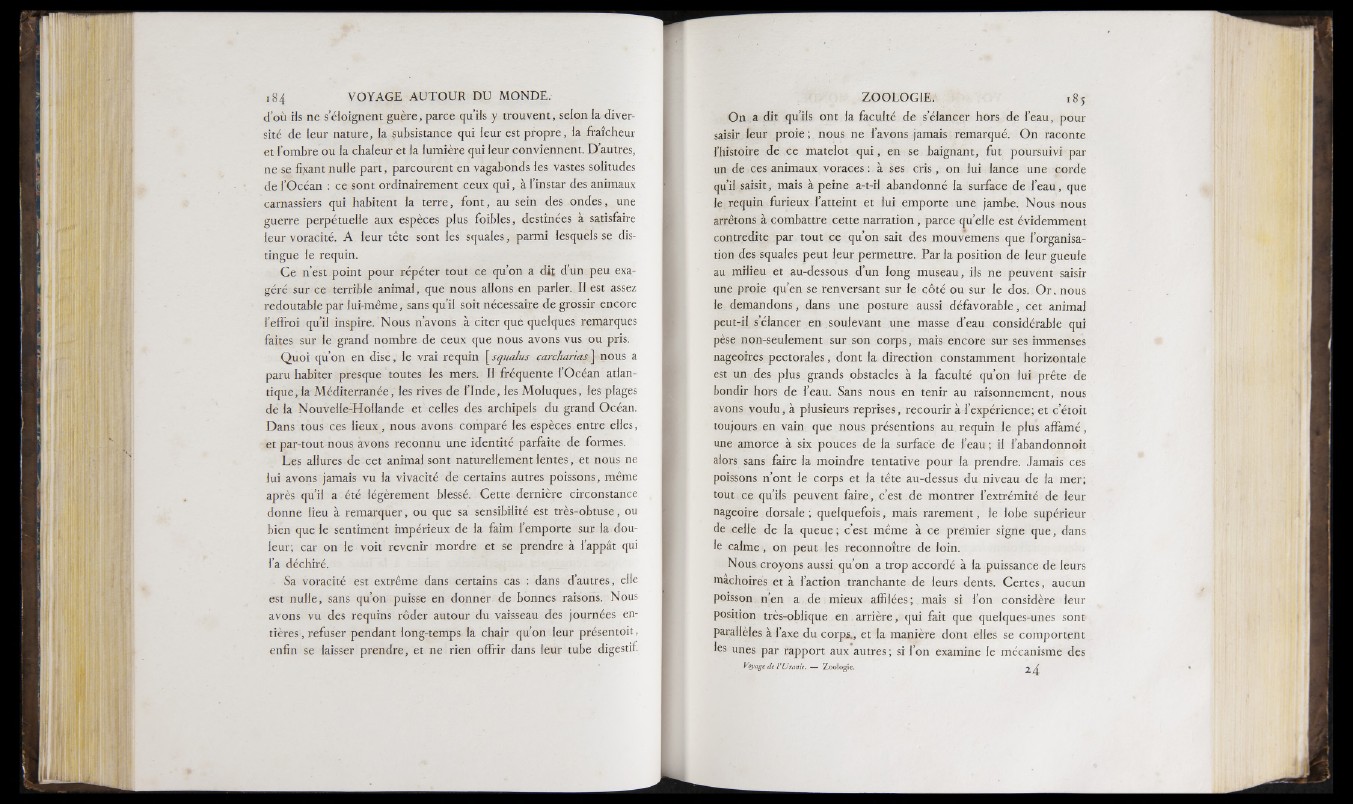
i 8 4 VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
d’où ils ne s’éloignent guère, parce qu’ils y trouvent, selon la diversité
de leur nature, la subsistance qui leur est propre, la fraîcheur
et l’ombre ou la chaleur et la lumière qui leur conviennent. D’autres,
ne se fixant nulle part, parcourent en vagabonds les vastes solitudes
de l’Océan : ce sont ordinairement ceux qui, à l’instar des animaux
carnassiers qui habitent la terre, font, au sein des ondes, une
guerre perpétuelle aux espèces plus foibles, destinées à satisfaire
leur voracité. A leur tête sont les squales, parmi lesquels se distingue
le requin.
Ce n’est point pour répéter tout ce qu’on a dit d’un peu exagéré
sur ce terrible animal, que nous allons en parler. Il est assez
redoutable par lui-même, sans qu’il soit nécessaire de grossir encore
l’effroi qu’il inspire. Nous n’avons à citer que quelques remarques
faites sur le grand nombre de ceux que nous avons vus ou pris.
Quoi qu’on en dise, le vrai requin [squalus carcharías^ nous a
paru habiter presque toutes les mers. Il fréquente fOcéan atlantique,
la Méditerranée, les rives de l’Inde, ies Moluques, les plages
de la Nouvelle-Hollande et celles des archipels du grand Océan.
Dans tous ces lieux , nous avons comparé les espèces entre elles,
et par-tout nous avons reconnu une identité parfaite de formes.
Les allures de cet animal sont naturellement lentes, et nous ne
lui avons jamais vu la vivacité de certains autres poissons, même
après qu’il a été légèrement blessé. Cette dernière circonstance
donne lieu à remarquer, ou que sa sensibilité est très-obtuse, ou
bien que le sentiment impérieux de la faim femporte sur la douleur;
car on le voit revenir mordre et se prendre à l’appât qui
l’a déchiré.
Sa voracité est extrême dans certains cas : dans d’autres, elle
est nulle, sans qu’on puisse en donner de bonnes raisons. Nous
avons vu des requins rôder autour du vaisseau des journées entières
, refuser pendant long-temps la chair qu’on leur présentoit,
enfin se laisser prendre, et ne rien offrir dans leur tube digestif
On a dit qu’ils ont la faculté de s’élancer hors de l’eau, pour
saisir leur proie ; nous ne l’avons jamais remarqué. On raconte
l’histoire de ce matelot qui, en se baignant, fut poursuivi par
un de ces animaux voraces : à ses cris, on lui lance une corde
qu’il saisit, mais à peine a-t-il abandonné la surface de l’eau, que
le requin furieux l’atteint et lui emporte une jambe. Nous nous
arrêtons à combattre cette narration , parce qu’elle est évidemment
contredite par tout ce qu’on sait des mouvemens que l’organisation
des squales peut leur permettre. Par la position de leur gueule
au milieu et au-dessous d’un long museau, ils ne peuvent saisir
une proie qu’en se renversant sur le côté ou sur le dos. Or, nous
ie demandons, dans une posture aussi défavorable, cet animal
peut-il s’élancer en soulevant une masse d’eau considérable qui
pèse non-seulement sur son corps, mais encore sur ses immenses
nageoires pectorales, dont la direction constamment horizontale
est un des plus grands obstacles à la faculté qu’on lui prête de
bondir hors de l’eau. Sans nous en tenir au raisonnement, nous
avons voulu, à plusieurs reprises, recourir à l’expérience; et c’étoit
toujours en vain que nous présentions au requin le plus affamé,
une amorce à six pouces de la surface de l’eau ; il l’abandonnoit
alors sans faire la moindre tentative pour la prendre. Jamais ces
poissons n’ont le corps et la tête au-dessus du niveau de la mer;
tout ce qu’ils peuvent faire, c’est de montrer l’extrémité de leur
nageoire dorsale ; quelquefois, mais rarement, le lobe supérieur
de celle de la queue; c’est même à ce premier signe que, dans
le calme, on peut les reconnoître de loin.
Nous croyons aussi qu’on a trop accordé à la puissance de leurs
mâchoires et à l’action tranchante de leurs dents. Certes, aucun
poisson n’en a de mieux affilées; mais si l’on considère leur
position très-oblique en arrière, qui fait que quelques-unes sont
parallèles à l’axe du corps., et la manière dont elles se comportent
les unes par rapport aux autres ; si l’on examine le mécanisme des
Voyage de l'Uranie. — Zoologie. 2. ^
IIÍLT.