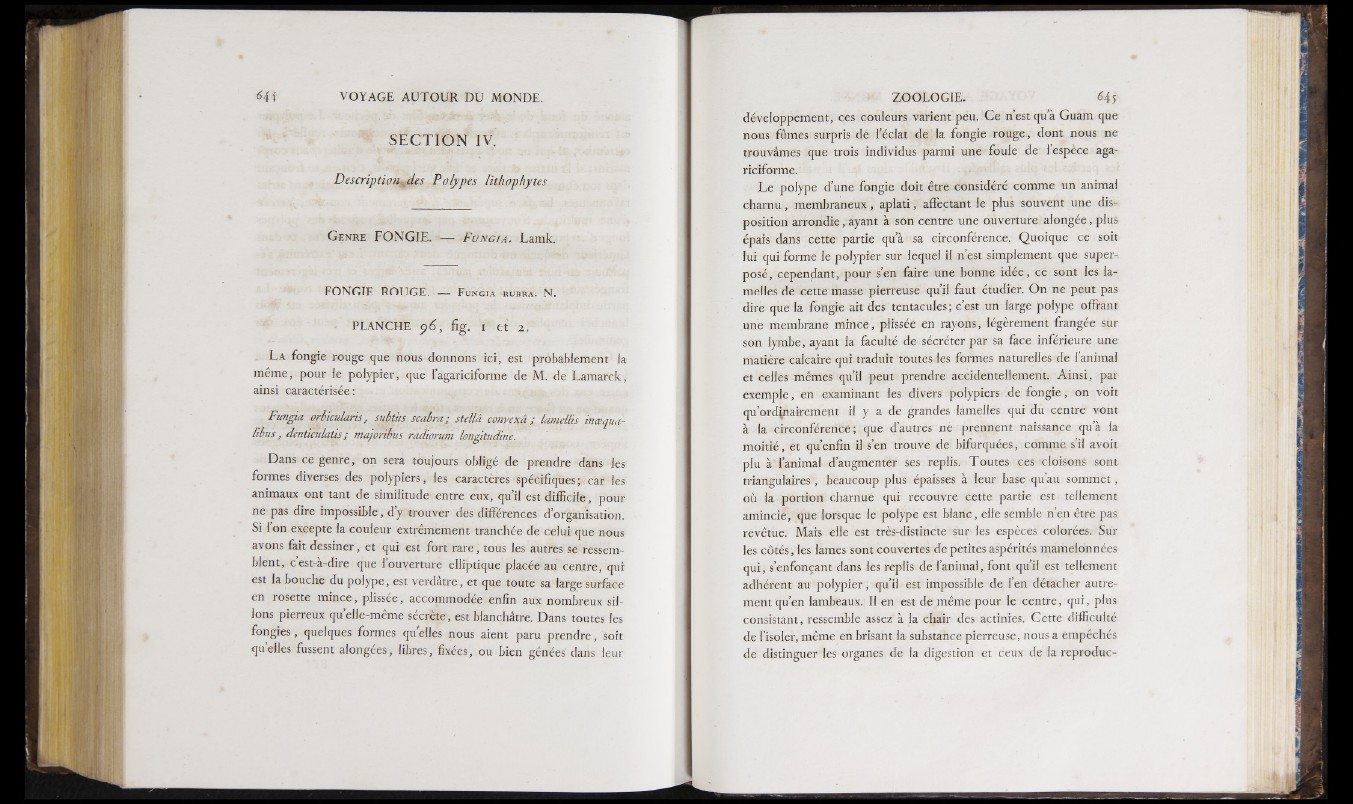
S E C T IO N IV.
Description des Polypes lithophytes
G e n r e FO N G IE . — F u n g i a . Lamk.
FONGIE ROUGE. — F u n g i a r u b r a . N.
PLANCHE 9 6 , fig. I ut 2,
L a fongie rouge que nous donnons ici, est probablement la
même, pour le polypier, que l’agariciforme de M. de Lamarck,
ainsi caractérisée :
Fungia orbicularis, subtùs scabra; stellâ convexâ ; lamellis inæqua-
libus, denticulatis; rnajoribus radlormn longitudine.
Dans ce genre, on sera toujours obligé de prendre dans les
formes diverses des polypiers, les caractères spécifiques; car les
animaux ont tant de similitude entre eux, qu’il est difficile, pour
ne pas dire impossible, d’y trouver des différences d’organisation.
Si l’on excepte la couleur extrêmement tranchée de celui que nous
avons fait dessiner, et qui est fort ra re , tous les autres se ressemblent,
c’est-à-dire que l’ouverture elliptique placée au centre, qui
est la bouche du polype, est verdâtre, et que toute sa large surface
en rosette mince, plissée, accommodée enfin aux nombreux sillons
pierreux qu’elle-méme sécrète, est blanchâtre. Dans toutes les
fongies, quelques formes qu elles nous aient paru prendre, soit
qu’elles fussent alongées, libres, fixées, ou bien gênées dans leur
ZOOLOGIE. 645
développement, ces couleurs varient peu. Ce n’est qu’à Guam que
nous fûmes surpris de l’éclat de la fongie rouge, dont nous ne
trouvâmes que trois individus parmi une foule de l’espèce aga-
riciforme.
L e polype d’une fongie doit être considéré comme un animal
charnu, membraneux, aplati, affectant le plus souvent une disposition
arrondie, ayant à son centre une ouverture alongée, plus
épais dans cette partie qu’à sa circonférence. Quoique ce soit
lui qui forme le polypier sur lequel il n’est simplement que superposé,
cependant, pour s’en faire une bonne idée, ce sont les lamelles
de cette masse pierreuse qu’il faut étudier. On ne peut pas
dire que la fongie ait des tentacules; c’est un large polype offrant
une membrane mince, plissée en rayons, légèrement frangée sur
son lymbe, ayant la faculté de sécréter par sa face inférieure une
matière calcaire qui traduit toutes les formes naturelles de l’animal
et celles mêmes qu’il peut prendre accidentellement. Ainsi, par
exemple, en examinant les divers polypiers de fon g ie , on voit
qu’ordinairement il y a de grandes lamelles qui du centre vont
à la circonférence; que d’autres ne prennent naissance qu’à la
moitié, et qu’enfin il s’en trouve de hifurquées, comme s’il avoit
plu à l’animal d’augmenter ses replis. Toutes ces cloisons sont
triangulaires, beaucoup plus épaisses à leur hase qu'au sommet,
où la portion charnue qui recouvre cette partie est tellement
amincie, que lorsque le polype est blanc, elle semble n’en être pas
revêtue. Mais elle est très-distincte sur les espèces colorées. Sur
les côtés, les lames sont couvertes de petites aspérités mamelonnées
qui, s’enfonçant dans les replis de l’animal, font qu’il est tellement
adhérent au polypier, qu’il est impossible de l’en détacher autrement
qu’en lambeaux. Il en est de même pour le centre, qui, plus
consistant, ressemble assez à la chair des actinies. Cette difficulté
de l’isoler, même en brisant la substance pierreuse, nous a empêchés
de distinguer les organes de la digestion et ceux de la reproduc