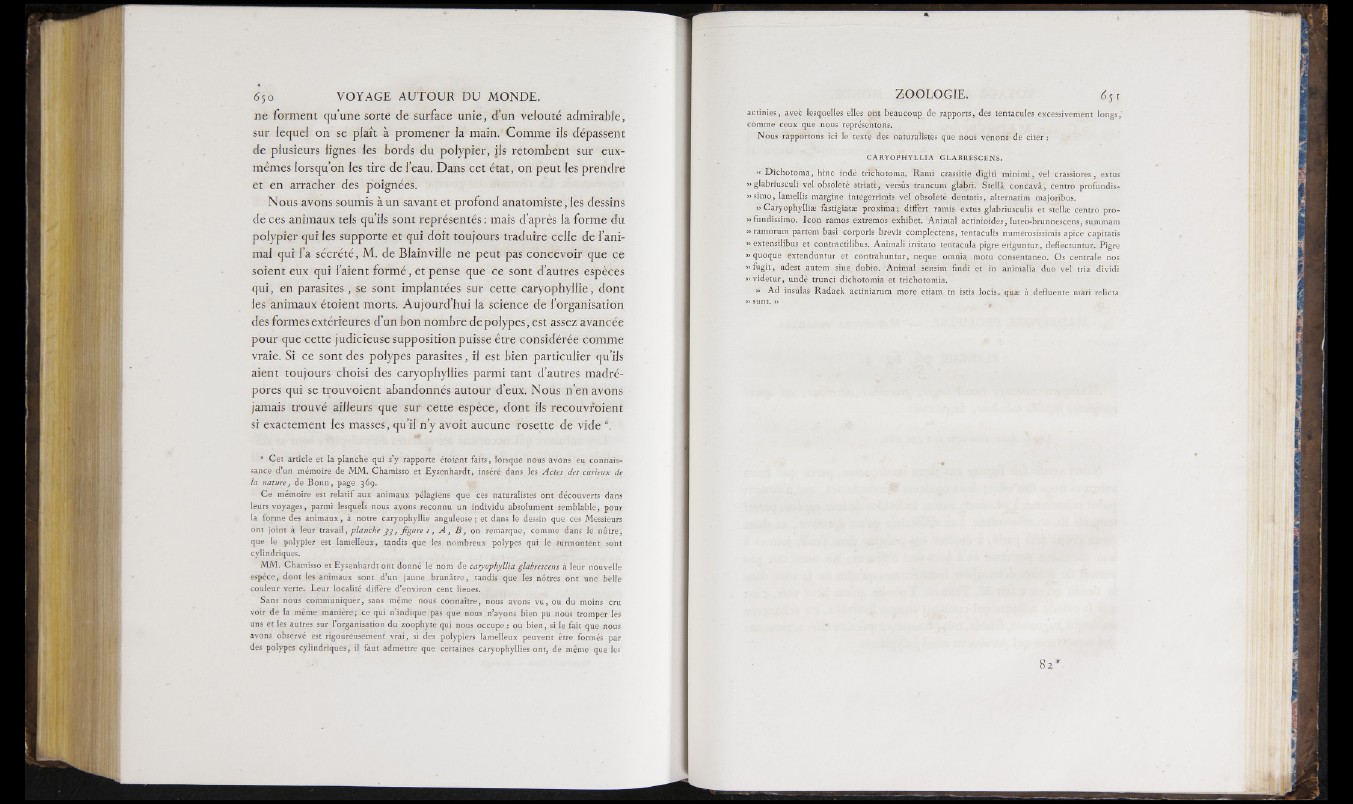
ne forment qu’une sorte de surface unie, d’un velouté admirable,
sur lequel on se plaît à promener la main. Comme ils dépassent
de plusieurs lignes les bords du polypier, ils retombent sur eux-
mémes lorsqu’on les tire de l’eau. Dans cet état, on peut les prendre
et en arracher des poignées.
Nous avons soumis à un savant et profond anatomiste, les dessins
de ces animaux tels qu’ils sont représentés : mais d’après la forme du
polypier qui les supporte et qui doit toujours traduire celle de l’animai
qui l’a sécrété, M. de Blainville ne peut pas concevoir que ce
soient eux qui l’aient formé, et pense que ce sont d’autres espèces
qui, en parasites, se sont implantées sur cette caryophyllie, dont
les animaux étoient morts. Aujourd’hui la science de l’organisation
des formes extérieures d’un bon nombre de polypes, est assez avancée
pour que cette judicieuse supposition puisse être considérée comme
vraie. Si ce sont des polypes parasites, il est Lien particulier qu’ils
aient toujours choisi des caryophyllies parmi tant d’autres madrépores
qui se trouvoient abandonnés autour d’eux. Nous n’en avons
jamais trouvé ailleurs que sur cette espèce, dont ils recouvraient
si exactement les masses, qu’il n’y avoit aucune rosette de vide *.
* C e t article et la planche qui s’y rapporte étoient fa its, lorsque nous avons eu connaissance
d’un mémoire de M M . Chamisso et Eysenhard t, inséré dans les Actes des curieux de
la nature, de B o n n , page 369.
C e mémoire est re la tif aux animaux pélagiens que ces naturalistes ont découverts dans
leurs vo y a g e s , parmi lesquels nous avons reconnu un individu absolument semblable, pour
la forme des animaux, à notre caryophyllie anguleuse; et dans le dessin que ces Messieurs
ont joint à leur Itiu aA, planche y ; , figure i , A , B , on remarque, comme dans le nôtre,
que le polypier est lamelleux, tandis que les nombreux polypes qui le surmontent sont
cylindriques.
MM. Chamisso et Eysenhardt ont donné le nom de caryophyllia glabrescens à leur nouvelle
espece, dont les animaux sont d’un jaune brunâtre, tandis que les nôtres ont une belle
couleur verte. Leur localité diffère d’ environ cent lieues.
Sans nous communiquer, sans même nous connaître, nous avons v u , ou du moins cru
voir de la même manière; ce qui n’indique pas que nous n’ayons bien pu nous tromper les
uns et les autres sur l’organisation du zoophyte qui nous occupe ; ou bien, si le fait que nous
avons observé est rigoureusement v ra i, si des polypiers lamelleux peuvent être formés par
des polypes cylindriques, il faut admettre que certaines caryophyllies ont, de même que les
actinies, avec lesquelles elles ont beaucoup de rapports, des tentacules excessivement longs,
comme ceux que nous représentons.
Nous rapportons ici le texte des naturalistes que nous venons de citer :
CARYOPHYLLIA GLABRESCENS .
<! Dich otom a , hinc indè trichotoma. Rami crassitie digiti minimi, vel crassiores, extus
>'glabriusculi vel obsolete s tria ti, versùs truncum glabri. Stellâ con c a v a , centro profundis-
» s im o , lamellis margine iniegerrimis vel obsoletè dentatis, alternatim rnajoribus.
» Caryophylliæ fastigiatæ p róxim a; differì ramis extus glabriusculis et stellæ centro pro-
»fundissimo. Icon ramos extremos exhiber. Animal actinioides, luteo-brunnescens, summam
» ramorum partem basi corporis brevis complectens, tentaculis numerosissimis apice capitatis
» extensilibus et contractilibus. Animali irritato tentacula pigre eriguntur, deflectuntur. Pigre
»q uoqu e extenduntur et contrahuniur, ñeque omnia motu consentaneo. Os centrale nos
» fu g i t , adest autem sine dubio. Animal sensim lindi et in animalia duo vel tria dividi
» v id e tu r , undè trunci dichotomia et trichotomia.
» A d ínsulas R ada ck actiniarum more etiam in istis locis, quæ .1 defluente mari relicta
n sunt. »