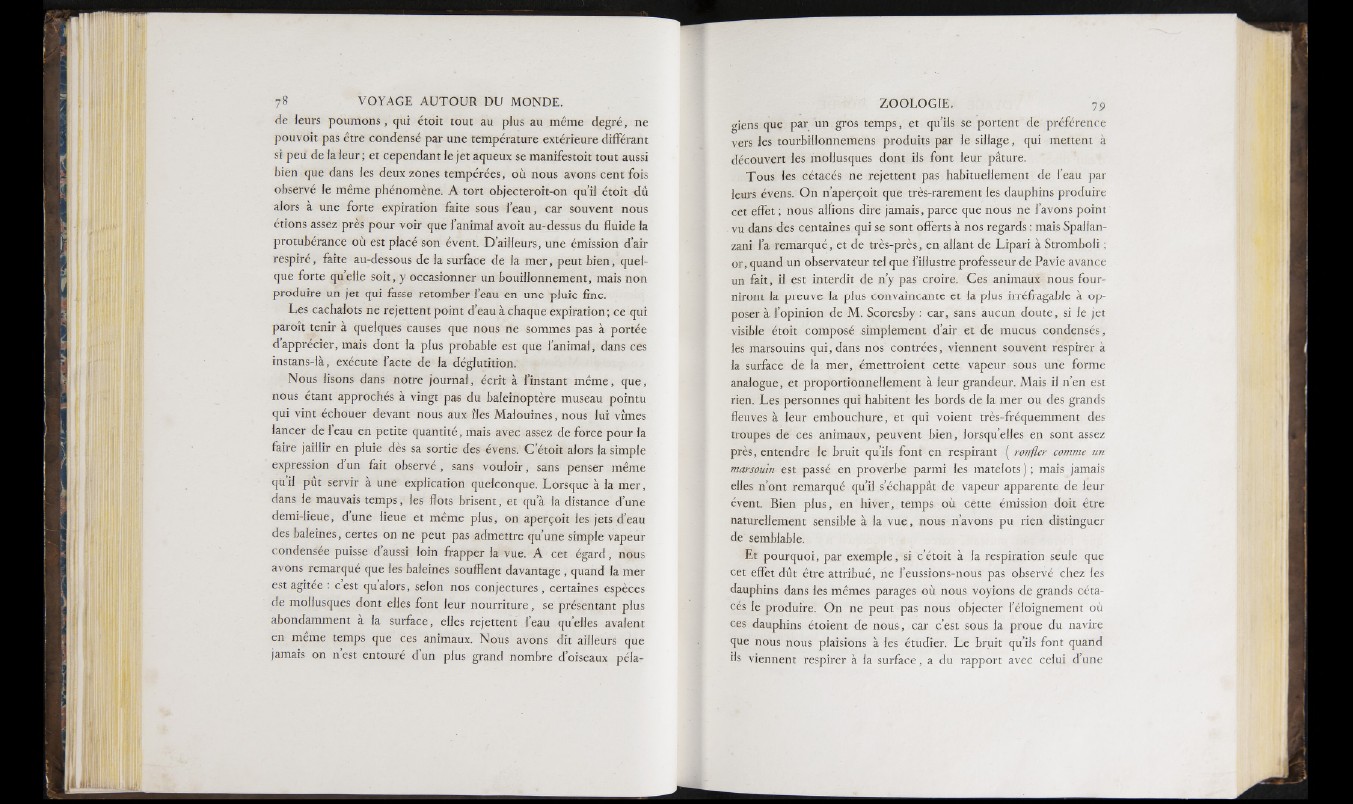
de leurs poumons, cjui étoit tout au plus au même degré, ne
pouvoit pas être condensé par une température extérieure différant
si peu de la leur ; et cependant le jet aqueux se manifestoit tout aussi
bien que dans les deux zones tempérées, où nous avons cent fois
observé le même phénomène. A tort objecteroit-on qu’il étoit dû
alors à une forte expiration faite sous l’eau, car souvent nous
étions assez près pour voir que l’animal avoit au-dessus du fluide ia
protubérance où est placé son évent. D ’ailleurs, une émission d’air
respiré, faite au-dessous de la surface de la m e r, peut bien, quelque
forte qu’elle soit, y occasionner un bouillonnement, mais non
produire un jet qui fasse retomber l’eau en une pluie fine.
Les cachalots ne rejettent point d’eau à chaque expiration; ce qui
paroît tenir à quelques causes que nous ne sommes pas à portée
d apprécier, mais dont la plus probable est que i’animal, dans ces
instans-ià, exécute l’acte de la déglutition.
Nous lisons dans notre journal, écrit à l’instant même, que,
nous étant approchés à vingt pas du baleinoptère museau pointu
qui vint échouer devant nous aux îles Malouines, nous lui vîmes
lancer de l’eau en petite quantité, mais avec assez de force pour la
faire jaillir en pluie dès sa sortie des évens. C ’étoit alors la simple
expression dun fait observé, sans vouloir, sans penser même
quii put servir a une explication quelconque. Lorsque à la mer,
dans le mauvais temps, les flots brisent, et qu’à la distance d’une
demi-lieue, dune lieue et même plus, on aperçoit les jets d’eau
des baleines, certes on ne peut pas admettre qu’une simple vapeur
condensée puisse d aussi loin frapper la vue. A cet égard, nous
avons remarque que les baleines soufflent davantage , quand la mer
est agitée : cest qu alors, selon nos conjectures, certaines espèces
de mollusques dont elles font leur nourriture, se présentant plus
abondamment à la surface, elles rejettent l’eau qu’elles avalent
en meme temps que ces animaux. Nous avons dit ailleurs que
jamais on nest entouré dun plus grand nombre d’oiseaux pélagiens
que par un gros temps, et qu’ils se portent de préférence
vers les tourbillonnemens produits par le sillage, qui mettent à
découvert les mollusques dont ils font leur pâture.
Tous les cétacés ne rejettent pas habituellement de l’eau par
leurs évens. On n’aperçoit que très-rarement les dauphins produire
cet effet ; nous allions dire jamais, parce que nous ne l’avons point
vu dans des centaines qui se sont offerts à nos regards : mais Spallan-
zani l’a remarqué, et de très-près, en allant de Lipari à Stromboli ;
or, quand un observateur tel que l’illustre professeur de Pavie avance
un fait, il est interdit de n’y pas croire. Ces animaux nous fourniront
la preuve la plus convaincante et la plus irréfragable à opposer
à f opinion de M. Scoresby : car, sans aucun doute, si ie jet
visible étoit composé simplement d’air et de mucus condensés,
les marsouins qui, dans nos contrées, viennent souvent respirer à
la surface de la mer, émettroient cette vapeur sous une forme
analogue, et proportionnellement à leur grandeur. Mais il n’en est
rien. Les personnes qui habitent les bords de la mer ou des grands
fleuves à leur embouchure, et qui voient très-fréquemment des
troupes de ces animaux, peuvent bien, lorsqu’elles en sont assez
près, entendre le bruit qu’ils font en respirant ( ronfler comme un
marsouin est passé en proverbe parmi les matelots ) ; mais jamais
elles n’ont remarqué qu’il s’échappât de vapeur apparente de leur
évent. Bien plus, en hiver, temps où cette émission doit être
naturellement sensible à la v u e , nous n’avons pu rien distinguer
de semblable.
Et pourquoi, par exemple, si c’étoit à la respiration seule que
cet effet dût être attribué, ne l’eussions-nous pas observé chez les
dauphins dans les mêmes parages où nous voyions de grands cétacés
le produire. On ne peut pas nous objecter l’éloignement où
ces dauphins étoient de nous, car c’est sous la proue du navire
que nous nous plaisions à les étudier. L e bruit qu’ils font quand
ils viennent respirer à la surface, a du rapport avec celui d’une