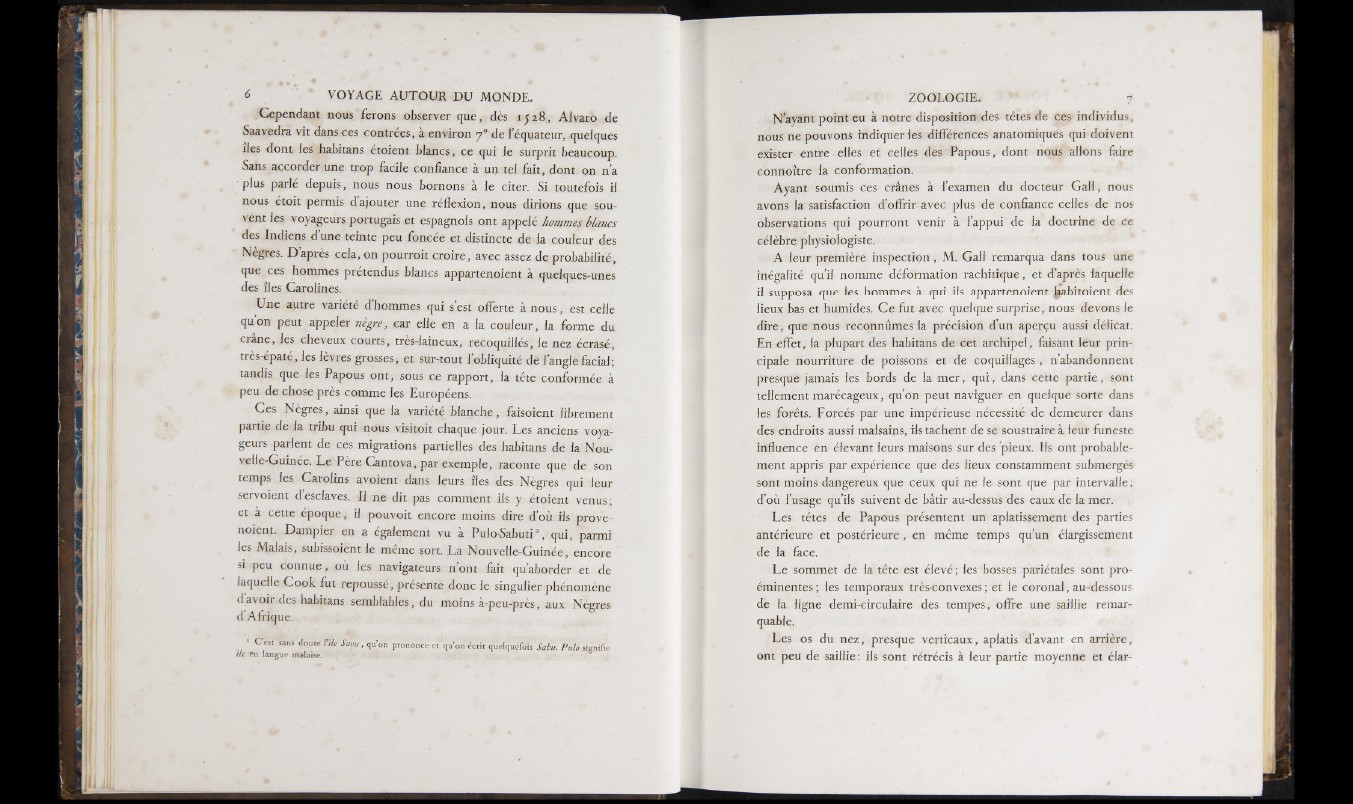
Cependant nous ferons observer que, des 15 2 8 , Aivaro de
Saavedra vit dans ces contrées, à environ 7° de l’équateur, quelques
des dont les habitans étoient blancs, ce qui le surprit beaucoup.
Sans accorder une trop facile confiance à un tel fait, dont on n’a
plus parlé depuis, nous nous bornons à le citer. Si toutefois il
nous étoit permis d ajouter une réflexion, nous dirions que souvent
les voyageurs portugais et espagnols ont appelé hommes blancs
des Indiens d’une teinte peu foncée et distincte de la couleur des
Nègres. D ’après cela, on pourroit croire, avec assez de probabilité,
que ces hommes prétendus blancs appartenoient à quelques-unes
des îles Carolines.
Une autre variété d’hommes qui s’est offerte à nous, est celle
qu’on peut appeler 7Ûgre, car elle en a la couleur, la forme du
crâne, les cheveux courts, très-laineux, recoquillés, le nez écrasé,
très-épaté, les lèvres grosses, et sur-tout l’obliquité de l’angle facial!
tandis que les Papous ont, sous ce rapport, la tête conformée à
peu de chose près comme les Européens.
Ces Nègres, ainsi que la variété blanche, faisoient librement
partie de la tribu qui nous visitoit chaque jour. Les anciens voyageurs
parient de ces migrations partielles des habitans de la Nou-
velle-Cuinée. L e Père Cantova, par exemple, raconte que de son
temps les Carolins avoient dans leurs îles des Nègres qui leur
servoient d esclaves. Il ne dit pas comment ils y étoient venus;
et à cette époque, il pouvoit encore moins dire d’où ils prove
noient. Dampier en a également vu à Pulo-Sabuti% qui, parmi
les Malais, subissoient le même sort. L a Nouvelle-Cuinée, encore
SI peu connue, où les navigateurs n’ont fait qu’aborder et de
laquelle Co ok fut repoussé, présente donc le singulier phénomène
d avoir des habitans semblables, du moins à-peu-près, aux Nègres
d’Afrique.
‘ C ’est sans doute tiU S a v u , qu’on prononce et qu’on écrit quelquefois Sabii. P u lo signifie
lie en langue ma-lnise.
N’ayant point eu à notre disposition des têtes de ces individus,
nous ne pouvons indiquer les différences anatomiques qui doivent
exister entre elles et celles des Papous, dont nous allons faire
connoître la conformation.
Ayant soumis ces crânes à l’examen du docteur C a ll, nous
avons la satisfaction d’offrir avec plus de confiance celles de nos
observations qui pourront venir à l’appui de la doctrine de ce
célèbre physiologiste.
A leur première inspection , M. Call remarqua dans tous une
inégalité qu’il nomme déformation rachitique, et d’après laquelle
il supposa que les hommes à qui ils appartenoient habitoient des
lieux bas et humides. C e fut avec quelque surprise, nous devons le
dire, que nous reconnûmes la précision d’un aperçu aussi délicat.
En effet, la plupart des habitans de cet archipel, faisant leur principale
nourriture de poissons et de coquillages, n’abandonnent
presque jamais les bords de la m e r , qui, dans cette partie, sont
tellement marécageux, qu’on peut naviguer en quelque sorte dans
les forêts. Forcés par une impérieuse nécessité de demeurer dans
des endroits aussi malsains, ils tachent de se soustraire à leur funeste
influence en élevant leurs maisons sur des pieux. Ils ont probablement
appris par expérience que des lieux constamment submergés
sont moins dangereux que ceux qui ne le sont que par intervalle;
d’où l’usage qu’ils suivent de bâtir au-dessus des eaux de la mer.
Les têtes de Papous présentent un aplatissement des parties
antérieure et postérieure , en même temps qu’un élargissement
de la face.
L e sommet de la tête est élevé ; les bosses pariétales sont proéminentes
; les temporaux très-convexes ; et le coronal, au-dessous
de la ligne demi-circulaire des tempes, offre une saillie remarquable.
Les os du nez, presque verticaux, aplatis d’avant en arrière,
ont peu de saillie : ils sont rétrécis à leur partie moyenne et élar