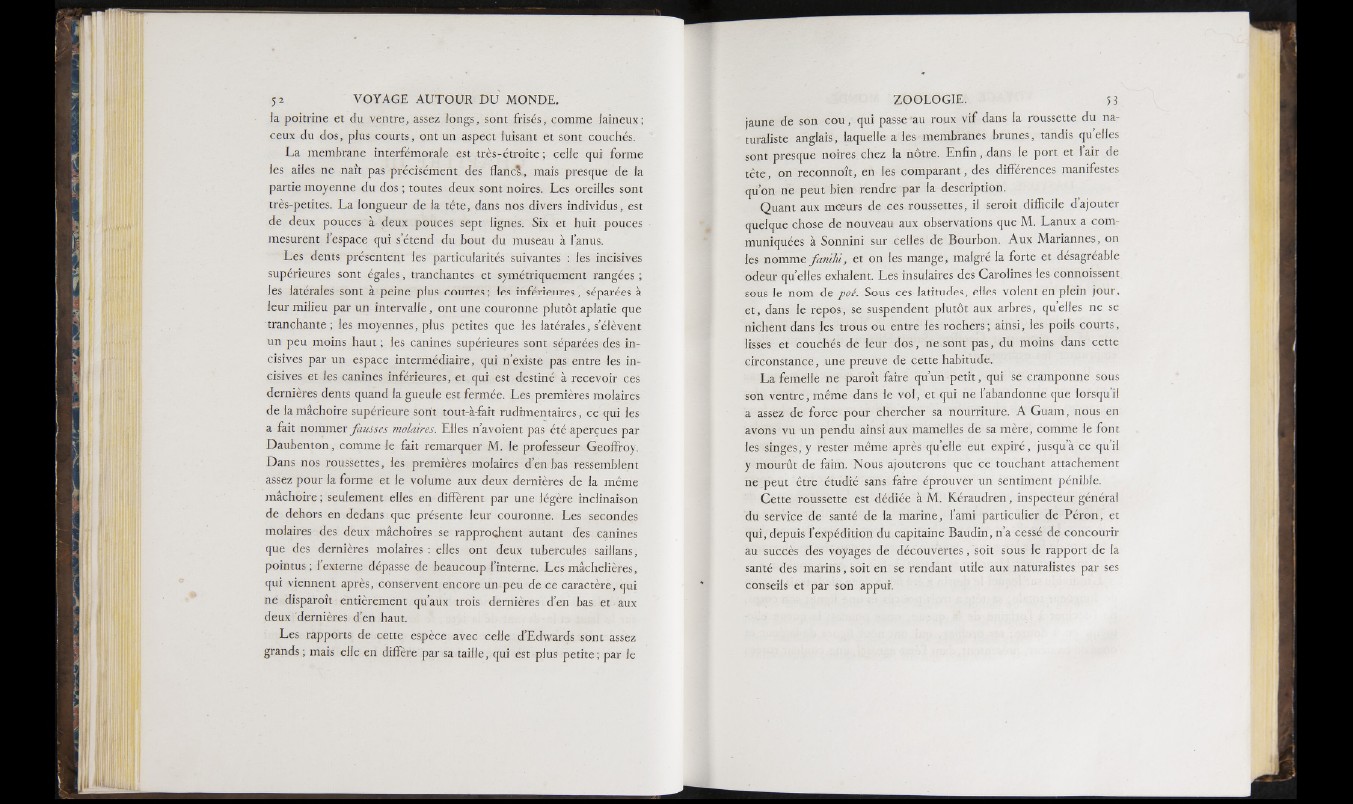
la poitrine et du ventre, assez longs, sont frisés, comme laineux;
ceux du dos, plus courts, ont un aspect luisant et sont couchés.
L a membrane interfémorale est très-étroite ; celle cjui forme
les ailes ne naît pas précisément des flancs, mais presque de la
partie moyenne du dos ; toutes deux sont noires. Les oreilles sont
très-petites. L a longueur de la tête, dans nos divers individus, est
de deux pouces à deux pouces sept lignes. Six et huit pouces
mesurent l’espace qui s’étend du bout du museau à l’anus.
Les dents présentent les particularités suivantes : les incisives
supérieures sont égales, tranchantes et symétriquement rangées;
Jes latérales sont à peine plus courtes; les inférieures, séparées à
leur milieu par un intervalle, ont une couronne plutôt aplatie que
tranchante ; les moyennes, plus petites que les latérales, s’élèvent
un peu moins haut ; les canines supérieures sont séparées des incisives
par un espace intermédiaire, qui n’existe pas entre les incisives
et les canines inférieures, et qui est destiné à recevoir ces
dernières dents quand la gueule est fermée. Les premières molaires
de la mâchoire supérieure sont tout-à-fait rudimentaires, ce qui les
a fait nommer molaires. Elles n’avoient pas été aperçues par
Daubenton, comme le fait remarquer M. le professeur Geoffroy.
Dans nos roussettes, les premières molaires d’en bas ressemblent
assez pour la forme et le volume aux deux dernières de ia même
mâchoire ; seulement elles en diffèrent par une légère inclinaison
de dehors en dedans que présente leur couronne. Les secondes
molaires des deux mâchoires se rapprochent autant des canines
que des dernières molaires : elles ont deux tubercules sailians,
pointus ; l’externe dépasse de beaucoup l’interne. Les mâchelières,
qui viennent après, conservent encore un peu de ce caractère, qui
ne disparoît entièrement qu’aux trois dernières d’en bas et aux
deux dernières d’en haut.
Les rapports de cette espèce avec celle d’Edwards sont assez
grands ; mais elle en diffère par sa taille, qui est plus petite; par le
jaune de son c o u , qui passe au roux v if dans la roussette du naturaliste
anglais, laquelle a les membranes brunes, tandis qu’elles
sont presque noires chez la nôtre. E n fin , dans le port et l’air de
téte, on reconnoît, en les comparant, des différences manifestes
qu’on ne peut bien rendre par la description.
Quant aux moeurs de ces roussettes, il seroit difficile d’ajouter
quelque chose de nouveau aux observations que M. Lanux a communiquées
à Sonnini sur celles de Bourbon. Aux Mariannes, on
les ViOYsmit fanihi, et on les mange, malgré la forte et désagréable
odeur qu’elles exhalent. Les insulaires des Carolines les connoissent
sous le nom de poé. Sous ces latitudes, elles volent en plein jour,
et, dans le repos, se suspendent plutôt aux arbres, qu’elles ne se
nichent dans les trous ou entre les rochers; ainsi, les poils courts,
lisses et couchés de leur dos, ne sont pas, du moins dans cette
circonstance, une preuve de cette habitude.
L a femelle ne paroît faire qu’un petit, qui se cramponne sous
son ventre, même dans le vol, et qui ne l’abandonne que lorsqu’il
a assez de force pour chercher sa nourriture. A Guam, nous en
avons vu un pendu ainsi aux mamelles de sa mère, comme le font
les singes, y rester même après qu’elle eut expiré, jusqu’à ce qu’il
y mourût de faim. Nous ajouterons que ce touchant attachement
ne peut être étudié sans faire éprouver un sentiment pénible.
Cette roussette est dédiée à M. Kéraudren, inspecteur général
du service de santé de la marine, l’ami particulier de Péron, et
qui, depuis l’expédition du capitaine Baudin, n’a cessé de concourir
au succès des voyages de découvertes, soit sous le rapport de la
santé des marins, soit en se rendant utile aux naturalistes par ses
conseils et par son appui.
, iliL,üJUj..