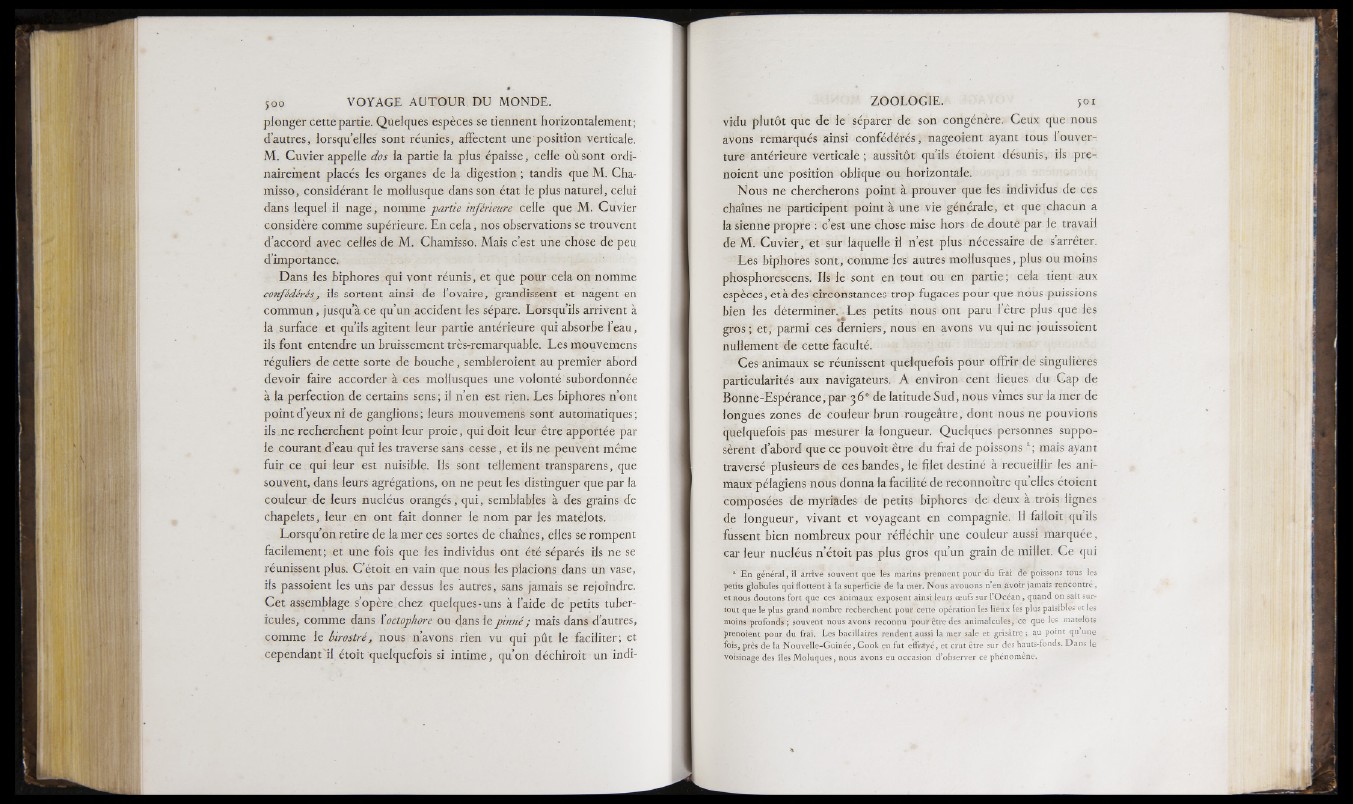
plonger cette partie. Quelques espèces se tiennent horizontalement;
d’autres, lorsqu’elles sont réunies, affectent une position verticale.
M. Cuvier appelle dos la partie ia plus épaisse, celle où sont ordinairement
placés les organes de la digestion ; tandis que M. Chamisso,
considérant le mollusque dans son état le plus naturel, celui
dans lequel il nage, nomme partie inférieure celle que M. Cuvier
considère comme supérieure. En cela, nos observations se trouvent
d’accord avec celles de M. Chamisso. Mais c’est une chose de peu
d’importance.
Dans les hiphores qui vont réunis, et que pour cela on nomme
confédérés, ils sortent ainsi de l’ovaire, grandissent et nagent en
commun, jusqu’à ce qu’un accident les sépare. Lorsqu’ils arrivent à
la surface et qu’ils agitent leur partie antérieure qui absorbe l’eau,
ils font entendre un bruissement très-remarquable. Les mouvemens
réguliers de cette sorte de Louche, semhleroient au premier abord
devoir faire accorder à ces mollusques une volonté subordonnée
à la perfection de certains sens; il n’en est rien. Les biphores n’ont
point d’yeux ni de ganglions; leurs mouvemens sont automatiques;
ils ne recherchent point leur proie, qui doit leur être apportée par
le courant d’eau qui les traverse sans cesse, et ils ne peuvent même
fuir ce qui leur est nuisible. Ils sont tellement transparens, que
souvent, dans leurs agrégations, on ne peut les distinguer que par la
couleur de leurs nucléus orangés, qui, semblables à des grains de
chapelets, leur en ont fait donner le nom par les matelots.
Lorsqu’on retire de la mer ces sortes de chaînes, elles se rompent
facilement; et une fois que les individus ont été séparés ils ne se
réunissent plus. C’étoit en vain que nous les placions dans un vase,
ils passoient les uns par dessus les autres, sans jamais se rejoindre.
Cet assemblage s’opère chez quelques-uns à l’aide de petits tuber-
icules, comme dans ïoctophore ou dans le pinné; mais dans d’autres,
comme le birostré, nous n’avons rien vu qui pût le faciliter; et
cependant il étoit quelquefois si intime, qu’on déchiroit un individu
plutôt que de le séparer de son congénère. Ceux que nous
avons remarqués ainsi confédérés, nageoient ayant tous l’ouverture
antérieure verticale ; aussitôt qu’ils étoient désunis, ils prenoient
une position oblique ou horizontale.
Nous ne chercherons point à prouver que ies individus de ces
chaînes ne participent point à une vie générale, et que chacun a
la sienne propre : c’est une chose mise hors de doute par le travail
de M. Cuvier, et sur laquelle il n’est plus nécessaire de s’arrêter.
Les hiphores sont, comme les autres mollusques, plus ou moins
phosphorescens. Ils le sont en tout ou en partie; cela tient aux
espèces, etàdes circonstances trop fugaces pour que nous puissions
bien les déterminer. Les petits nous ont paru l’être plus que les
gros ; et, parmi ces derniers, nous en avons vu qui ne jouissoient
nullement de cette faculté.
Ces animaux se réunissent quelquefois pour offrir de singulières
particularités aux navigateurs. A environ cent lieues du Cap de
Bonne-Espérance, par 36° de latitude Sud, nous vîmes sur la mer de
longues zones de couleur brun rougeâtre, dont nous ne pouvions
quelquefois pas mesurer la longueur. Quelques personnes supposèrent
d’abord que ce pouvoit être du frai de poissons *; mais ayant
traversé plusieurs de ces bandes, le filet destiné à recueillir les animaux
pélagiens nous donna la facilité de reconnoître qu’elles étoient
composées de myriades de petits biphores de deux à trois lignes
de longueur, vivant et voyageant en compagnie. Il falloit quils
fussent bien nombreux pour réfléchir une couleur aussi marquée,
car leur nucléus n’étoit pas plus gros qu’un grain de millet. Ce qui
^ E n général, il arrive souvent que les marins prennent pour du frai de poissons tous ies
petits globules qui flottent à la superficie de la mer. Nous avouons n*en avoir jamais rencontré ,
et nous doutons fort que ces animaux exposent ainsi leurs oeufs sur l’O c é a n , quand on sait surtout
que le plus grand nombre recherchent pour cette opération les lieux les plus paisibles et les
moins profonds; souvent nous avons reconnu pour être des animalcules, ce que ies matelots
prenoient pour du frai. Les bacillaires rendent aussi la mer sale et grisâtre ; au point qu une
fois, près de la N ou v e lle -G u in é e , C ook en fut e*fFrayé,et crut être sur des hauts-fonds. D an s le
voisinage des îles Moluques, nous avons eu occasion d’observer ce phénomène.
1 II