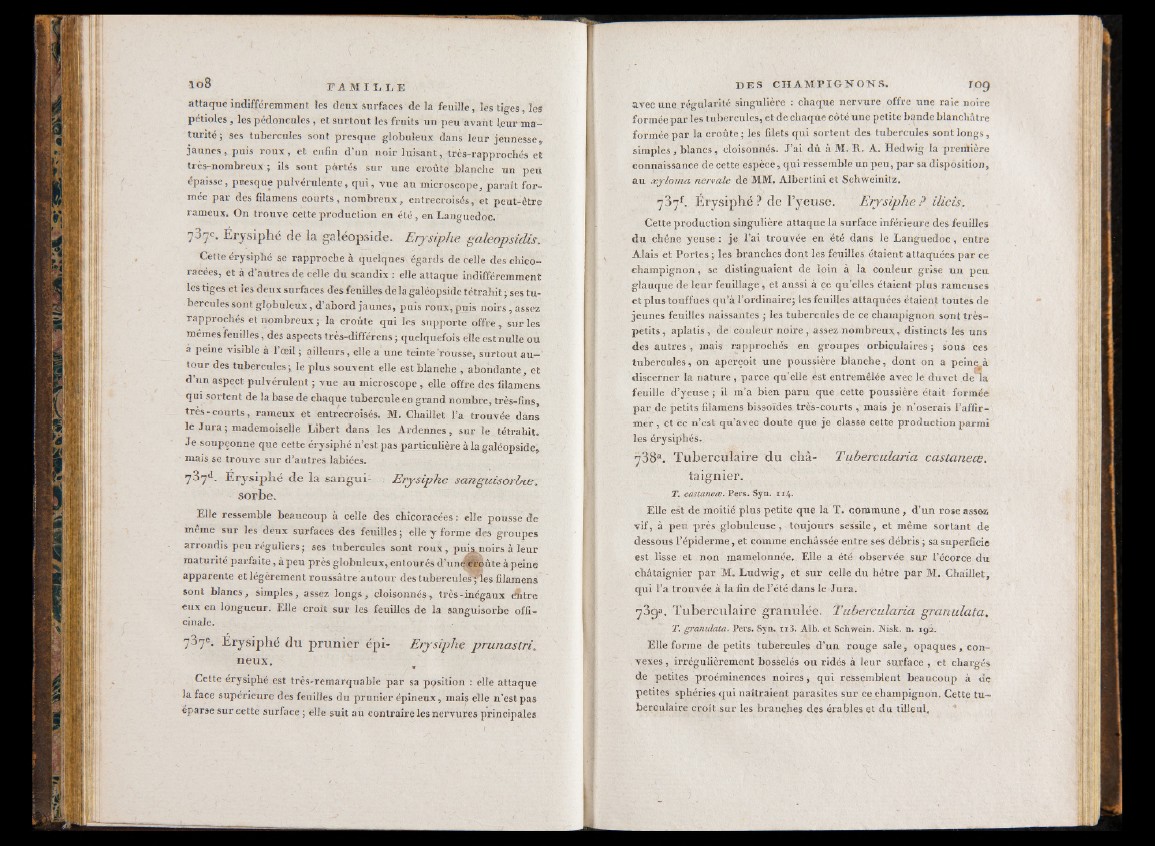
attaque indifféremment les deux surfaces de la feuille, les tiges, les
pétioles, les pédoncules , et surtout les fruits un peu avant feur maturité
; ses tubercules sont presque globuleux dans leur jeunesse,
jaunes, puis roux, et enfin d’un noir luisant, très-rapprochés et
très-nombreuxils sont portés sur une croûte blanche un peu
épaisse, presque pulvérulente, qui, vue au microscope, paraît formée
par des filamens courts , nombreux, entrecroisés, et peut-être
rameux. On trouve cette production en été , en Languedoc.
7% Æ- É rv s ip h é de la galéopside. Erysiphe galeopsidis.
Cette érysiphé se rapproche à quelques égards de celle des chico-
racées, et à d’autres de celle du scandix : elle attaque indifféremment
les tiges et les deux surfaces des feuilles de la galéopside tétrahit ; ses tubercules
sont glç>buleux, d’abord jaunes, puis roux, puis noirs, assez
rapprochés et nombreux ; la croûte qui les supporte offre , sur les
mêmes feuilles, des aspects très-différens ; quelquefois elle est nulle ou
à peine visible à l’oeil ; ailleurs, elle a une teinte rousse, surtout au-’
tour des tubercules ; le plus souvent elle est blanche , abondante, et
d’un aspect pulvérulent ; vue au microscope , elle offre des filamens
qui sortent de la base de chaque tubercule en grand nombre, très-fins,
très-courts, rameux et entrecroisés. M. Chaillet l’a trouvée dans
le Jura ; mademoiselle Libert dans les Ardennes, sur le tétrahit.
Je soupçonne que cette érysiphé n’est pas particulière à la galéopside,
mais se trouve sur d’autres labiées.
7^7d. É ry s ip h é de la sangui- Erysiphe sanguisorboe.
sorbe.
Elle ressemble beaucoup à celle des chicoracées: elle pousse de
même sur les deux surfaces des feuilles ; elle y forme des groupes
arrondis peu réguliers ; ses tubercules sont roux , pui^noirs à leur
maturité parfaite, à peu près globuleux, entourés d’unè croûte à peine
apparente et légèrement roussâtre autour des tuberculeuses filamens
sont blancs, simples, assez longs, cloisonnés, très-inégaux ^ttre
eux en longueur. Elle croît sur les feuilles de la sanguisorbe officinale.
737e. É ry s ip h é d u p ru n ie r épi- Erysiphe prunastri.
n eu x .
Cette érysiphé est très-remarquable par sa ppsition : elle attaque
la face supérieure des feuilles du prunier épineux, mais elle n’est pas
éparse sur cette surface ; elle suit au contraire les nervures principales
avec une régularité singulière : chaque nervure offre une raie noire
formée par les tubercules, et de chaque côté une petite bande blanchâtre
formée par la croûte ; les filets qui sortent des tubercules sont longs,
simples, blancs, cloisonnés. J’ai dû à M. R. A. Hedwig la première
connaissance de cette espèce, qui ressemble un peu, par sa disposition,
au xylorna nervale de MM. Albertini et Schweinitz.
787^ É r y s ip h é ? de l ’yeu se. Erysiphe? ilicis.
Cette production singulière attaque la surface inférieure des feuilles
du chêne yeuse: je l’ai trouvée en été dans le Languedoc, entre
Alais et Portes ; les branches dont les feuilles étaient attaquées par ce
champignon, se distinguaient de loin à la couleur grise un peu
glauque de leur feuillage , et aussi à ce qu’elles étaient plus rameuses
et plus touffues qu’à l’ordinaire; les feuilles attaquées étaient toutes de
jeunes feuilles naissantes ; les tubercules de ce champignon sont très-
petits, aplatis, de couleür noire , assez nombreux, distincts les uns
des autres , mais rapprochés en groupes orbiçulaires ; sous ces
tubercules, on aperçoit une poussière blanche, dont on a peine à
discerner la nature, parce qu’elle est entremêlée avec le duvet de la
feuille d’yeuse ; il m’a bien paru que cette poussière était formée
par de petits filamens bissoïdes très-courts , mais je n’oserais l’affirmer
, et Ce n’est qu’avec doute que je classe cette production parmi
les érysiphés.
738a. T u b e r cu la ir e d u châ- Tubercularia castaneoe.
ta ign ie r .
T. castaneoe. Pers. Syu. 114.
Elle est de moitié plus petite que la T. commune , d’un rose assez
vif, à peu près,globuleuse , toujours sessile, et même sortant de
dessous l’épiderme, et comme enchâssée entre ses débris ; sa superficie
est lisse et non mamelonnée. Elle a été observée sur l’écorce du
châtaignier par M. Ludwig, et sur celle du hêtre par M. Chaillet,
qui l’a trouvée à la fin de l’été dans le Jura.
739». T u b e r cu la ire g ranu lée. Tubercularia granulata,
T. granulata. Pers. Syn. n 3. Alb. et Scliwein. Nisk. n. 192.
Elle forme de petits tubercules d’un rouge sale, opaques, convexes
, irrégulièrement bosselés ou ridés à leur surface , et chargés
de petites proéminences noires, qui ressemblent beaucoup à ue
petites sphéries qui naîtraient parasites sur ce champignon. Cette tuberculaire
croît sur les branches des érables et du tilleul.