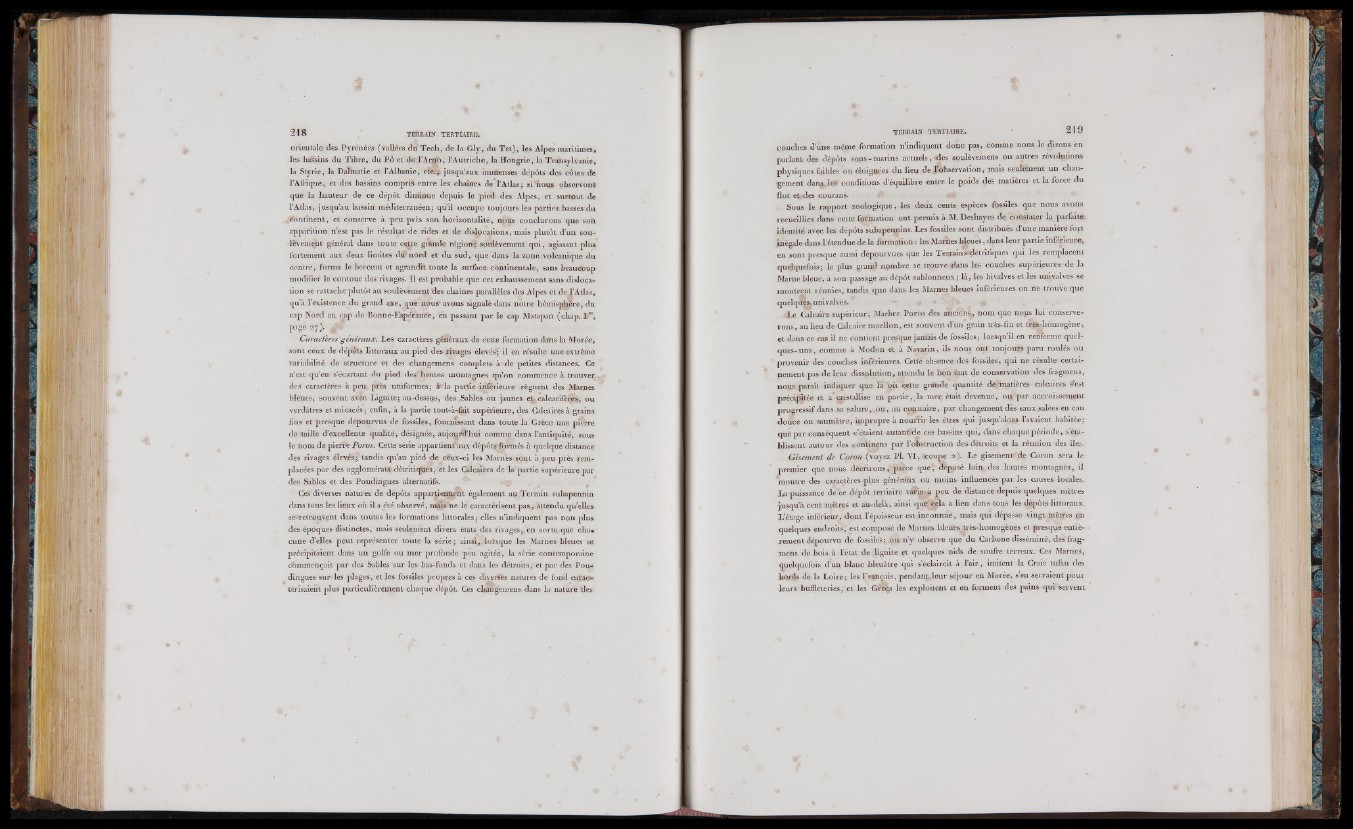
orientale des Pyrénées (vallées du Tech, de la Gly, du Tet), les Alpes maritimes,
lès baSsins du Tibre, du Pô et de-l’Arrib, l’Autriche, la Hongrie, la Transylvanie,
la Styrie, la Dalmatie et l’Albanie, ete^ jusqu’aux immenses dépôts des côtes de
l’Afrique, et des bassins comprit entre les chaînes de l’Atlas; si’nous observons
que la hauteur de ce dépôt diiriinue depuis le pied des Alpes, et surtout de
l’Atlas, jusqu’au bassin méditerranéen; qu’il occupe toujours les parties basses du
Continent, et conserve à peu près son horizontalité, poris conclurons que son
apparition n’est pas le résultat'de rides et de dislpcautions, mais plutôt d?un soulèvement
général dans toute cepe grànde régionf soulèvement qui, agissant plus
fortement aux deux limites d#nord et du sud, que dans la zone volcanique du
centre, forma le berceau et agrandît toute la surface-continentale, sans beaucoup
modifier le contour des rivages. Il est probable que cet exhaussement sans dislocation
se rattache plutôt au soulèvement des chaînes parallèles des Alpes et dei’Atlas,
qu’à l ’existence du grand axe, que nou? avons signalé dans notre hémisphère, du
cap Nord au cap de Bonne-Espérance, en passant par le cap Matapan (chap..fèir,
page ■•■’ll- jjl
Caractères’généraux. Les caractères généraux de cette formation dams la Morée,
sont Geux de dépôts littoraux au pied des rivages élevés1; il en résulte une extrême
variabilité de -structure et des changemens complets à-de petites distances. Ce
n’est qu’en- s’écartant du pied des hantes, montagnes qu’on commence à trouver..
dêS caractères à peu près uniformes; à'^la partie inférieure régnent des Marnes
bleues, souvent avec Lignite; au-dessus, des .Sables ou jaunes etvcalcarifèfesij ou
verdâtres et micacés; enfin, à la partie tout-à-fait supérieure, des Calcaires à grains
fins et presque dépourvus de fossiles, fournissant dans toute la Grèce une pierre
de taille d’excellente qualité-, désignée, aujoura’hui comme dans l’antiquité, sous
le nom de pierre Poros. Cette série appartieni?àux dépôts;formés à quelque distance
des rivages élevés:;'tandis qu’au pied -de e fu x -c i les Marnes sont à peu près remplacées
par des agglomérat^détritiques, ét les Calcaires de la partie supérieure par
des Sables et des Poudingues alternatifs.
Ceà diverses natures de dépôts appartiennent également au Terrain subapennin
dans tous les lieux où il a.été observé, mais ne lé caractérisent pas, attendu qu’elles
s «»retrouvent dans toutes les formations littorales ; elles n’indiquent pas non plus
des épôqUés distinctes, mais seulement divers états des rivages, en sorte, que cha*
curie d’elles peut représenter toute la série; ainsi,,¿lorsque les Marnes bleues se
précipitaient dans un golfe ou mer profonde peu agitée, la série contemporaine
dSmmençait par des Sables sur les bas-fonds et dans les détroits, et par des Pou?
dingues suivies plages, et les fossiles propres à ces diverses natures de fond carao
térisaieht plus particulièrement chaque dépôt. Ces changemens dans la nature ‘des
couches d’une mêçne formation n’indiquent donc pa§, comme nous le dirons en
parlant des dépôts s o j is - marins actuels, «des spulèvémens ou autres révolutions
physiques faibles ou éloignées du lieu de ¿’observation, mais seulfement un changement
dan&Jeâ conditions d’équilibre entre le poids des matières et la force du
flot e&des courans.
- Sous le rapport zoologique, les deux cents espèces fossiles que nous avons
recueillies dans cette formation ont permis à M. Deshayes dé, constater la parfaite
identité avec les dépôts subapennins. Les fossiles sont distribués d’une manière fort
«légale dans l’étendue de la formation : les Maires bleues, dans leur partie inférieure,,
en sont presque aussi dépourvues que les Temains^étritiques qui les remplacent
quelquefois; le plus grand nombre se trouve ^ans les couches supérieures .-de la
Marne bleue, à son passage au dépôt sablonneux; là, les bivalves et les uniyalves se
montrent réunies, tandis que dans les Maçaesbleu.es inférieures on rie trouve que
quelques, univalves.
;jLe Calcaire supérieur, Marbre Poros des ancien^, nom que nops lui conserverons,
au lieu de Calcaire moellon» est souvent d’un grain très-fin et très-homogène,
et dans ce cas il ne contient presque jamais de fossiles; lorsqu’il en renferme quelques
uns, comme à Modon ëf à Navarin, ils nous ont toujours paru roulés ou
provenir des couches inférieures. Cette absence des fossiles, qui ne résulte certainement
pas de leur dissolution, attendu le bon état de conservation des fragmens,
nous paraît indiquer que là où cette grânde quantité défematières calcaires $est
précipitée et a° cristallisé en par lie, ,1a mec était devenue, ou par accroissement
progressif dans sa salure,..ou, au extraire, par changement des eaux salées en eau
doïffce ou saumâtre, impropre à nourrir les êtres qui jusqu’alors l’avaient habitée;
que par conséquent c’étaient autan^de ces bassins qui, dans chaque période , s’établissent
autour des conünens par l’obstruction des détroits et la réunion des îles.
Gisement de Coron (voyez Pl. VI, «coupe »). Le gisement? de Coron sera le
premier que nous décrirons, parce q u è ;‘ déposé loi%des hautes montagnès, il
montre des caractères -plus généraux ou moins influencés par les causes locales.
La puissance de'ce dépôt tertiaire varie à peu de distance depuis quelques mètres
jusqu’à cent mètres et aii-delà, ainsi qué rigla a lieu dans tous les dépôts littoraux.
L’étage inférieur, dont l’épaisseur estrinconnue, mais qui dépasse vingt mètres en
quelques endroits', est composé de Marnes bleuësÆj’ès-homogènes et presque entièrement
dépourvu de fossiles; on n’y obsérve que du Carbone disséminé, des frag-
mens de bois à l’état de-lignite et quelques nids de soufre terreux. Ces Marnes,
quelquefois d’un blanc bleuâtre qui s’éclaircit à l’air, imitent la Craie tufau des
bords de la Loire; les Français, pendantrieur séjour en Morée, s’en servaient pour
leurs buffleteries, et les Grecs les exploitent et en forment des pains qui'Servent