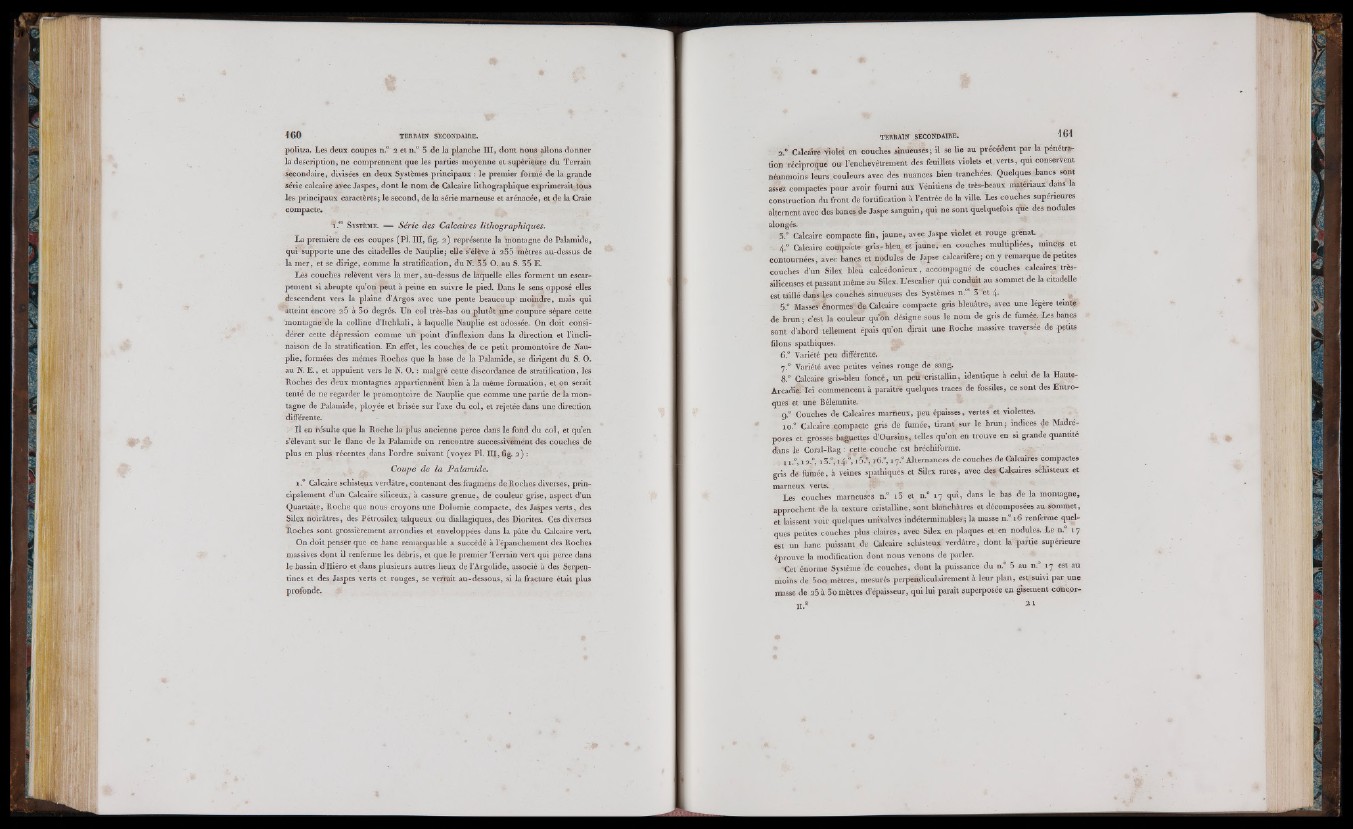
politza. Les deux coupes n.°' 2 et n.° 3 de la planche III, dont nous allons donner
la description, ne comprennent que les parties moyenne et supérieure du Terrain
secondaire, divisées en deux Systèmes principaux : le premier formé de la grande
série calcaire avec Jaspes, dont le nom de Calcaire lithographique exprimeraitjtous
les principaux caractères; le second, de la série marneuse et arénacée, et de la Craie
compacte.
i ” Système. — Série des Calcaires lithographiques.
La première de ces coupes (Pl. III, fig. 2) représente la montagne de Palamide,
qui supporte une des citadelles de Nauplie; elle s’élève à 235 mètres au-dessus de
la mer, et se dirige, comme la stratification, du N; 35 O. au S. 35 E.
Lès couches relèvent vers la mer, au-dessus de laquelle elles forment un escarpement
si abrupte qu’on peut à peine en suivre le pied. Dans le sens opposé elles
descendent Vers la plaine d’Argos avec une pente beaucoup'moindre, mais qui
atteint encore 25 à 3o degrés. Un col très-bas ounlutôt une coupure sépare cette
montagne de la colline d’Itchkali, à laquelle Nauplie est adossée. On doit considérer
cette dépression comme un point d’inflexion dans la direction et l’inclinaison
de la stratification. En effet, les couches de ce petit promontoire de Nauplie,
formées des mêmes Roches que la base de la Palamide, se dirigent du S. O.
au N. E., et appuient vers le N. O. : malgré cette discordance de stratification, les
Roches des deux montagnes appartiennent bien à la même formation, et on serait
tenté de ne regarder le promontoire de Nauplie que comme une partie de la montagne
de Palamide, ployée et brisée sur l’axe du col, et rejetée dans une direction
différente.
Il en résulte que la Roche la plus ancienne perce dans le fond du col, et qu’en
s’élevant sur le flanc de la Palamide on rencontre successivement des couches de
plus en plus récentes dans l’ordre suivant (voyez Pl. Iü,fig. 2) :
Coupe de la Palamide.
i.° Calcaire schisteux verdâtre, contenant des fragmens de Roches diverses, principalement
d’un Calcaire siliceux,' à cassure grenue, dé couleur grise, aspect d’un
Quartzâte, Roche que nous croyons une Dolomie compacte, des Jaspes verts, des
Silex noirâtres, des Pétrosilex talqueux ou diallagiques, des Dio rites. Ces diverses
Roches sont grossièrement arrondies et enveloppées dans la pâte du Calcaire vert.
On doit penser que ce banc remarquable a succédé à l’épanchement des Roches
massives dont il renferme les débris, et que le premier Terrain vert qui perce dans
le bassin d’Hiéro et dans plusieurs autres lieux de l’Argolide, associé à des Serpentines
et des Jaspes verts et rouges, se verrait au-dessous, si la fracture était plus
profonde.
2.0 Calcaire violet en couches sinueuses ; il se lie au précédent par la pénétration
réciproque ou- l’enchevêtrement des feuillets violets et. verts, qui conservent
néanmoins leurs . couleurs avec des nuances bien tranchées. Quelques bancs sont
assez compactes pour avoir fourni aux Vénitiens de .très-beaux matériaux dans la
construction du front de fortification à l’entrée de la ville. Les couches supérieures
alternent avec des bancs de Jaspe Sanguin, qui ne sont quelquefois qhe des nodules
alongés. 5.° Calcaire compacte fin, jaune, avec Jaspe violet et rouge grenat
4.“ Calcaire coiRpacte g.ii-bleu ei^anne,-en couches multipliées, minée? et
contournées, a v e c baijçs et nodules de Japse calcarifire; on y remarque de petites
couches d’un Silex bleu calcédonieuî,' accompagné de couches calcairçs, très-
siliceuses et passant même au Silex. L’escalier qui conduit au sommet de la citadelle
est titillé dans les couélies sinueuses des Systèmes n. 3 et 4-
5 ° M a s s é e énormes' de, Calcaire compacte gris bleuâtre, avec Une légère teinté
de brun; c’est la couleur qu^n désigne sous le nom de gris de fuméj. Les banqs
sont d’abord tellement épais qu’on dirait une Roche massive traversée de .petits
filons spathiques.
6.° Variété peu différente.
n.° Variété avec petites veines rouge de sang.
8.° Calcaire gris-bleu foncé, un peur cristallin, identique à celui de la Haute-
Arcadilflci commencent à paraîtré quelques traces de fossiles, ce sont des Eûtro-
ques et une Bélemnite.
9.0 Couches de Calcaires marfieux, peu épaisses, vertes et violettes.
io.® CalcairevÇQmpaqte gris de fumée, tirant sur le brun; indices «je Madrépores
et grosses baguettes d’Oursins, telles qu’on en trouve en si grande quantité
dans le Coral-Rag : cette couche est bréchiforme.
11.0 12.0, i 3.°, i4*°, J f>?, f6.°, 17."Alternances de couches de Calcaires compactes
gris dé* fiiinée, à veines spathiques et Silex rares, avec des Calcaires schisteux et
marneux verts..
Les couches marneuses n.° i 3 et n.° 17 qui, dans le bas de la montagne,
approchent -de la texture cristalline, sont blanchâtres et décomposées au Sommet,
et laissent voir quelques univalves indéterminables ; la masse n.°i6 renferme quelques
petites couches plus claires, avec Silex en plaques et en nodules. Xe n.° 17
est un banc puissant de Calcaire schisteux verdâtre, dont la partie supérieure
éprouve la modification dont nous venons de parler.
“Cet énorme Système‘de couches, dont la puissance du n.° 5 au n.° 17 est au
moins de 5oo mètres, mesurés perpendiculairement à leur plan, est-suivi par une
masse de 25 à 5o mètres d’épaisseur, qui lui paraît superposée en gisement cOUcor-
II.* 21