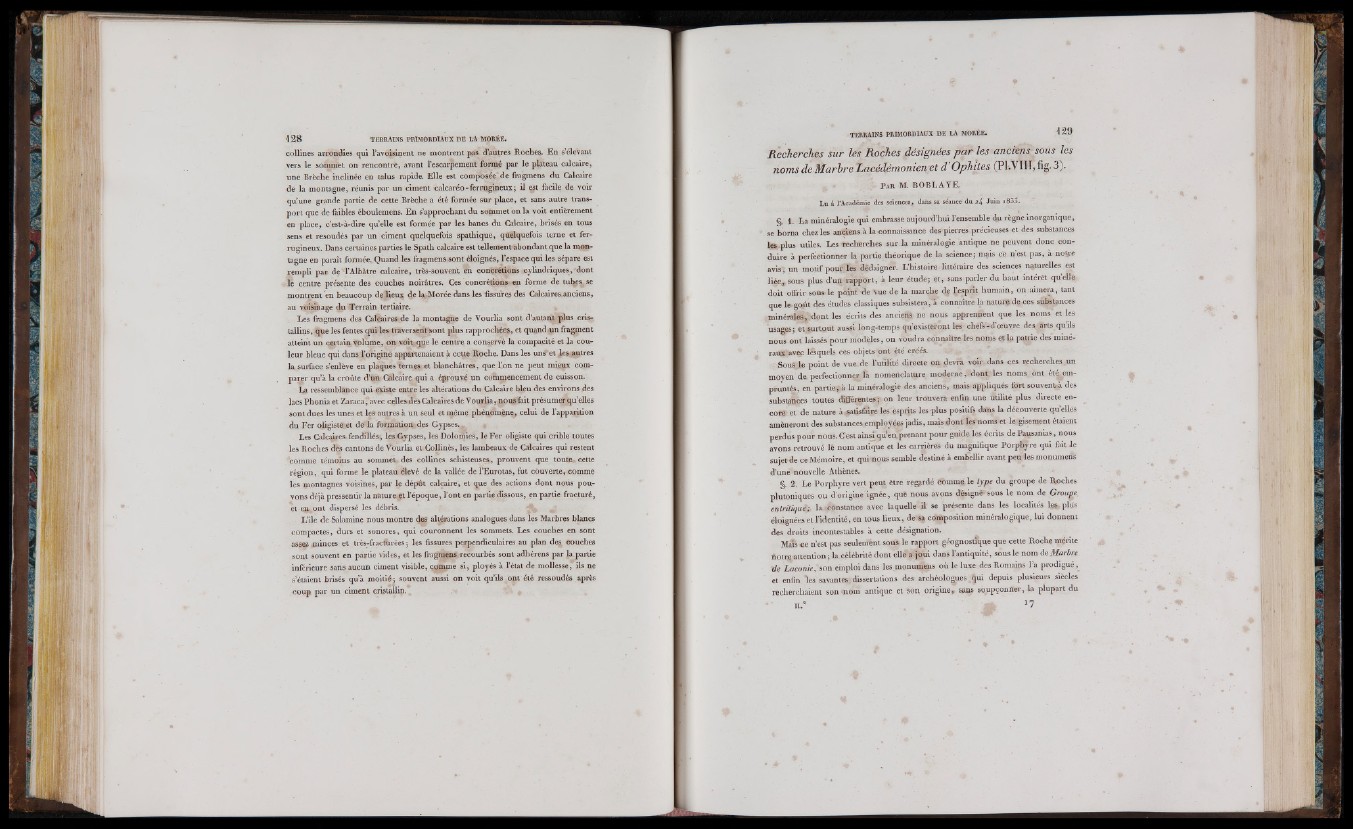
collines arcrondies qui l’avôisinent ne montrent pas d’autres Roches* En s’élevant
vers le sommet on rencontre, avant l’escarpement formé par le plateau calcaire,
une Brèche inclinée en talus rapide. Elle est composée* de fragmens du Calcaire
de la montagne, réunis par un ciment calcaréo - ferrugineux ; il e^t facile de voir
qu.’une grande partie de cette Brèche a été formée sur place, et sans autre transport
que de faibles éboulemens. En s’approchant du sommet on la voit entièrement
en place, c’est-à-diae quelle est formée par les bancs du Calcaire, brisés en tous
sens et resoudés par un ciment quelquefois spathique, quelquefois terne et ferrugineux.
Dans certaines parties le Spath calcaire est tellement'abondant que la montagne
en paraît formée,. Quand les fragmens sont éloignés, l’espace qui les sépare est
rempli par de‘l’Albâtre calcaire, très-souvent eih concrétions cylindriques,"dont
lé centre présente des couches noirâtres. Ces concrétions en forme de tul^s, se
montrent en beaucoup de ,lieux de la^Morée dans les fissures des Calcaires.anciens,
au voisinage du ^Terrain tertiaire.
Les fragmens des Calcaires de la montagne de Vourlia sont d’autan?; plus cris-
tallins, ’que les fentes qui les trayerserif-sont plus rapprochées, et quand un fragment
atteint un certain volume, on voit,que le centre a conservé la compacité et la couleur
bleue qui dansjl’origine appartenaient à cet^e Roche. Dans les uns*et des autres
la,^surface s’enlève en plaques ternes et blanchâtres, que ton ne peut mieux comparer
qu’à la croûte d’un Calcaire,-qui a éprouvé Un conqnencement de cuisson.
La ressemblance qui existe entre les altérations du Calcaire bleu des environs des
lacs Phonia et Zaraca^avec cellestdès Calcaires de Vourlia, ¿nous fait présume^qu’elles
sont dues les unes et les autres à un seul et même phénomène., celui de l’apparition
du Fer oiigistexet de la formationgdes Gypses.^
Les Calcaires fendillés, les Gypses, les Dolomies, le Fer oligiste qui crible toutes
les Roches <3%s cantons de Vburlia etvCollinès, les lambeaux de Calcaires qui restent
*comme témoms au sommet* des collines schisteuses», prouvent que toute« cette
région, qui forme le plateau ëleVé de la vallée de l’Eurotas, fut couverte, comme
lés montagnes voisines, par le dépôt calcaire, et que des actions dont nous pouvons
déjà pressentir la nature^t l’époque, l’ont en partie dissous, en partie fracturé,
et eg^ont dispersé les débris.
L’île de Salamine nous montre des altérations analogues dans les Marbres blancs
compactes, durs et sonores, qui couronnent les sommets. Les couches en sont
asse? minces et très-fracÎhrées ; les fissures perpendiculaires au plan deg Couches
sont souvent en partie vides , et les fragmens^recourbés sont adhérens par la partie
inférieure sans aucun ciment visible, comme si, ployés à l’état de mollesse, ils ne
s’étaient brisés qu’à moitié: souvent aussi on voit qu’ils ont été ressoudés après
coup par un ciment cristallin.,
TERRAINS PRIMORDIAUX D E LA MORÉE. 429
Recherches sur les Roches désignées pur les unciens soùs les
noms de Murhre Lacédémonienet d Ophites (PbVTÏt, fig. 3).
P a r M. BOBLÀYE.
L u . à l ’A cadémie des scienc es , dans .sa séance d u 24 Ju in i8 3 3 . '
§. 1. La minéralogie qui embrasse aujourd’hui l’ensemble 4n règne inorganique,
se borna chez les anciens à la connaissance rles-pierres précieuses« des substances
les plus utiles. Les «recherches s™ la minéralogie antique ne peuvent donc conduire
à perfectionner la partie théorique de la science; mais ce n’est pas, à notre
avis1; un motif poufles dédaigner. L’histoire littéraire des sciences naturelles éjrt
lije„sous plus d’un rapport, à leur étude; et, sans parler du haut intérêt qu’elle
doit offrir sou» le pbint de -Vue de la marche l’esprit humain, on aio^ra, tant
que le-gopt des études classiques subsistera, a connaître la natués d&ces substances
.minérales¿dont les écrits des anciens ne nons apprennfent queles noms et les
usages; eysurtaüt aussi long-temps qu’existerônt lès chèfsbd’oeuvre déserts qu’ils
nous ont laissés pour modèles, on voudra connaître les noms et la patrie des miné-
raux avec llsquels ces objetsont été créés.
Sou*.le point de vue. de l’utilité directe on devra voir-dans ces recherches,un
moyen de. perfectionna la nomenclature moderne,«¡dont des noms.'ônt étmem-
pruntés, en partie^ la minéralogie des anciens, mais appliqués fort souvent^ des
substances toutes différentes ; on leur trouvera «fin. une tàilité plus directe encore
et de nature à . satisfaire les esprits les plus positifs dafas la découverte qu’elles
amèneront des substances employées jadis, maisdont les'noms'et le gisement étaient
perdus pour nous. Cest ainsi qu’enTprenant pour guide les écrits de Patjsanias, nous
avons retrouvé 1S nom antique et les cargères du magnifique PorpByre qui fait Je
sujet de ce Mémoire, et quinous semble destiné à embellir avant peu les monumenS
d’uné nouvelle Athènes.
§. 2. Le Porphyre vert peut être regardé ébmmè. le type du groupe de loches
plutoniques ou d’origine ignée, qufe nous avons désigné sous le nom de Groupe
entriliqul;, huÀSnstance avec laquelle il se présente dans les localités les, plus
éloignées et l’identité, en tous lieux, de sa composition minéralogique, lui donnent
des droits incontestables à cette désignation.
Mafe «e n’est pas seulement sous, le rapport géognostSpge que cette Roche mérite
iotreattention ; la célébrité dont elle X joui dans l’antiquité, sous le nom de Marbre
de Laconie,*son emploi dans les.monumens où le luxe des Romains l’a prodigué,
et enfin les savantes»-dissertations des archéologies ju i depuis plusieurs siècles
recherchaient sonmom antique et son origine, saqs soupçonner, la plupart du
ü . , m