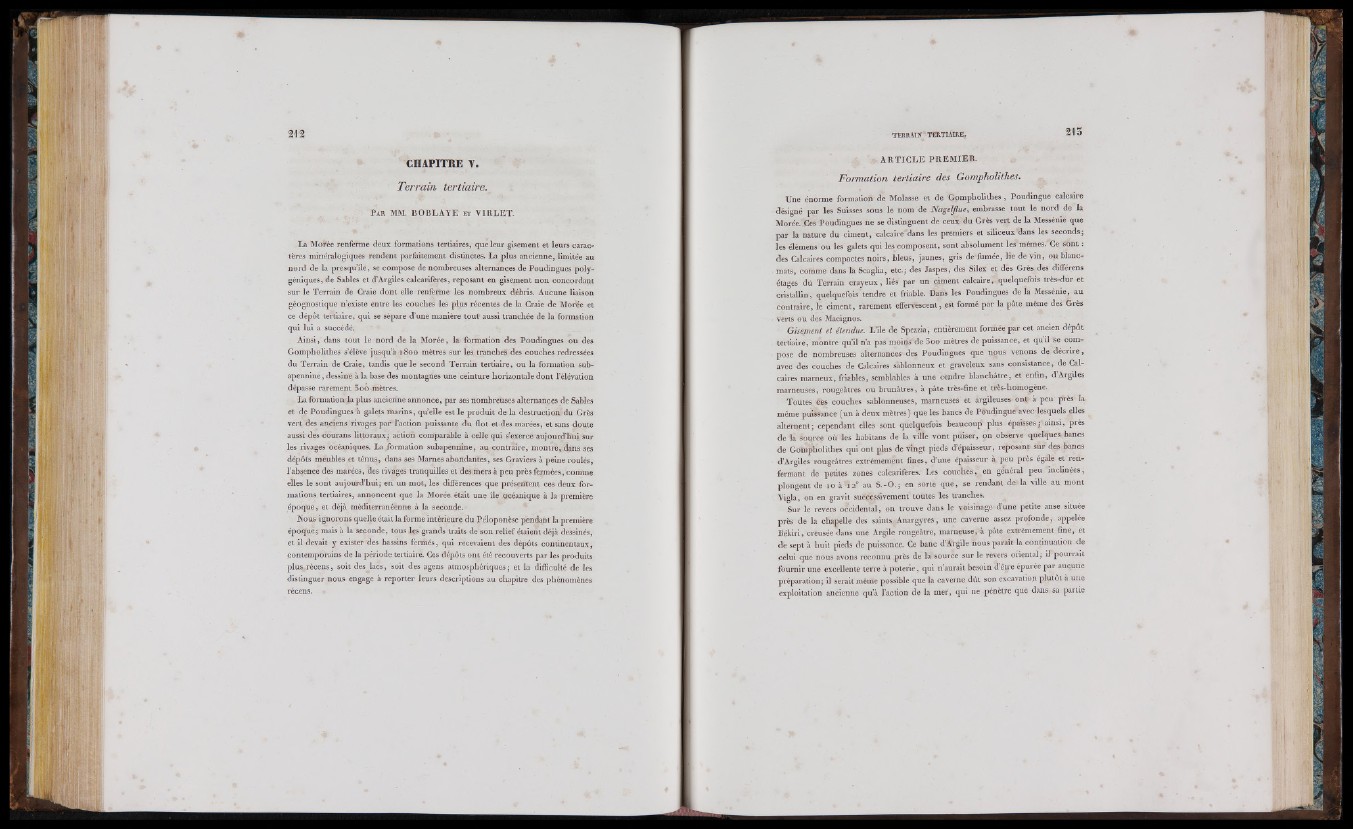
CHAPITRE T.
Terrain tertiaire.
P a r MM. BOBLAYE et VIRLET.
La iMofêé renferme deux formations tertiaires, que leur gisement et leurs caractères
mirtéralogiques rendent parfaitement distinctes. La plus ancienne, limitée au
nord de la presqu’île, se compose de nombreuses alternances de Poudingues poly-
géniques, de Sables et d’Argiles calcarifères, reposant en gisement non concordant
sur le Terrain de Craie dont elle renferme les nombreux débris. Aucune liaison
géognostique n’existe entre les couches les plus récentes de la Craie de Morée et
ce dépôt tertiaire, qui se sépare d’une manière tout» aussi tranchée de la formation
qui lui a succédé;
Ainsi, dans tout le nord de la Morée, la formation des Poudingues ou des
Gompholithes s’élève jusqu’à 1800 mètres sur les trancheë des couches redressées
du Terrain de Craie, tandis que le second Terrain tertiaire, ou la formation sub-
apennine, dessiné à la base des montagnes une ceinture horizontale dont l’élévation
dépasse rarement 3 00-mètres.
La formation-la plus ancienne annonce, par ses nombreuses alternances de Sables
et dg Poudingues à galets marins, qu’elle est le produit de la destruction; du Grès
vert des anciens rivages par l’action puissante du flot et des marées, et sans doute
aussi des courans littoraux; action comparable à celle qui s’exerce aujourd’hui sur
les rivages océaniques. La formation subapennine, au-contraire, montre, cjans ses
dépôts meubles et ténus, dans ses Marnes abondantes, ses Graviers à peine roulés,
l’absence des marées, des rivages tranquilles et des mers à peu près fermées, comme
elles le sont aujourd’hui; en un mot, les différences que présentent ces deux formations
tertiaires, annoncent que la Morée, était une île océanique à la première
époque, et déjà méditerranéenne à la seconçle.-
Nous ignorons queUe était la forme intérieure du Péloponèse pendant la première
époqpe; mais à la seconde, tous les grands traits de son.relief étaient déjà dessinés,
et il devait y exister des bassins fermés, qui recevaient des dépôts continentaux;
contemporains de la période tertiaire. Ces dépôts ont été recouverts par les produits
plu^récens, soit des lacs, soit des agens atmosphériques; et la difficulté de les
distinguer nous engage à reporter leurs descriptions au chapitre des phénomènes
récens. •
ARTICLE PREMIER.
Formation tertiaire des Gompholithes.
Une énorme formation de Molasse et de Gpmpholithes, Poudingue calcaire
désigné par les Suisses sous le nom de Nagelflue, embrasse tout le nord de la
Morée.(Ces Poudingues ne se distinguent de ceux du Grès vert de la Messéniè que
par la nature du ciment, calcairè*dans les premiers et siliceux^8ans les seconds;
les élémens ou lès galets qui les composent, sont absolument les'mêmes/Ce s'Ônt :
des Calcaires compactes noirs, bleus, jaunes, gris de-fumée, lie de vin, op blanc-
. mats, comme dans là Scaglia, etc.; des Jaspes, des Silex et dés Grès.des différens
étages dû Terrain crayeux, liés par un çiment calcaire ^quelquefois très-dur et
cristallin, quelquefois tendre et friable. Dans les Poudingues de la Messénie, au
contraire, le ciment, rarement effervescent, est formé par la pate même des Grès
: vèrts ou des Macignos.
Gisement et étendue. L'île de Spezzia, entièrement formée par cet ancien dépôt
tertiaire, montre qu’il n’a pas moins de 3oo mètres de puissance, et quil se com-
pose de nombreuses alternances-des Poudingues que nous venons de décrire,
avec des couches de Calcaires sablonneux et graveleux sans consistance, de Calcaires
marneux, friables, semblables à une cendre blanchâtre, et enfin, d Argiles
marneuses, rougeâtres ou brunâtres, à pâte très-fine et très-homogène.
Toutes. Ces couches sablonneuses, marneuses et argileuses ont? à peu près'la
même puissance (un à deux mètres) que les bancs de Pôudingue^avec lesquels elles
alternent; cependant elles sont quelquefois beaucoup plus épaisses ;'ainsi, près
delà source ouïes habitans de la ville vont puiser, on .observe quelifues .bancs
de Gompholithes qui ont plus de vingt pieds d’épaisseur, reposant sûr des bancs
d’Argiles rougeâtres extrêmement fines, d’une épaisseur às/peu près égale et renfermant
de petites zones calcarifères. Les couchés,,en général peu inclinées,
plongent de 10 à*12° au S.-O.; en sorte que, se rèndant de*la ville au mont
"Vigla, on en gravit successivement toutes les tranches;
Sur le revers occidental, on trouve dans le voismage-d’une petite anse située
près de la chapelle des saints ;;Anargyres, une caverne assez profonde, appelée
Békiri, crêusée dans une Argile rougeâtre, marneuse, à pate extrêmement fine, et
de sept à huit pieds de puissance. Ce banc d’Argile nous paraît la continuation de
celui que nous avons reconnu .près de lâr source sur le revers oriental; il pourrait
fournir une excellente terre à poterie, qui n’aurait besoin d’être épurée par auqune
préparation; il serait même possible que la caverne dût son excavation plutôt à une
exploitation ancienne qu’à l’action de la mer , qui ne pénètre que dans, sa partie