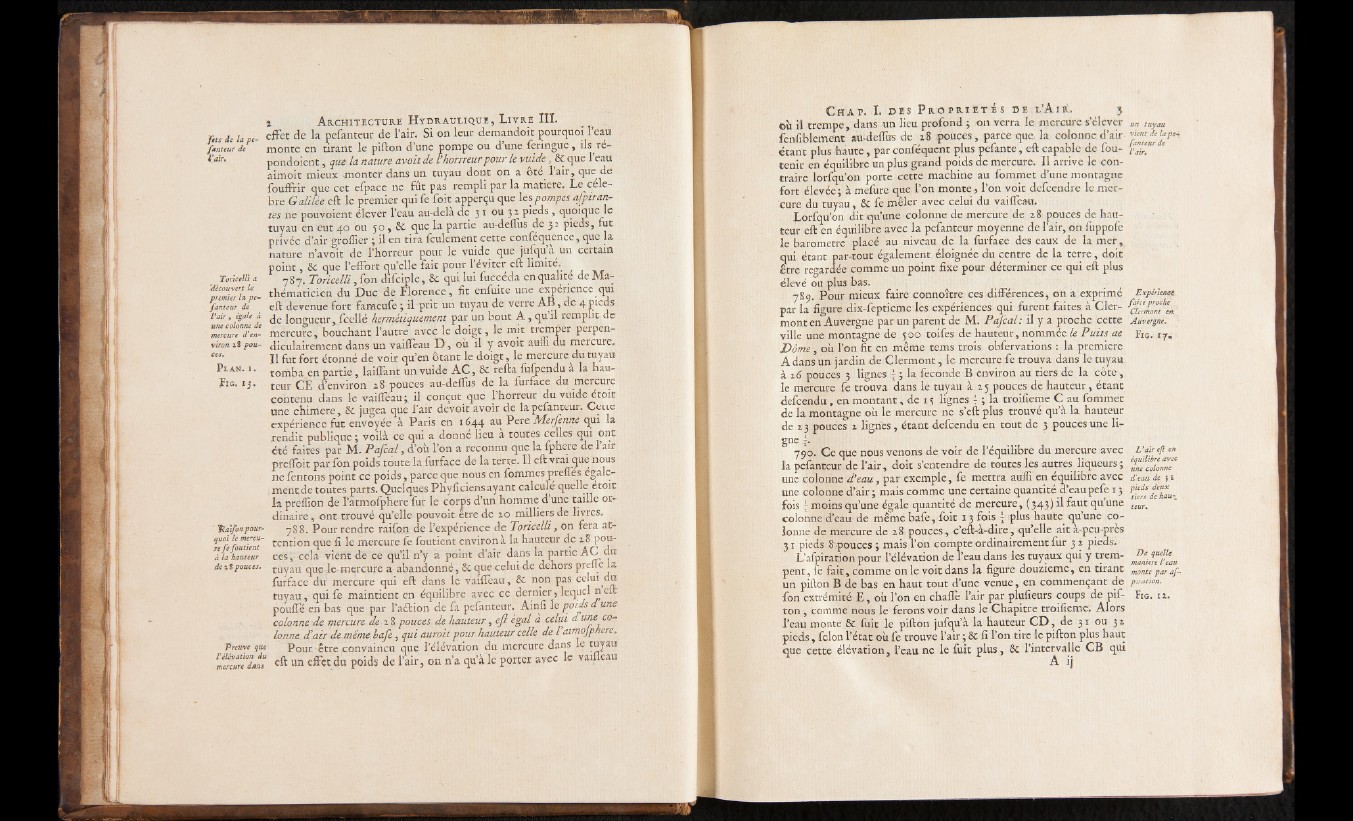
'f it s de la pe-
fauteur de
fair.
Toricelli a
’découvert le
premier la pefanteur
de
Pair t égale a
une colonne de
mercure d’ environ
18 pou-
. ces.
Pian. i .
Fig. 13.
i A rchitecture Hydraulique, Livre III.
effet de la pefanteur de l’air. Si on leur demandoit pourquoi l’eau
monte en tirant le pifton d’une pompe ou dune feringue, ils^re-
pondoient, que la nature avoit de l’horrreurpour le vuide i Sc que Peau
aimoit mieux monter dans un tuyau dont on a ote 1 air, que de
fouffrir que cet efpace ne fût pas rempli par la matière. Le célébré
' Haijonpottr-
quoi le mercure
f e foutient
à la hauteur
de z t pouces.
Preuve que
l ’ élévation du
mercure dans
Galilée eft le premier qui fe foit apperçu que les pompes afptran-
tes ne pouvoient élever l’eau au-delà de 31 ou 3 2 pieds, quoique le
tuyau en eut 40 ou 5 o , Sc que la partie au-deflus de 3 2. pieds, fut
privée d’air groflier ; il en tira feulement cette conféquence, que la
nature n’avoit de l’horreur pour le vuide que jufqu a un certain,
point, 6c que l’effort qu’elle fait pour 1 éviter eft limite. ^
787. Toricelli , fon difciple, 6c qui lui fucceda en qualité de Mathématicien
du Duc de Florence, fit enfuite une expérience qui
eft: devenue fort fameufe ; il prit un tuyau de verre AB, de 4 pieds
de longueur, fcellé hermétiquement par un bout A 5 quil remplit de
mercure, bouchant l’autre avec le doigt, le mit tremper perpen-
diculairement dans un vaiflèau D , ou il y avoit auffi. du mercure.
Il fut fort étonné de voir qu’en ôtant le doigt, le mercure du tuyau
tomba en partie, laliliint un vuide AC, & refta fufpendu a la hauteur
CE d’environ 28 pouces au-deffiis de la furface du mercure
contenu dans le vaiflèau ; il conçut que 1 horreur du vuide etoit
une chimere, jugea que Pair devoit avoir de la pefanteur. Cette
expérience fut envoyée à Paris en 1644 au Pcre Merfenne qui la
rendit publique ; voilà ce qui a donne lieu a toutes celles qui ont
été faites par M. Pafcal, d’ou l’on a reconnu que la fphere de 1 air
prefloit par fon poids toute la furface de la terre. Il eft vrai que nous
ne fentons point ce poids, parce que nous en fommes prefles égale-
mentde toutes parts. Quelques Phyficiens ayant calcule quelle etoit
la preflion de Patmofphcre fur le corps d’un homme d une taille ordinaire,
ont trouvé qu’elle pouvoir etre de 20 milliers de livres.
788. Pour rendre raifon de l’expérience de Toricelli, on fera attention
que li le mercure le foutient environ à la hauteur de 2 8_pou-
ces,- cela vient de ce qu’il n’y a point d’air dans la partie AC dre
tuyau que le, mercure a abandonné, & que celui de dehors prelîe la
furface du mercure qui eft dans le vaiflèau, £c non pas Celui du
tuyau, qui fe maintient en équilibre avec ce dernier, lequel n eft
pouffe en bas que par Paétion de fa pefanteur. Ainfi \c. poids dune
colonne de mercure de 28 pouces de hauteur, efl égal a celui, d «ne colonne
d’air de même hafe, qui auroit pour hauteur celle de l aimojphere.
Pour être convaincu que l’élévation du mercure dans le tuyau
eft un effet du poids de l’air, on n’a qu’à le porter avec le vauleau
C h a t . I. des P r o p r i é t é s de l’A ibI. 3
oh il trempe, dans un lieu profond ; on verra le mercure s’élever
fenfiblement au-deiïus de 28 pouces, parce que la colonne d’air
étant plus haute, par conféquent plus pefante, eft capable de fou-
tenir en équilibre un plus grand poids de mercure. Il arrive le contraire
lorfqu’on porte cette machine au fommet d’une montagne
fort élevée; à mefure que l’on monte, l’on voit defcendre le mercure
du tuyau, St fe mêler avec celui du vaiflèau.
Lorfqu’on dit qu’une colonne de mercure de 28 pouces de hauteur
eft en équilibre avec la pefanteur moyenne de l’air, on fuppofe
le baromètre placé au niveau de la furface des eaux de la mer,
qui étant par-tout également éloignée du centre de la terre, doit
être regardée comme un point fixe pour déterminer ce qui eft plus
élevé ou plus bas.
789. Pour mieux faire connoître ces différences, on a exprimé
par la figure dix-feptieme les expériences qui furent faites à Clermont
en Auvergne par un parent de M. Pafcal: il y a proche cette
ville une montagne de 500 toifes de hauteur, nommée le Puits ae
Dôme, où l’on fit en même tems trois obfervations : la première
A dans un jardin de Clermont, le mercure fe trouva dans le tuyau
à 2 6 pouces 3 lignes i ; la fécondé B environ au tiers de la côte ,
le mercure fe trouva dans le tuyau à 2 5 pouces de hauteur, étant
defeendu, en montant, de 15 lignes 7 ; la troifieme C au fommet
de la montagne où le mercure ne s’eft plus trouvé qu’à la hauteur
de 23 pouces 2 lignes, étant defeendu en tout de 3 pouces une j||
gne î-f : ,
790. Ce que nous venons de voir de l’équilibre du mercure avec
la pefanteur de l’air, doit s’entendre de toutes les autres liqueurs ;
une colonne d’eau, par exemple, fe mettra aùfli en équilibré avec
une colonne d’air; mais comme une certaine quantité d’eaupefe 13
fois j moins qu’une égale quantité de mercure, (343) il faut qu une
colonne d’eau de même bafe, foit 13 fois \ plus haute qu’une colonne
de mercure de 28 pouces, c’eft-à-dire, quelle ait a-peu-pres
31 pieds S pouces ; mais l’on compte ordinairement fur 3 2 pieas.
L’afpiration pour l’élévation de l’eau dans les tuyaux qui y trempent,
fe fait, comme on le voit dans la figure douzième, en tirant
un pifton B de bas en haut tout d’une venue, en commençant de
fon extrémité E , où l’on en chaflè l’air par plufieurs coups de pifton
, comme nous le ferons voir dans le Chapitre troifieme. Alors
l ’eau monte & fuit le pifton jufqu’à la hauteur C D , de 31 ou 32
pieds, félon l’état où fe trouve l’air ; 8t fi l’on tire le pifton plus haut
que cette élévation, l’eau ne le fuit plus, êc l’intervalle CB qui
un tuyau
vient de la pc~i,
fanteur de
l ’air.
Expérience
fa ite proche _
Clermont en.
Auvergne.
Fig. i jé
L ’air efl en
équilibre avec
une colonne
d ’eau de ) 1
pieds deux
tiers de hau\
teur.
D e quelle
maniéré l ’ eau
monte par a f-
pïration.
Fig . i£ .