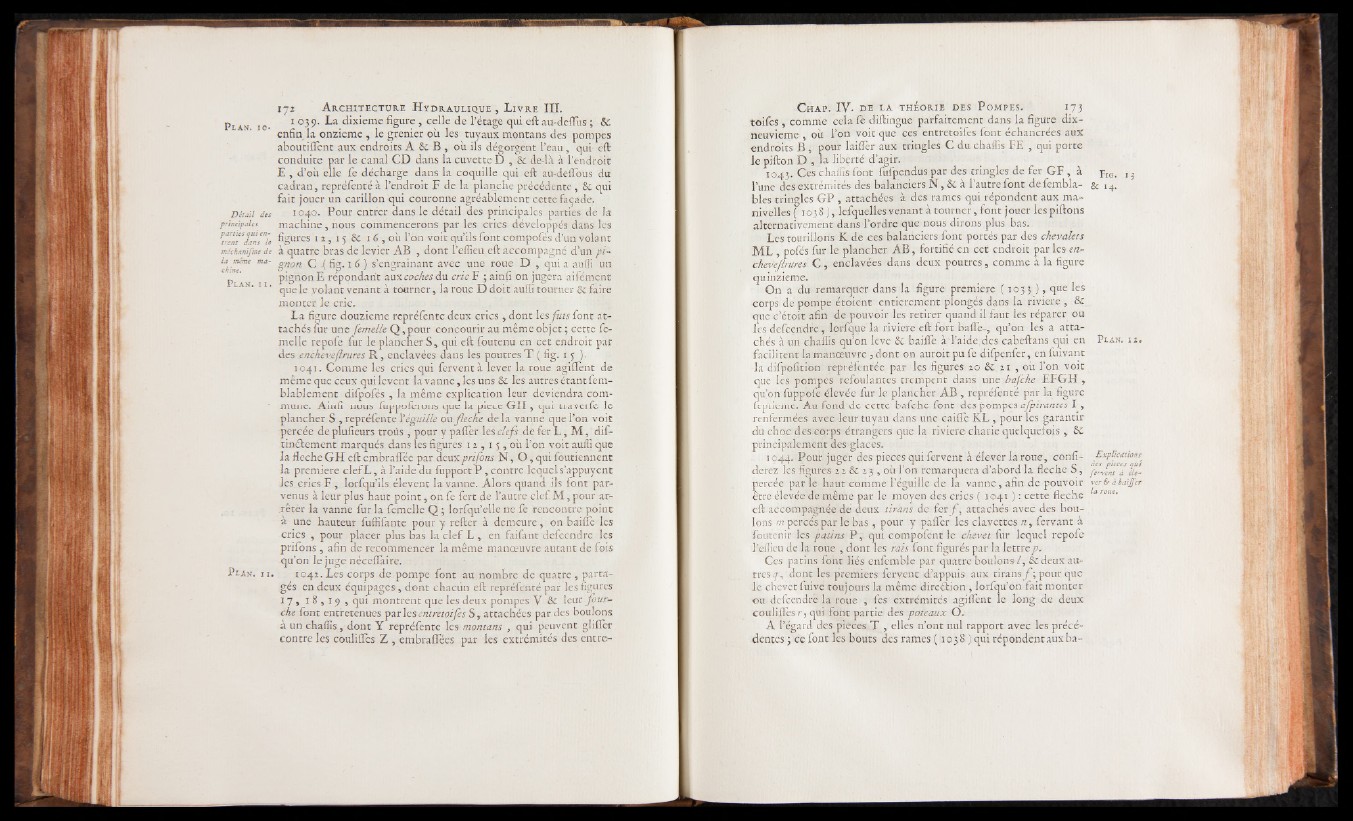
Pia n , io*
Détail des
principales
parties qui entrent
dans le
mêchanifms de
la même machine.
Plan , i i .
Pian . i i .
172 A rchitecture Hydraulique , L ivre III.
1 039. La dixième figure , celle de l’étage qui eft au-deflus ; &
enfin la onzième , le grenier où les tuyaux montans des pompes
aboutiflènt aux endroits A 8t B , où ils dégorgent Peau, qui eft
conduite par le canal CD dans la cuvette D , Si de-là à l’endroit
E , d’où elle fe décharge dans la coquille qui eft au-delTous du
cadran, repréfenté à l’endroit F de la planche précédente, Si qui
fait jouer un carillon qui couronne agréablement cette façade.
1040. Pour entrer dans le détail des principales parties de la
machine, nous commencerons par les crics développés dans les
figures 1 1 , 15 Si 1 6 , où l’on voit qu’ils font compofés d’un volant
à quatre bras de levier AB , dont l’effieu eft accompagné d’un pignon
G .( fig. 16 ) s’engrainant avec une roue D , qui a aufli 1U1
pignonE répondant aux coches du cric F ; ainfi on jugera aifément
que le volant venant à tourner, la roue D doit aufli tourner Si faire
monter le cric.
La figure douzième repréfente deux crics , dont les fuis font attachés
fur une femelle Q , pour concourir au même objet ; cette femelle
repofe fur le plancher S, qui eft foutenu en cet endroit par
des encheveftrures R , enclavées dans les poutres T f fig. 15).
1041. Comme les crics qui fervent à lever la roue agiflènt de
même que ceux qui lèvent la vanne, les uns 6C les autres étant fem-
blablement difpofés , la même explication leur deviendra commune.
Ainfi nous fuppoferons que la piece G H , qui traverfe le
plancher S , repréfente l'égaille ou fléché de la vanne que l’on voit
percée de plufieurs trous , pour y palier les clefs de fer L , M , distinctement
marqués dans les figures 11 , 1 5 , où l’on voit aufli que
la fléché GH eft embralfée par deuxprifons N , O , qui foutiennent
la première clef L , à l’aide du fupport P , contre lequeL s’âppuyent
les crics F , lorfqu ils élevent la vanne. Alors quand ils font parvenus
à leur plus haut point, on fe fert de l’autre clef M , pour arrêter
la vanne fur la femelle Q ; lorfqu’elle ne fe rencontre point
a une hauteur fuffifante pour y relier à demeure, on baillé les
crics , pour placer plus bas la clef L , en faifant defeendre les
priions , afin de recommencer la même manoeuvre autant de fois
qu’on le juge néceflàire.
1041. Les corps de pompe font au nombre de quatre, partagés
en deux équipages, dont chacun eft repréfenté par les figures
1 7 , 1 8 , 1 9 , qui montrent que les deux pompes V & leur fourche
font entretenues par les entretoifes S , attachées par des boulons
à un chaflîs, dont Y repréfente les montans , qui peuvent glillér
contre les coulilfes Z , embralfées par les extrémités des entre-
C hAF. IV. DE LA THÉORIE DES PoMPES. I73
toifes, comme cela fè diftingue parfaitement dans la figure dix-
neuvieme , où l’on voit que ces entretoifes font échancrées aux
endroits B , pour laiflèr aux tringles C du chaflis FE , qui porte
le pifton D , la liberté d’agir.: . . ' . f .
1043. Ces chaflîs font fufpendus par des tringles de fer GF , à
l’une des extrémités des balanciers N , Si à l’autre font de fembla-
bles tringles GP , attachées à des rames qui répondent aux manivelles
( 1038)3 lefquelles venant à tourner, font jouer les pillons
alternativement dans l’ordre que nous dirons plus bas.
Les tourillons K de ces balanciers font portés par des chevalets
ML , pofés fur le plancher A B , fortifié en cet endroit par les enchevêtrures
C ,. enclavées dans deux poutres, comme à la figure
quinzième. .
On a du remarquer dans la figure première ( 1033 ) , que les
corps de pompe étoient entièrement plongés dans la riviere , 6c
que c’étoit afin de pouvoir les retirer quand il faut les réparer ou
les defeendre , lorfque la riviere eft fort baflè-, qu’on les a attachés
à un chaflîs qu’on leve & baillé à l’aide des cabeltans qui en
facilitent la manoeuvre , dont on auroit pu fe difpenfer, en fuivant
la difpofition repréfentée par les figures 10 8t 11 , où l’on voit
que les-pompes refoulantes trempent dans un e bafehe E FG H ,
qu)on fuppofe élevée fur le plancher AB , repréfenté par la figure
leptieme. Au fond de cette bafehe font des pompes afptrantes I ,
renfermées avec leur tuyau dans une caillé KL , pour les garantir
du choc des corps étrangers que la riviere charie quelquefois , Si
principalement des glaces.
1044. Pour juger des pièces qui fervent à élever la roue, confî-
derez les figures z i 6c 13 , où l’on remarquera d’abord la fléché S,
percée par le haut comme l’éguille de la vanne, afin de pouvoir
être élevée de même par le moyen des crics ( 1041 ) : cette fléché
eft accompagnée de deux titans de fer ƒ , attachés avec des boulons
m percés par le bas , pour y palier les clavettes n, fervant à
foutenir les patins P , qui compofent le chevet fur lequel repofe
l ’efiîcu de la roue , dont les rais font figurés par la lettrep.
Ces patins font liés enfemble par quatre boulons/, 6cdeux autres
y, dont les premiers fervent d’appuis aux tirans ƒ ; pour que
le chevet fuive toujours la même direction , lorfqu’on fait monter
ou defeendre la roue , fes extrémités agiflènt le long de deux
coulilfes r, qui font partie des poteaux O.
A l’égard des pièces T , elles n’ont nul rapport avec les précédentes;
ce font les bouts des rames( 1038 ) qui répondent aux ba-
Fig. i 3
& 14.
Plan. 12.
Explications
àes pieces qiit
fervent à élever
& à baijfer
■ la roue.