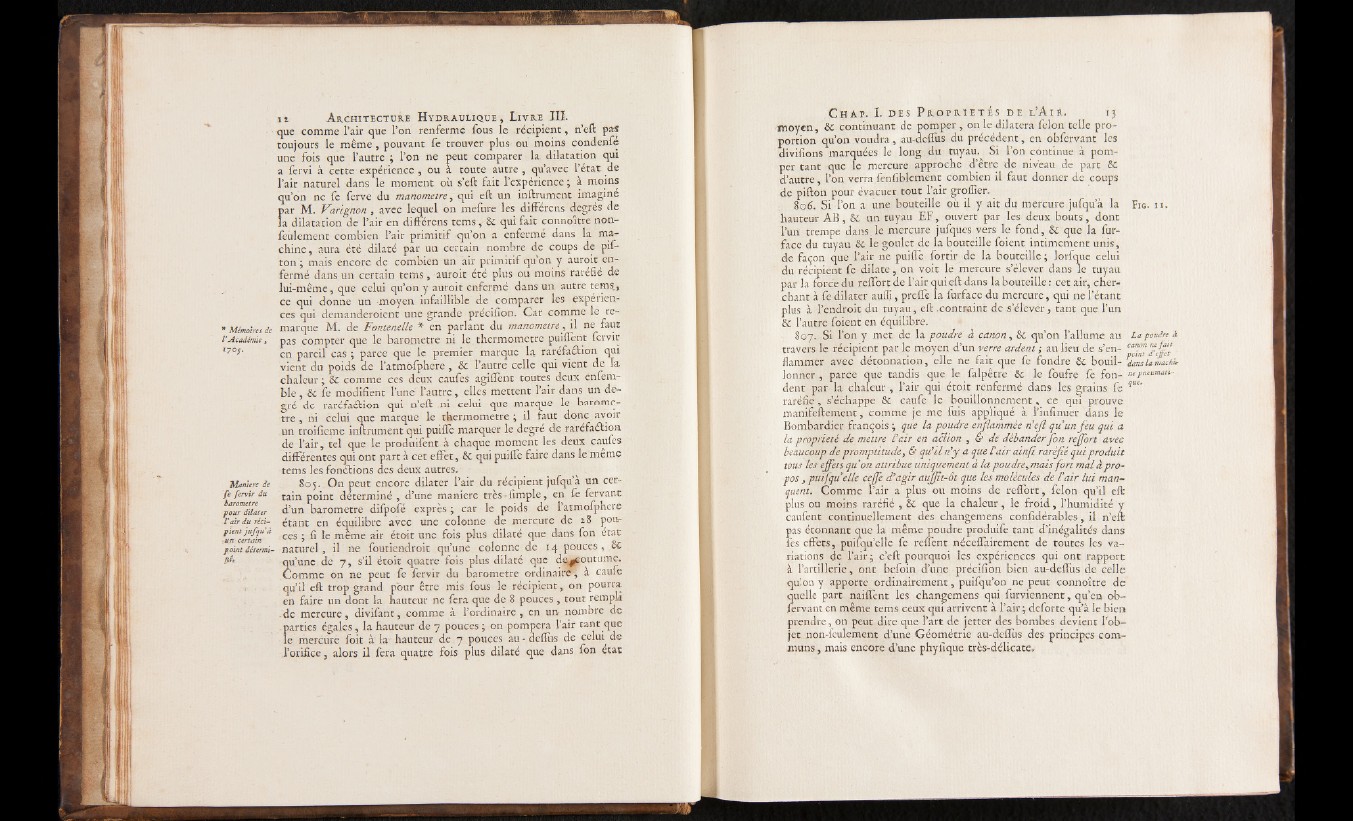
* Mémoires de
V Académie 3
*70j.
Maniéré de
f e fervir du
baromètre
■ pour dilater
l ’air du récipient
ju fq u ’à
■ un- certain
point déterminât.
i l A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v r e I I I .
que comme l’air que l’on renferme fous le récipient, n’eft pas
toujours le même, pouvant fe trouver plus ou moins condenfé
une fois que l’autre ; l’on ne peut comparer la dilatation qui
a fervi à cette expérience , ou à toute autre , qu’avec l’état de
l ’air naturel dans le moment où s’eft fait l’expérience ; à moins
qu’on ne fe ferve du manomètre, qui eft un inftrument imaginé
par M. Varignon , avec lequel on mefure les différens degrés de
la dilatation de l’air en difrérens tems, & qui fait connoitre non-
feulement combien l’air primitif qu’on a enferme dans la machine
, aura été dilaté par un certain nombre de coups de pif-
ton ; mais encore de combien un air primitif qu’on y auroit enfermé
dans un certain tems, auroit été plus ou moins raréfié de
lui-même, que celui qu’on y auroit enfermé dans un autre tems.,
ce qui donne un moyen infaillible de comparer les expériences
qui demanderoient une grande précifion. Car comme le remarque
M. de Fontenelle * en parlant du manomètre, il ne faut
pas compter que le baromètre ni le thermomètre puiflènt fervir
en pareil cas ; parce que le premier marque la raréfaction qui
vient du poids de l’atmofphere , St l’autre celle qui vient de la
chaleur ; St comme ces deux caufes agiffent toutes deux énlem-
b le , 8t fe modifient l’une l’autre, elles mettent l’air dans un degré
de raréfaétion qui n'elt ni celui que marque le baromètre
, ni celui que marque le thermomètre ; il faut donc avoir
un troifieme inftrument qui puiftè marquer le degré de rarefaétioa
de l’air, tel que le produifent à chaque moment les deux caufes
différentes qui ont part à cet effet, St qui puiftè faire dans le meme
tems les fondions des deux autres.
805. On peut encore dilater l’air du récipient jufqu’à un cet-
tain point déterminé , d’une maniéré très-fîmple, en fe fervant
d’un baromètre difpofé exprès ; car le poids de l’atmofphere
étant en équilibre avec une colonne de mercure de 18 pouces
; fi le meme air étoit une fois plus dilaté que dans fon état
naturel, il ne foutiendroit qu’une colonne de 14 pouces, St
qu’une de 7 , s’il étoit quatre fois plus dilaté que dq^coutume.
Comme on ne peut fe fervir du baromètre ordinaire, à caufe
qu’il eft trop grand pour être mis fous le récipient, on pourra,
en faire un dont la hauteur ne fera que de 8 pouces , tout rempli
de mercure, divifant, comme à l’ordinaire, en un nombre de
parties égales, la hauteur de 7 pouces ; on pompera l’air tant que
le mercure foit à la- hauteur de 7 pouces au - deflùs de celui de
l’orifice, alors il fera quatre fois plus dilaté que dans fon état
C h A t. I. des P r o p r ié t é s de l’A ir . 13
moyen, 8c continuant de pomper , on le dilatera félon telle proportion
qu’on voudra, au-deflùs du précédent, en obfervant les
divifions marquées le long du tuyau. Si l’on continue à pomper
tant que le mercure approche "d’être de niveau de part 8c
d’autre, l’on verra fenfiblement combien il faut donner de coups
de pifton pour évacuer tout l’air grofîier.
806. Si; l’on a une bouteille où il y ait du mercure jufqu a la Fig. i i .
hauteur AB , &c un tuyau EF, ouvert par les deux bouts, dont
l’un trempe dans.le mercure jufques vers le fond, & que la fur-
face du tuyau 8c le goulet de la bouteille foient intimement unis,
de façon que l’air ne puiftè fortir de la bouteille ; lorfque celui
du récipient fe dilate, on voit le mercure s’élever dans le tuyau
par la force du reflort de l’air qui eft dans la bouteille : cet air, cherchant
à fe dilater aufli, preflè la fur-face du mercure, qui ne l’étant
plus àj-L’endroit du tuyau, eft .contraint de.s’élever, tant que l’un
& l’autre foient en équilibre.
807. Si l’on y met de la poudre à canon, &C qu’on l’allume au Lu poudre A
travers le récipient par le moyen d’un verre ardent ; au lieu de s’en-
flammër avec détonnation, elle ne fait que fe fondre 8c bouil- ^iansUmachu-
lonner , parce que tandis que le falpêtre & le fbufre fe fon- nepneumati-
dent par la chaleur , l’air qui étoit renfermé dans les grains fe q“e’
raréfie , s’échappe 8c caufe le bouillonnement, ce qui prouve
manifeftement, comme je me fuis appliqué à l’infinuer dans le
Bombardier françois ; que la poudre enflammée riefl qu’un feu qui a
la propriété de mettre l’air en action , & de débander fon reflort avec
beaucoup de promptitude, & qu’il n’y a que l'air ainfi raréfié qui produit
tous les effets qu’on attribue uniquement à la poudre, mais fort mal à propos
, puifqu’elle ceffe d’agir auflil-ôt que les molécules de l ’air lui manquent.
Comme l’air a plus ou moins de reflort, félon qu’il eft
plus ou moins raréfié , 8c que la chaleur, le froid, l’humidité y
caufent continuellement des changemens confidérables, il n’eft
pas étonnant que la même poudre produife tant d’inégalités dans
fes effets, puifqu’elle fe reflènt néceflàirement de toutes les variations
de l’air; c’eft pourquoi les expériences qui ont rapport
à l’artillerie, ont befoin d’une précifion bien au-deffùs de celle
quion y apporte ordinairement, puifqu’on ne peut connoître de
quelle part naiftènt les changemens qui furviennent, qu’en obfervant
en même tems ceux qui arrivent à l’air ; deforte qu’à le bien
prendre, on peut dire que l’art de jetter des bombes devient l’objet
non-feulement d’une Géométrie au-deflùs des principes communs
, mais encore d’une phyfique très-délicate.