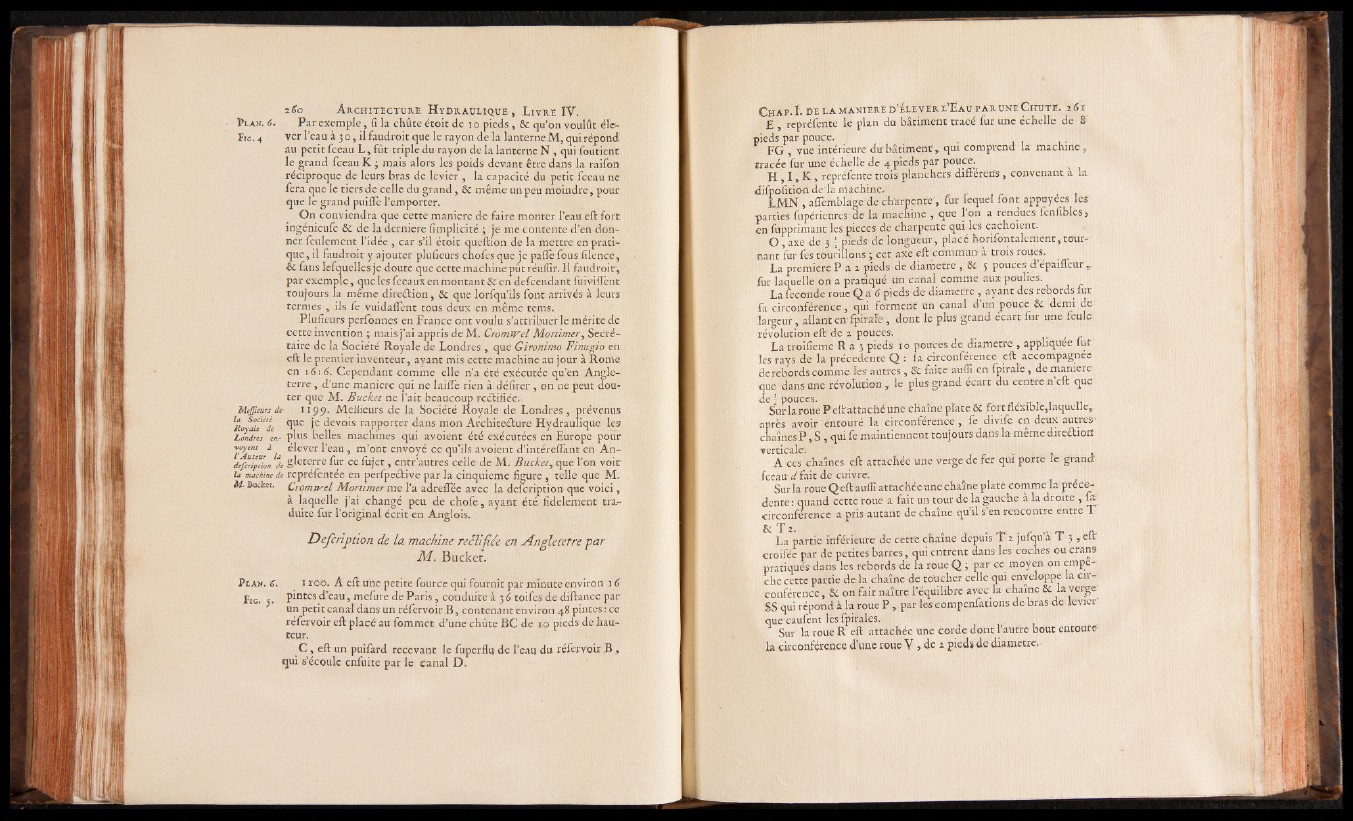
iSo A rchitecture H ydraulique , L ivre IV.
P lan. 6. Par exemple, fi la chûte étoit de 10 pieds, & qu’on voulût élc-
Fic. 4 ver l’eau à 3 o , il faudroit que le rayon de la lanterne M, qui répond’
au petit fceau L , fût triple du rayon de la lanterne N , qui foutient
le grand fceau K ; mais alors les poids devant être dans la raifon
réciproque de leurs bras de levier , la capacité du petit fceau ne
fera que le tiers de celle du grand, SC même un peu moindre, pour
que le grand puilfe l’emporter.
On conviendra que cette maniéré de faire monter l’eau eft fort
ingénieufe & de la derniere fimplicité ; je me contente d’en donner
feulement l’idée , car s’il étoit queftion de la mettre en pratique
, il faudroit y ajouter plufieurs chofesque je paflèfous filence,
& fans lefquelles je doute que cette machine pût réuflir. Il faudroir,
par exemple, que les fceaux en montant & en defeendant fuivilïènt
toujours la même direction, 6c que lorfqu’ils font arrivés à leurs
termes , ils fe vuidaflènt tous deux en même tems.
Plufieurs perfonnes en France ont voulu s’attribuer le mérite de
cette invention ; maisj’ai appris de M. Cromwel Mortimer, Secrétaire
de la Société Royale de Londres , que Gironimo Finugio en
eft le premier inventeur, ayant mis cette machine au jour à Rome
en 1616. Cependant comme elle n’a été exécutée qu’en Angleterre,
d’une maniéré qui ne laifle rien à délirer , on ne peut douter
que M. Bucket ne l ’ait beaucoup rectifiée.
Mejjieurs de- 11 pp. Meilleurs de la Société Royale de Londres, prévenus
lRo Sau“ de <lue Ie Revois rapporter dans mon Architecture Hydraulique les
Londres en- plus belles machines qui avoient été exécutées en Europe pour
voyent à ^ élever l’eau, m’ont envoyé ce qu’ils avoient d’in té reliant en An-
defcrïfnion de ghterre fur ce fujet, entr’autres celle de M. Bucket, que l’on voit
la machine de repréfentée en perfpeétive par la cinquième figure , telle que M,
I L Bucket. Cromjyel Mortimer me l'a adrellee avec la delcription que voici,
à laquelle j’ai changé peu de chofe, ayant été. fidèlement traduite
fur l’original écrit en Anglois..
Defcription de la machine rectifiée en Angleterre par
M . Bucket.
Pia n . 6. i ïO0. A eft une petite fource qui fournit par minute environ 16
Fig. 5. P*ntes d’eau, mefure de Paris, conduites 3 6 toifes de diftance par
un petit canal dans un réfervoir B , contenant environ 48 pintes: ce'
réfervoir eft placé au fommet d’une chûte BC de 10 pieds de hauteur.
C , eft un puifard recevant le fuperflu de l’eau du réfervoir B ,
qui s’écoule enfuite par le canal D.
C h A P . f . D E L A M A N IE R E D ’ E L E V E R L’EaU P A R U N E C h U T E . 2 6 t
E , repréfente le plan du bâtiment tracé fur une échelle de 8
pieds par pouce.
FG , Vue intérieure du' bâtiment,. qui comprend la machine ,
tracée fur une échelle de 4 pieds par pouce.
H , I , K ,. repréfente trois planchers différents , convenant a la
difpofiuon de là machine.- .
LMN , aflemblagede charpente', fur lequel font appuyées les'
parties fupérieures' de la machine , que 1 on a rendues fenfibles,
en fupprimant les pièces de charpente qui les cachoient.
O , axe de 3 § pieds de longueur, placé borifûntalement, tournant
fur fes tourillons ; cet axe eft commun a trois roues.
La première P a r pieds de diamètre ,6e 5 pouces d epàifïeür --
ftir laquelle on a pratiqué un Canal comme aux poulies.
La fécondé roue Q a <S pieds de diamètre , ayant des rebords fur
fa circonférence, qui forment Un canal d un pouce 6e demi de
largeur, allant en fpiralc , dont le plus grand écart fur une feule'
révolution eft de 2 pouces. . , r
La troifieme R a 3 pieds 10 pouces de diamètre', appliquée lut
les rays de la précédente Q : fa circonférence eft accompagnée
de rebords comme les autres , 81 faite aulîi en fpiralé , de maniéré
que dans une révolution,, le plus grand écart du centre n eft que
de} pouces. , 1 11
Sur la roue P eft attaché une chaîne plate & fort flexible,laquelle;,
apres avoir entouré la circonférence , fe divife en deux autres'
chaînes P , S , qui fe maintiennent toujours dans la même direétiotf
verticale:
A ces chaînes eft attachée une verge de fer qui porte le grand
fceau- d fait de cuivre. ,
Sur la roue Q eft aulïï attachée une chaîne plate comme la precc-
dente : quand cette roue a fait un tour de la gauche a la droite 9 far
circonférence a pris autant- de chaîne qu’il s’en rencontre entre T
6C T 2. r >' rr* LL.
La partie inférieure de cette chaîne déplus I i julqu a 1 3 , elt
croifée par de petites barres, qui entrent dans les coches ou crans
pratiqués-dans les rebords dé la roue Q ; par ce moyen on empe-
che cette partie de la chaîne de toucher celle qui enveloppe la circonférence,
6c on fait naître l’équilibre avec la chaîne Sc la verge
SS qui répond à la roue P , par les eompenfations debras de levier:
quecaufent lèsfpirales.-
Sur la roue R eft attachée une corde dont l’autre bout entour©
la circonférence d’une roue V 5 de 1 pieds de- diamètre. -