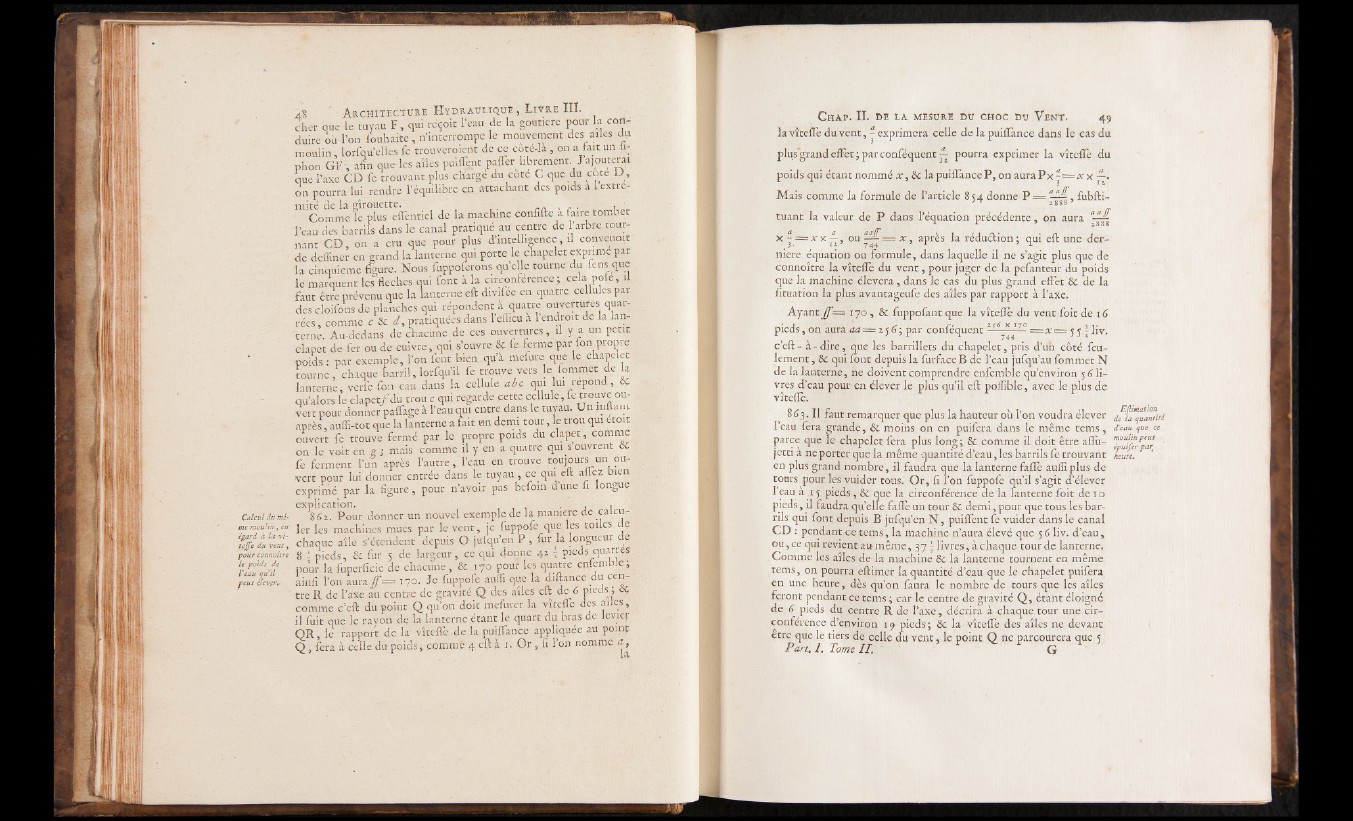
Calcul du même
moulin, eu
égard à la vi-
pejje dpi vent,
pour connoître
le poids de
l'eau qu'il •
peut (fevçr, .
4§ " A rchitecture Hydraulique , Livre ÏIÏ.
cher que le tuyau F , qui reçoit l’eau de la goutiere pour la conduire
où l’on fouhaite , n’interrompe le mouvement des ailes du
moulin, lorfqu’elles fe trouveroient de ce coté-la , on a fait un li-
phon GF , afin que les ailes puiflènt paffer librement. J ajouterai
que l’axe CD fe trouvant plus chargé du cote C que du cote D ,
on pourra lui rendre l’équilibre en attachant des. poids a 1 extrémité
de la girouette. , r . • .,'.V
Comme le plus effentiel de la machine confifte a faire tomber
l’eau des barrils dans le canal pratiqué au centre de l’arbre tournant
C D , on a cru que pour plus d’intelligence, il convenoit
de deffiner en grand la lanterne qui porte lexbapelet exprimé par
la cinquième figure. Nous fuppoferons qu’elle tourne du fens que
le marquent les fléchés qui font à la circonférence ; cela polé, il
faut être prévenu que la lanterne cft divifee en quatre cellules pat
des cloifons de planches qui répondent S | | | | | ouvertures quar-,
rées, comme c & d , pratiquées dans l’eflieu a. 1 endroit de la lanterne.
Au-dedans de chacune de ces ouvertures , il y a un petit
clapet de fer ou de cuivre, qui s’ouvre Sc fe ferme par Ion propre
poids : par exemple, l’on fent bien, qu’a.meftire que le chapelet
tourne, chaque barril, lorfqu’il fe trouve vers le fommet de la
lanterne, verfe fon eau dans la cellule abc qui lui répond, 8ç
qu’alors le clapet/du trou c qui regarde cette cellule, fe trouve ouvert
pour donner paflfage à l’eau qui entre dans le tuyau. Un mitant
après auffi-tot que la lanterne a fait un demi tour, le trou qui etoit
ouvert fe trouve fermé par le propre poids du clapet, comme
on le voit en g j mais comme il y en a quatre qui s ouvrent £c
fe ferment l’un après l’autre, l’eau en trouve toujours un ouvert
pour lui donner entrée dans le tuyau , ce qui elt allez bien
exprimé par la figure, pour n’avoir pas befom d une. fi longue
explication. . , ,
862. Pour donner un n o u v e l exemple de la manière de ealcuv
1er les machines mues par le vent, je fuppofe que les toiles de
chaque aîle s’étendent depuis O jufqu’en P , fur la longueur de
8 - pieds, St fur 5 de largeur, ce qui donne 41 pieds quartes
pour la fuperficie de chacune, Si 170 pour les quatre ensemble;
ainfî l’on a u ra /— 170. Je fuppofe auffi que la diftance du centre
R de l’axe au centre de gravité. Q des aîles eft de 6 pieds , St
comme c’eft du point Q qu’on doit mefurer la vîteflè des ailes ,
il fuit que le rayon de la lanterne étant le quart du bras de leviej:
Q R , le rapport de la vîteife de la puiflance appliquée au point
Q , fera à celle du poids, comme 4 eft à i . O r , fi l’on nomme <z,
CfitAP. II. DE LA MESURE DU CHOC DU VENT. 49
la vîteflè du vent, ~ exprimera celle de la puiflance dans le cas du
plus’grand effet ; par conféquent W. pourra exprimer la vîteflè du
poids qui étant nommé x , 8t la puiflance P, on auraPx j = a x / .
Mais comme la formule de l’article 854 donne P = î é / , fubfti-
tuant la valeur de P dans l’équation précédente, on aura
x a x / , ou = x., après la réduction ; qui eft une dernière
équation ou formule, dans laquelle il ne s’agit plus que de
connoître la vîteflè du vent, pour juger de la pefanteur du poids
que la machine élevera, dans le cas du plus grand effet St de la
fituation la plus avantageufe des aîles par rapport à l’axe.
A y a n t/= 170 , St fuppofant que la vîteflè du vent foit de 16
pieds, on aura aa = 2 5 6 ; par conféquent — ” I7° = x = j / Üv.
c’eft - à-dire, que les barrillets du chapelet, pris d’un côté feulement
, St qui font depuis la furface B de l’eau jufqü’au fommet N
de la lanterne, ne doivent comprendre enfemble qu’environ 561/
vres d’eau pour en élever le plus qu’il eft pollible, avec le plus de
vîteflè. '
863. Il faut remarquer que plus la hauteur où l’on voudra élever
l’eau fera grande, St moins on en puifera dans le même tems,
parce que le chapelet fera plus long; St comme il doit être aflù-
jetti a ne porter que la même quantité d’eau, les barrils fe trouvant
en plus grand nombre, il faudra que la lanterne faflè auffi plus de
tours pour les vuider tous. O r, fi l’on fuppofe qu’il s’agit d’élever
l ’eau à .15 pieds, St que la circonférence de la lanterne foit de 1 o
pieds, il faudra qu’elle faflè un tour St demi, pour que tous les barrils
qui font depuis B jufqu’en N , puiflènt fe vuider dans le canal
CD : pendant ce tems, la machine n’aura élevé que 5 6 liv. d’eau,
ou, ce qui revient au même, 37 Ç livres, à chaque tour de lanterne.
Comme les aîles de la machine 8t la lanterne tournent en même
tems, on pourra eftimer la quantité d’eau que le chapelet puifera
en une heure, dès qu’on faura le nombre de tours que les aîles
feront pendant ce tems ; car le centre de gravité Q , étant éloigné
de 6 pieds du centre R de l’axe, décrira à chaque tour une circonférence
d’environ 19 pieds; 8t la vîteflè des aîles ne devant
etre que le tiers de celle du vent, le point Q ne parcourera que y
Part.l. Tome II, G
Ejlimation
de la quantité
d'eau que ce
moulin peut
épuifer par^
heure.