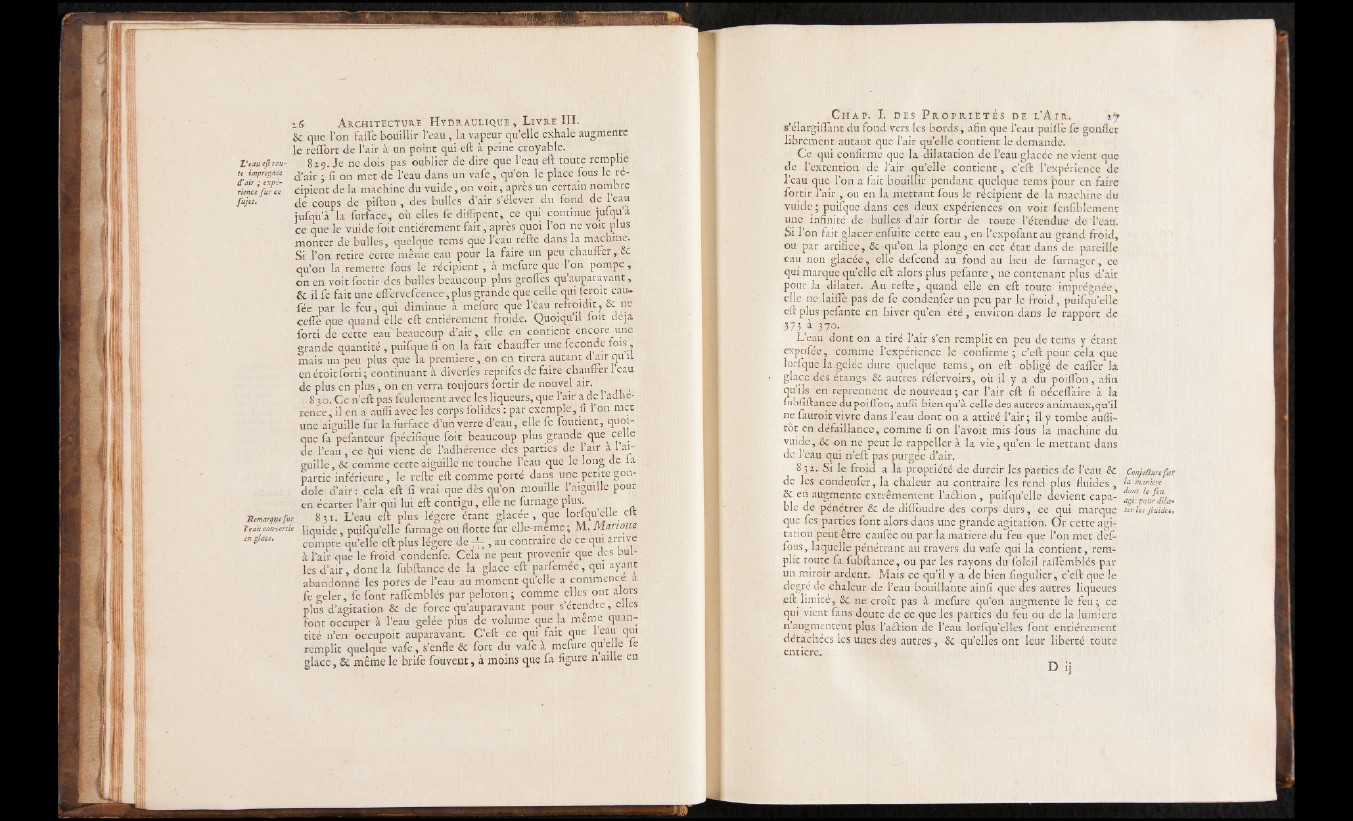
Z 'eau eft toute
imprégnée
d’air ; expérience
fur ce
fuja.
î 6 A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v r e III.
gC que l’on faffe bouillir l’eau, la vapeur qu’elle exhale augmente
le reffort de l’air à un point qui eft à peine croyable.
829. Je ne dois pas oublier de dire que l’eau eft toute remplie
d’air ; lî on met de l’eau dans un vafe, qu’on le place fous le récipient
!Remarque fur
Veau convertie
en glace.
de la machine du vuide, on voit, après un certain nombre
de coups de pifton , des bulles d’air s’élever du fond de l’eau
jufqu’à la furface, où elles fe diffipent, ce qui continue jufqu’a
ce que le vuide foit entièrement fait, après quoi l’on ne voit plus
monter de bulles, quelque tems que l’eau refte dans la machine.
Si l’on retire cette même eau pour la faire un peu chauffer, ôc
qu’on la remette fous le récipient, a mefure que 1 on pompe ,
on en voit fortir des bulles beaucoup plus groflés qu auparavant,
il fe fait une effervefcence, plus grande que celle qui feroit cau-
fée par le feu, qui diminue à mefure que léau refroidit, St ne
ceffe que quand elle eft entièrement froide. Quoiqu’il foit déjà
forti de cette eau'beaucoup d’a ir, elle en contient encore une
grande quantité , puifque li on la fait' chauffer une fécondé fois ,
mais un peu plus que la première, on en tirera autant d air qu il
çnétoit forti ; continuant à diverfes reprifes de faire chauffer 1 eau
de plus en plus, on en verra toujours fortir de nouvel air.
: : 8 3.0. Ce n’eft pas feulement avec les liqueurs, que l’air a de 1 adhérence
, il en a auffi avec les corps folides : par exemple, fi l’on mec
une aiguille fur la furface d’un verre d’eau, elle fe foutient, quoique
fa pefantcur fpécifique foit beaucoup plus grande que^ celle
de l’eau, ce qui vient de l’adhérence des parties de 1 air a l aiguille
, ôc comme cette aiguille ne touche l’eau que le long de la
partie inférieure, le refte eft comme porte dans une petite gon-
dole d’air: cela eft'fi vrai que dès qu’on mouille l’aiguille pour
en écarter l’air qui lui eft contigu, elle ne fumage plus.
831. L’eau eft plus légère étant glacée, que lorfquelle ci«
liquide, puifqu’elle fumage ou flotte fur elle-meme ; M. Mariette
compte “qu’elle eft plus légère de.^J, au contraire de ce qui arrive
à l’air que le froid condenfe. Cela 11e peut provenir que des bulles
d’air, dont la fubftance de la glace eft parfemée, qui ayant
abandonné les pores de l’eau au moment quelle a commence a
fe geler, fe font raffemblés par peloton ; comme elles ont alors
plus d’agitation 8c de force qu’auparavant pour s’étendre, elles
Font occuper à l’éau gelée plus de volume que la même quantité
n’en- occupoit auparavant. C’eft ce qui fait que 1 eau qui
remplit quelque vafe, s’enfle ÔC fort du vafe à mefure quelle le
glace, 8c même le brife fouvent, à moins que fa figure n aille en
C h a p . E des P r o p r i é t é s de l’A tr.
s’élargiflant du fond vers les bords, afin que l’eau puiffe fe gonfler
librement autant que l’air qu’elle contient le demande.
Ce qui confirme que la dilatation de l’eau glacée ne vient que
de l’extention de l'a irq u ’elle contient, c’eft l’expérience de
l ’eau que l’on a fait bouillir pendant quelque tems pour en faire
fortir l ’air , ou en la mettant fous le récipient de la machine du
vuide ; puifque dans ces deux expériences on voit fenfiblement
une, infinité de bulles d’air fortir de toute l’étendue de l’eau.
Si l’on fait glacer enfuite cette eau, en l’expofant au grand froid,
ou par artifice, ôc qu’on la plonge en cet état dans de pareille
eau non glacée, elle defeend au fond au lieu de furnager, ce
qui marque qu’elle eft alors plus pefante, ne contenant plus d’air
pour la dilater. Au refte, quand elle en eft toute imprégnée;
elle ne laiflè pas de fe condenfer un peu par le froid, puifqu’elle
eft plus pefante en hiver qu’en été, environ dans le rapport de
373 à 37Qî;#
L’eau dont on a tiré l’air s’en remplit en peu de tertis y étant
expofée, conjme l’expérience le confirme ; c’eft pour cela que
lorfque la-gelée dure quelque tems , on eft obligé de caffer la
glace des étangs 8c autres réfervoirs, où il y a du poiffon, afin
qu’ils en reprennent de nouveau ; car l’air eft fi néceffaire à la
lùbfiftance du poiffon, aufli-bien qu’à celle des autres animaux,qu’il
ne fauroit vivre dans l’eau dont on a attiré l’air ; il y tombe aufli-
tot en défaillance, comme fi on l’a voit mis fous la machine du
vuide, ôc on ne peut le rappeller à la vie, qu’en le mettant dans
de l’eau qui n’eft pas purgée d’air.
831. Si le froid a là propriété de durcir les parties de“l’eau ôc
de les condenfer, la chaleur au contraire les rend plus fluides ,
& en augmente extrêmement l’aétion , puifqu’elle devient capable
de pénétrer ôc de difloudre des corps durs, ce qui marque
que fes parties font alors dans une grande agitation. Or cette agitation
peut être caufée ou par la matière du feu que l’on met défi-
fous, laquelle pénétrant au travers du vafe qui la contient, remplit
toute fa,fubftance, ou par les rayons du foleil ralîèmblés par
un miroir ardent. Mais ce qu’il y a de bien fi-ngulier, c’eft que le
degré de chaleur de l’eau bouillante ainfi que des autres liqueurs
.eft limité-, ôc ne croît pas à mefure qu’on augmente le feu ; ce
qui vient fans doute de ce que les parties du feu ou de la lumière
1-1’augmentent plus l’action de l’eau lorfqu’elles font entièrement
détachées les unes-des autres , ôc qu’elles ont leur liberté toute
entière.
D ij
Conjecture fut,
la maniéré
dont le feu
agit pour dilater
les fluides,