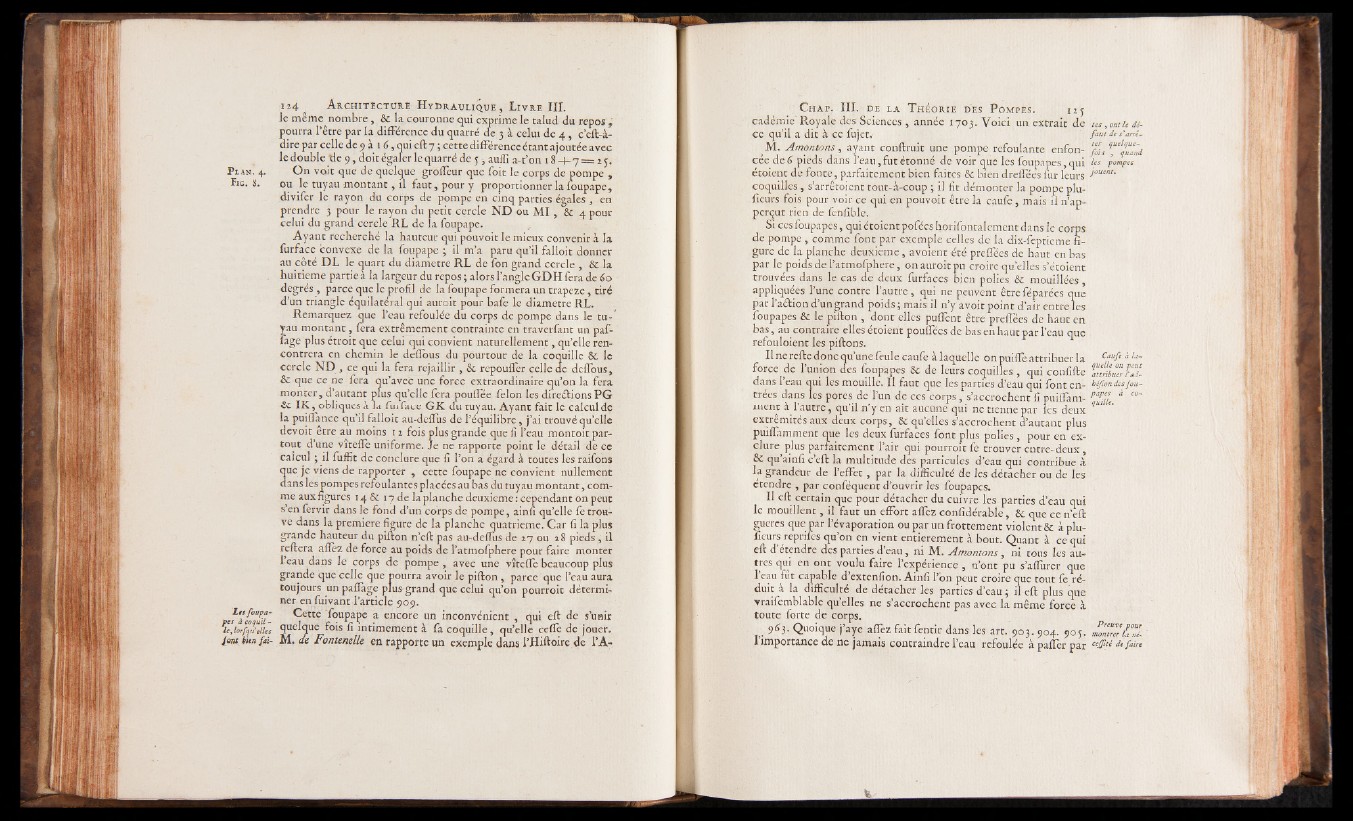
P lan. 4.
Fig. 8.
le s foupapes
à coquil -
le, lorfqu’ elles
jent kien fai-
114 A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v r e III.
le même nombre, ô£ la couronne qui exprime le talud du repos »
pourra l’être par la différence du quarré de 3 à celui de 4 , c’eft-à-
dire par celle de 9 à 16, qui eft 7 ; cette différence étant ajoutée avec
le double tle 9, doit égaler le quarré de j , auffi a-t’on 18-4-7 = 25.
On voit que de quelque groflèur que foit le corps de pompe ,
ou le tuyau montant, il faut, pour y proportionner la foupape,
divifer le rayon du corps de pompe en cinq parties égales , en
prendre 3 pour le rayon du petit cercle ND ou M I , 8C 4 pour
celui du grand cercle RL de la foupape.
Ayant recherché la hauteur qui pouvoit le mieux convenir à la
furface convexe de la foupape ; il m’a paru qu’il falloit donner
au côté DL le quart du diamètre RL de fon grand cercle , & la
huitième partie a la largeur du repos ; alors l’angle GDH fera de 60
degrés , parce que le profil de la foupape formera un trapeze, tiré
d’un triangle équilatéral qui auroit pour bafe le diamètre RL.
Remarquez que l’eau refoulée du corps de pompe dans le tuyau
montant, fera extrêmement contrainte en traverfant un paf- '
fage plus étroit que celui qui convient naturellement, qu’elle rencontrera
en chemin le deflous du pourtour de la coquille & le
cercle ND , ce qui la fera rejaillir , & repoufler celle de deffous,
& que ce ne fera qu’avec une force extraordinaire qu’on la fera
monter, d’autant plus qu’elle fera pouffée félon les directions PG
& IK , obliques à la furface GK du tuyau. Ayant fait le calcul de
la puiffànce qu’il falloit au-deflus de l’équilibre , j’ai trouvé qu’elle
devoit être au moins 12 fois plus grande que fi l’eau montoit partout
d’une vîteffe uniforme. Je ne rapporte point le détail de ce
calcul ; il fuffit de conclure que fi l’on a égard à toutes les raifons
que je viens de rapporter , cette foupape ne convient nullement
dans les pompes refoulantes placées au bas du tuyau montant, comme
aux figures 14 & 17 de la planche deuxieme : cependant on peut
s en fervir dans le fond d’un corps de pompe, ainfi qu’elle fe trouve
dans la première figure de la planche quatrième. Car fi la plus
grande hauteur du pifton n’eft pas au-deflus de 27 ou 28 pieds, il
refiera allez de force au poids de l’atmofphere pour faire monter
1 eau dans le corps de pompe , avec une vîteflè beaucoup plus
grande que celle que pourra avoir le pifton, parce que l’eau aura
toujours un pafîàge plus-grand que celui qu’on potirroit déterminer
en fuivant l’article 909.
Cette foupape a encore un inconvénient , qui eft de s’unir
quelque fois fi intimement à fa coquille, qu’elle ceflë de jouer.
M, de Fontenelk en rapporte un exemple dans l’Hiftoire de l’AChap.
III. de la T héorie des Pompes. 125
cadémie'Royale des Sciences , année 1703. Voici un extrait de
ce qu’il a dit à ce fujet.
M. Amenions, ayant confirait une pompe refoulante enfoncée
de6 pieds dans l’eau,fut étonné de voir que les foupapes, qui
étoient de fonte, parfaitement bien faites 8c bien dreflées fur leurs
coquilles, s’arrêtoient tout-à-coup ; il fit démonter la pompe plu-
fieurs fois pour voir ce qui en pouvoit être la caufe, mais il n’ap-
perçut rien de fenfible.
Si cesfoupapes, qui étoient pofées horifontalement dans le corps
de pompe , comme font par exemple celles de la dix-feptieme figure
de la planche deuxieme , avoient été preffées de haut en bas
par le poids de l’atmofphere, on auroit pu croire quelles s’étoient
trouvées dans le cas de deux furfaces bien polies 8c mouillées
appliquées l’une contre l’autre, qui ne peuvent êtreféparées que
par faction d’un grand poids ; mais il n’y avoit point d’air entre les
foupapes 8c le pifton , dontrelles puffent être preffées de haut en
bas, au contraire elles étoient pouffées de bas en haut par l’eau que
refouloient les pillons.
Il ne relie donc qu’une feule caufe àlaquelle on puiffe attribuer la
force de l’union des foupapes 8c de leurs coquilles , qui confifte
dans l’eau qui les mouille. Il faut que les parties d’eau qui font entrées
dans les pores de l’un de ces corps, s’accrochent fi puiffam-
nient à l’autre, qu’il n’y en ait aucune qui ne tienne par les deux
extrémités aux deux corps, 8c qu’elles s’accrochent d’autant plus
puiffamment que les deux furfaces font plus polies , pour en exclure
plus parfaitement l’air qui pourroit fe trouver entre-deux,
& qu’ainfi c’eft la multitude des particules d’eau qui contribue à
la grandeur de l’effet , par la difficulté de les détacher ou de les
etendre , par conféquent d’ouvrir les foupapes.
Il eft certain que pour détacher du cuivre les parties d’eau qui
le mouillent, il faut un effort affez confidérable, 8c que ce n’eft
guercs que par l’évaporation ou par un frottement violent 8c à plu-
fieurs reprifes qu’on en vient entièrement à bout. Quant à ce qui
eft d etendre des parties d eau, ni M. Amontons , ni tous les autres
qui en ont voulu faire l’expérience , n’ont pu s’aflurer que
1 eau fut capable d’extenfion. Ainfi l’on peut croire que tout fe réduit
a la difficulté de détacher les parties d’eau ; il eft plus que
vraifemblable qu’elles ne s’accrochent pas avec la même force à
toute forte de corps.
| 963. Quoique j’aye affez fait fentir dans les art. 903. 904. 905.
l’importance de ne jamais contraindre l’eau refoulée à paffer par
tes , ont le défa
u t de s ‘arré-
■ ter quelquefo
is 3 quand
les pompes
jouent.
Caufe a la-
quelle on peilt
attribuer l ’ ad-
hèfion des fo u papes
d coquille.
Preuve pour
montrer la né-
cejjité de faire