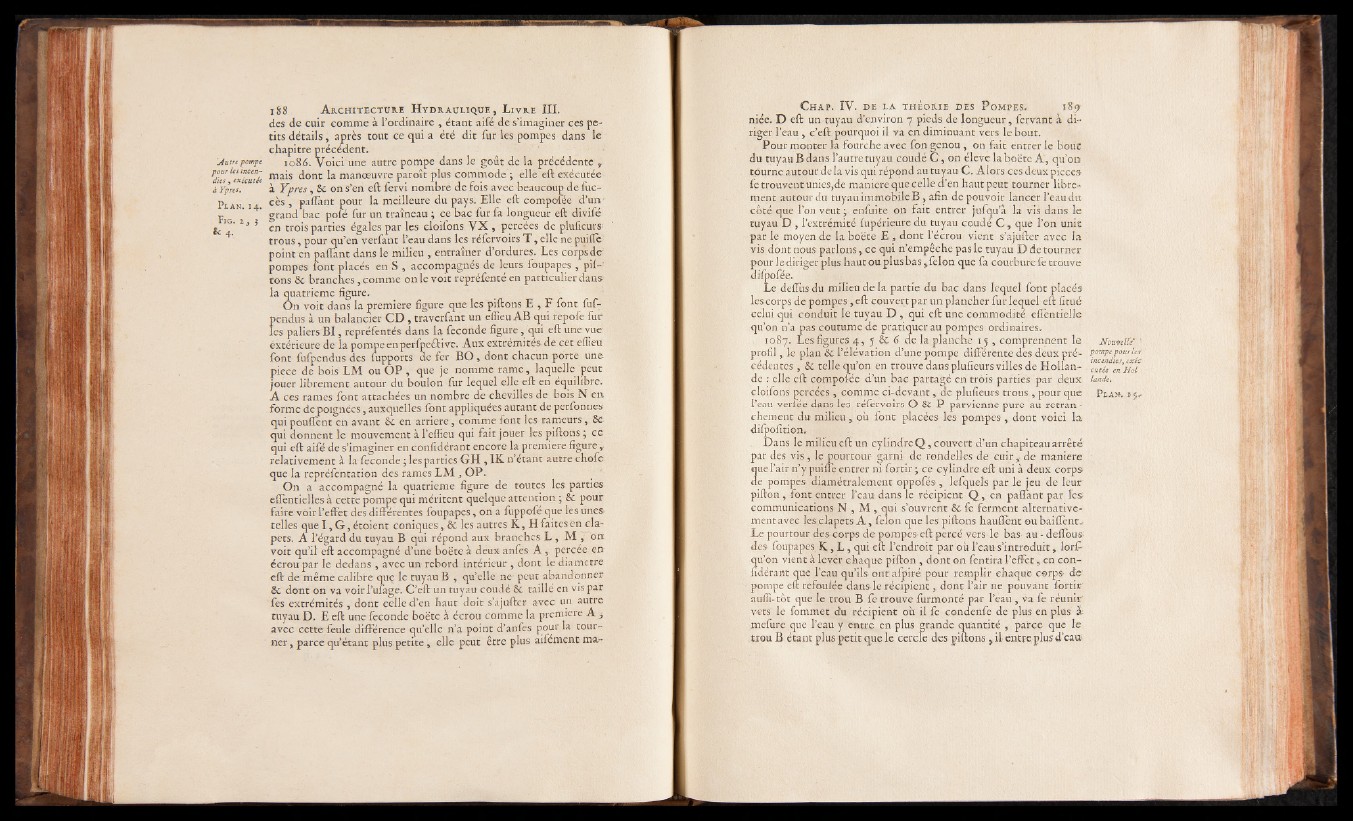
'Autre pompe
pour les incendies
, exécutée
à Ypres.
Plan . 14.
Tig. 1 , }
& 4.
1S8 A rchitecture Hydraulique, L ivre III.
des de cuir comme à l’ordinaire , étant aifé de s’imaginer ces petits
détails, après tout ce qui a été dit fur les pompes dans le
chapitre précédent.
1086. Voici une autre pompe dans le goût de la précédente ,
mais dont la manoeuvre paroît plus commode ; elle eft exécutée
à Ypres, Si on s’en eft fervi nombre de fois avec beaucoup de fuc-
cès , pafïànt pour la meilleure du pays. Elle eft comparée d’un
grand bac pôle fur un traîneau ; ce bac fur fa longueur eft divifé
en trois parties égales par les cloifons V X , percées de plufieurs-
trous, pour qu’en verfant l’eau dans les réfervoirs T , elle ne puiffe
point en paflant dans le milieu , entraîner d’ordures. Les corps de"
pompes font placés en S , accompagnés de leurs foupapes , pillons
5c branches, comme on le voit repréfenté en particulier dans
la quatrième figure.
On voit dans la première figure que les piftons E , F font fuf-
pendus à un balancier CD , traverfant un elîieu AB qui repofe fur
les paliers B I , repréfentés dans la fécondé figure, qui eft une vue
extérieure de la pompe en perfpeétive. Aux extrémités de cet effieu
font fufpendus des fupports de fer B O , dont chacun porte une
piece de bois LM ou OP , que je nomme rame, laquelle peut
jouer librement autour du boulon liir lequel elle eft en équilibré.
A ces rames font attachées un nombre de chevilles de bois N en.
forme de poignées,auxquelles font appliquées autant de petfonnes
qui pouffent en avant Se en arriéré, comme font les rameurs, SC
qui donnent le mouvement à l’eflïeu qui fait jouer les piftons ; ce
qui eft aifé de s’imaginer en confidérant encore la première figure,
relativement à la fécondé ; les parties GH , IK n’étant autre chofe
que la repréfentation des rames LM , OPOn
a accompagné la quatrième figure de toutes les parties
eflèntielles à cette pompe qui méritent quelque attention ; Si pour
faire voir l’effet des différentes foupapes, on a fuppofé que l'es unesi
telles que I , G , étoient coniques,. Si les autres K , H faites en clapets.
A l’égard du tuyau B qui répond aux branches L , M , on
voit qu’il eft accompagné d’une boëte à deux anfes A ,. percee en
écrou par le dedans , avec un rebord intérieur , dont le diamètre
eft de même calibre quç le tuyau B , qu’elle ne- peut abandonner
Si dont on va voir l’ufage. C’eft un tuyau coudé Sc taillé en vis par
fes extrémités , dont celle d’en haut doit s’ajufter avec un autre
tuyau D. E eft une féconde boëte à écrou comme la première A j
avec cette feule différence qu’elle n’a point d’anfes pour la tourner,
parce qu’étant plus petite, elle peut être plus aifémentna-
C hap. IV. de la théorie des P ompes- 189
niée. D eft un tuyau d’environ 7 pieds de longueur, fervant à diriger
l’eau , c’eft pourquoi il va en diminuant vers le bout.
Pour monter la fourche avec fon genou, on fait entrer le bouc
du tuyau B dans l’autre tuyau coudé C , on éleve la boëte A , qu’on
tourne autour de la vis qui répond au tuyau C. Alors ces deux pièces
fe trouvent unies,de maniéré que celle d’en haut peut tourner librement
autour du tuyauimmobileB, afin de pouvoir lancer l’eau du
côté que l’on veut ; enfuite on fait entrer jufqu’à la vis dans le
tuyau D , l’extrémité fupérieure du tuyau coudé C , que l’on unit
par le moyen de la boëte E , dont l’écrou vient s’ajufter avec la
vis dont nous parlons, ce qui n’empêche pas le tuyau D dé tourner
pour le diriger plus haut ou plus bas ,felon que fa courbure fe trouve
difpofée.
Le deflùs du milieu de la partie du bac dans lequel font placés
les corps de pompes, eft couvert par un plancher fur lequel eft fitué
celui qui conduit le tuyau D , qui. eft une commodité efléntielle
qu’on n’a pas coutume de pratiquer au pompes ordinaires.
1087. Les figures 4 , 5 5c 6 de la planche 1 f , comprennent le
profil, le plan Si l’élévation d’une pompe différente des deux précédentes
, Si telle qu’on en trouve dans plufieurs villes de Hollande
: elle eft compofée d’un bac partagé entrois parties par deux
cloifons percées , comme ci-devant , de plufieurs trous , pour que
l’eau veinée dans les réfervoirs O & P parvienne pure au retranchement
du- milieu , où font placées- les pompes , dont voici la
difpofition.
Dans le milieu eft un cylindre Q , couvert d’un chapiteau arrêté
par des vis, le pourtour garni de rondelles de cuir ,■ de maniéré
que-Pair n’y puilfe entrer ni fortir ; ce cylindre eft uni à deux corps
de pompes diamétralement oppofés , lefquels par le jeu de leur
pifton , font entrer l’eau- dans le récipient Q , en paffant par les
communications- N , M , qui s’ouvrent Si fe ferment alternativement
avec les clapets A , félon que les piftons hauflènt ou baiffent-
Le pourtour des corps de pompes eft percé vers le bas- au - deflbus
des foupapes K , L , qui eft l’endroit par où l’eau s’introduit, lorft
qu’on vient à lever chaque pifton , dont on fentira l’effet, en confidérant
que l’eau qu’ils ont afpiré pour remplir chaque corps- de
pompe eft refoulée dansle récipient ,-. dont l’air ne pouvant fortir
aufîî-tôt que le trou B fe trouve furmonté par l’eau, va fe réunit
v-ets le fommet du récipient où il fe condenfe de plus en plus à.
mefure que l’eau y entre en plus grande quantité , parce que le
trou B étant plus petit que le cercle des piftons , il entre plus d’eau-;
Nouvelle '
pompe pour les"
incendies, ex'éc'
cutée en H o l ■
lande.
P l a n ,