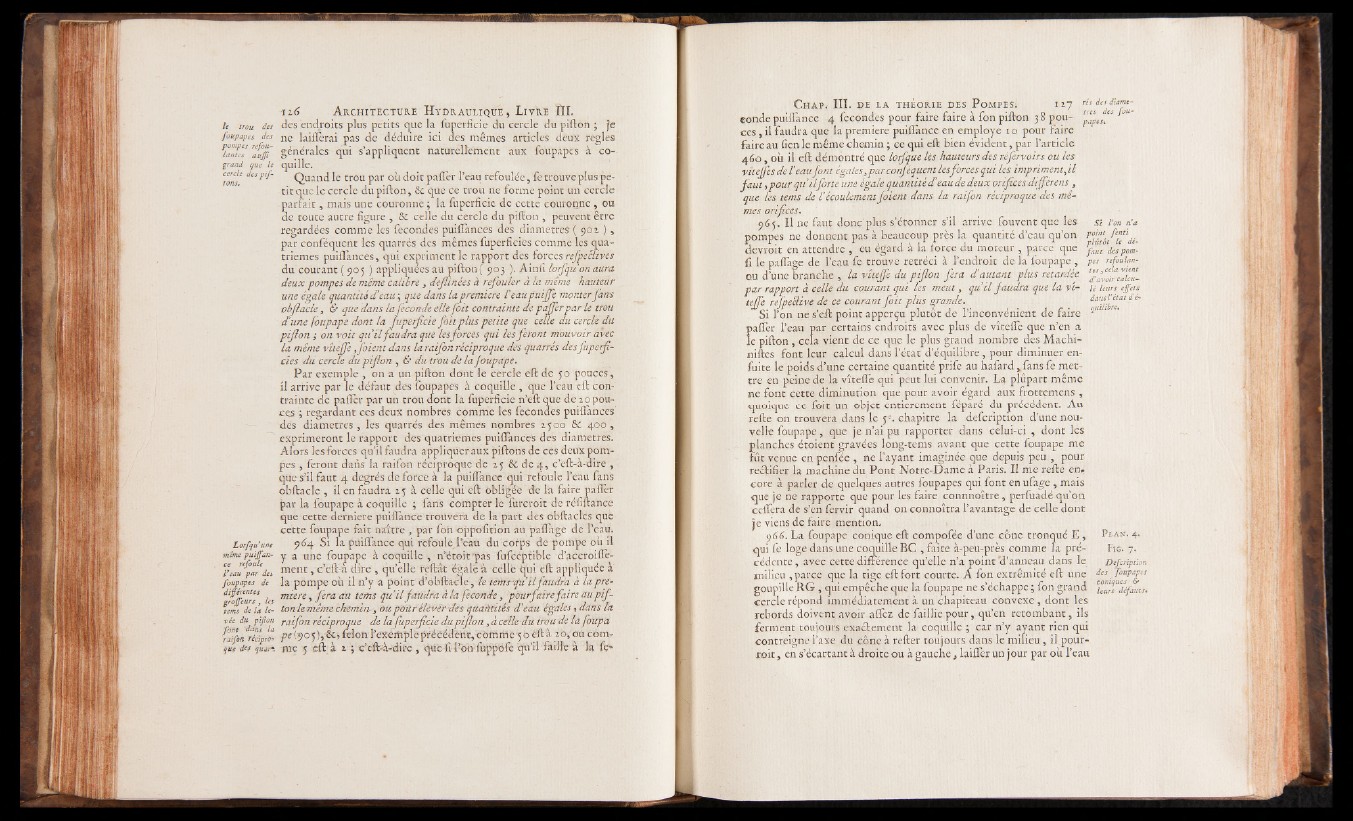
le trou des
.foupapes des
pompes refoulantes
aujji
grand que le
cercle des p i f
tons»
Lorfqu’ une
même puijfonce
refoule
l ’ eau par des
foupapts de
différentes
groffeurs 9 les
tems de la levée
dît pifion
font 'd'ans la
raifon rèciprOf
quç de$ quiii*
n é A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v r e H L
des endroits plus petits que la fuperficie du cercle du pifton ; je
11e laiflèrai pas de déduire ici des mêmes articles deux réglés
générales qui s’appliquent naturellement aux foupapes à coquille.
Quand le trou par où doit palier l’eau refoulée, fe trouve plus petit
que le cercle du pifton, & que ce trou ne forme point un cercle
parfait, mais une couronne ; la fuperficie de cette couronne , ou
de toute autre figure , Se celle du cercle du pifton , peuvent être
regardées comme les fécondés puilfances des diamètres ( 902 ) ,
par conféquent les quarrés des mêmes fuperficies comme les quatrièmes
puilïàncès, qui expriment le rapport des forces refpeclives
du courant ( 905 ) appliquées au pifton ( 903 ). Ainfi lorfqu on aura
deux pompes de même calibre , dejlinées à refouler à la même hauteïtr
une égale quantité dé eau ; que dans la première Veau putffe monter fans
obflacle, & que dans la fécondé elle foit contrainte de pafferpar le trou
d’une (oupape dont la fuperficie fait plus petite que celle du cercle du
pifion ; on voit qu’il faudra que les forcés qui les feront mouvoir avec
la même vîteffe ffoient dans la raifon réciproque des quarrés desfupefi-
cies du cercle du pifion , 6’’ du trou de la Joupape.
Par exemple , on a un pifton dont lé cercle eft de 50 pouces,
il arrive par le défaut des foupapê's à coquille , que l’eau eft contrainte
de palier par un trou dont la fuperficie n’eft que de 20 pouces
; regardant ces deux nombres comme les fécondés puiflances
des diamètres , les quarrés des mêmes nombres 2500 & 40O ,
exprimeront le rapport des quatrièmes puilïàncès des diamètres.
Alors les forces qu’il faudra appliquer aux pillons de ces deux pompes
, feront dans la raifon réciproque de 25 8e de 4 , c’eft-à-dire ,
que s’il faut 4 degrés de forcé à la puiflàncë qui refoule l’eau fans
obftacle , il en faudra 25 à celle qui eft obligée de la faire paflèr
par la foupape à coquille ; fans compter le furcroit de réfiftance
que cette derniere puiflàncë trouvera de la part des obftàcl'es que
cette foupape fait naître , par foh oppolition au pâflàge de Peau.
964 Si la puiflàncë qui refoule Peau du corps de pompe où il
y a une foupape à coquille-, n’étoit pas fufcëptible d’aceroifle-
ment, c’eft-a dire , qu’elle reliât égalé à celle qui eft appliquée a
la pompe où il n’y â point d’obftacle-, -’le tenis^u il faudra à la première,
fera du tems qu’i l faudra àla féconde , pq'ürfairefaire au pif-
tonlemême chemin-, dupoürelèvé'r‘des1 quantités d’eau égales, datis l'a
raifon réciproque de la fuperficie du pifion, à celle du tretu de la foilpd
.pe(905t,S£jfcioiïl’exémplëp‘récédéift,comrnë'5bé'ft à 20-, on corn»
me 5 eft à 2 3 c ’eft-’à-dire , qüé fi-l’bn füppb& qu’il faille i 1# fç*
rés des diamètres
des fou -
papesi
S i l'on n'a
point fenti
plutôt le défau
t des pompes
refoulantes
3 cela vient
d'avoir calculé
leurs effets
dans l'état d’équilibre.
CH A P . III. DE LA THÉORIE DES PoMPESi I 2 7
tonde puiflàncë 4 fécondés pour faire faire à fon pifton 3 S pouces
, il faudra que la première puiflàncë en employé 10 pour faire
faire au fienle même chemin ; ce qui eft bien évident, par l’article
460, où il eft démontré que lorfque lés hauteurs des réfervoirs ou les
vîtejfes de l ’eaufont égales,par conféquent lesforces qui les impriment,il
faut ,pour qu ’il forte une égale quantité d’eau de deux orifices diffèrens ,
que les tems de l ’écoulement foient dans la raifon réciproque des mêmes
orifices.
965. Il ne faut donc'plus s’étonner s’il arrive fouvent que les-
pompes ne donnent pas.à beaucoup près la quantité d’eau qu’on
devrait en attendre , eu égard à la force du moteur , parce que
fi le paflàge de l’eau fe trouve rétréci à l’endroit de la foupape ,
ou d’une branche , la vîteffe du pifion fera d’autant plus retardée
par rapport à celle du courant qui les meut , qu’il faudra que la vi-
tejfe refpedive de ce courant foit plus grande.
Si l’on ne s’eft point apperçu plutôt de l’inconvénient de faire
palier l’eau par certains endroits avec plus de vîtefle que n’en â
le pifton, cela vient de ce que le plus grand nombre des Machi-
niftes font leur calcul dans l’état d’équilibre, pour diminuer en-
fuite le poids d’une certaine quantité prife au hafard , fans fe mettre
en peine de la vîtefle qui peut lui convenir. La plupart même
ne font cette diminution que pour avoir égard aux frottemens ,
quoique ce foit un objet entièrement féparé du précédent. Au
relie on trouvera dans le 5 e. chapitre la defeription d’une nouvelle
foupape, que je n’ai pu rapporter dans celui-ci , dont les
planches étoient gravées long-tems avant que cette foupape me
fut venue en penfée , ne l’ayant imaginée que depuis peu , pour
rectifier la machine du Pont Notre-Dame à Paris. Il me relie en.
core à parler de quelques autres foupapes qui font en ufage , mais
que je ne rapporte que pour les faire connnoître, perfuadé qu’on
celfera de s’en fervir quand on connoîtra l’avantage de celle dont
je viens de faire mention.
966. La foupape conique eft compofée d’une cône tronqué E ,
qui le loge dans une coquille BC , faite à-peu-près comme la précédente
, avec cette différence qu’elle n’a point 'd’anneau dans le
milieu , parce que la tige eft fort courte. A fon extrémité eft une ^
goupille RG , qui empêche que la foupape ne s’échappe ; fon grand
cercle répond immédiatement à un chapiteau convexe, dont les
rebords doivent avoir allez de faillie pour, qu’en retombant, ils
ferment toujours exaélement la coquille ; car n’y ayant rien qui
contreigne l’axe du cône à relier toujours dans le milieu, il pourrait
, en s’écartant à droite ou à gauche, laiflfer un jour par où l’eau
P ia n . 4.
Fig.
Defeription
des foupapes
" &