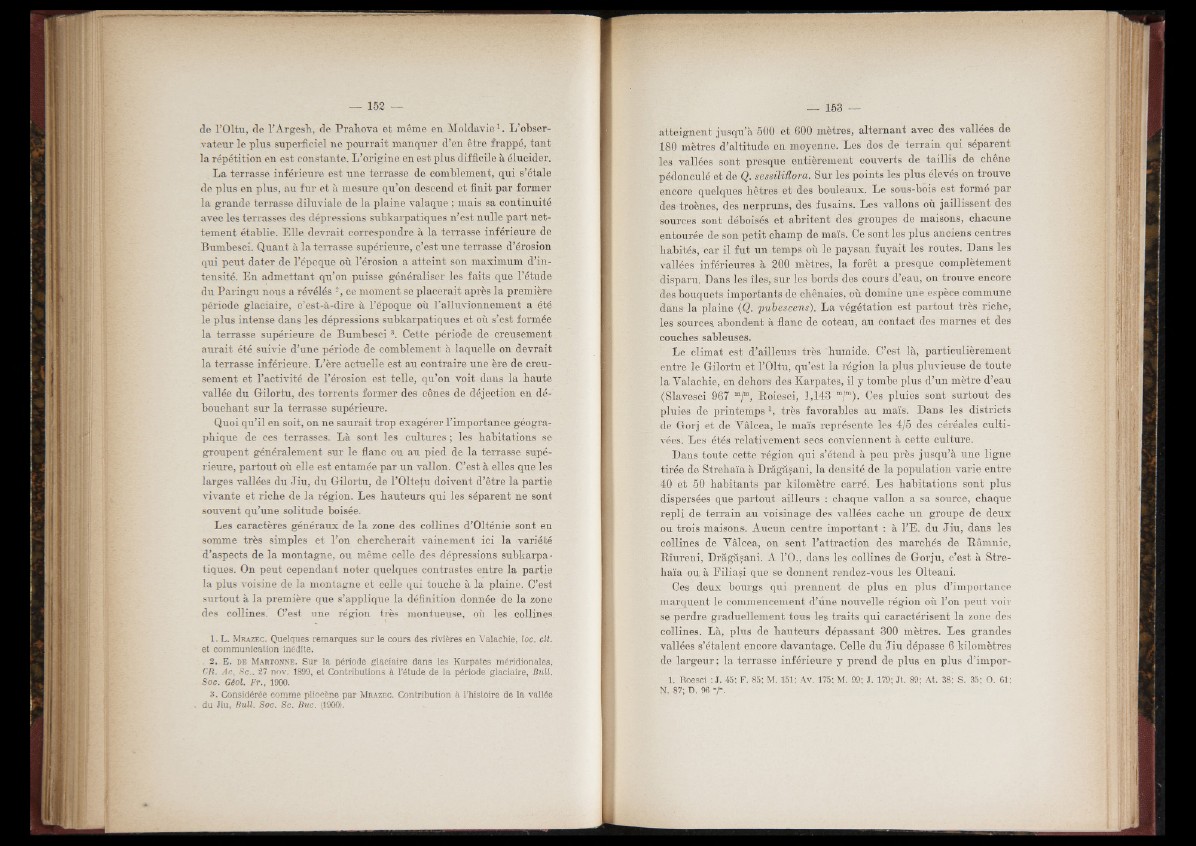
de l’Oltu, de l’Àrgesh, de Praliova et même en Moldavie1. L ’observateur
le plus superficiel ne pourrait manquer d’en être frappé, tant
la répétition en est constante. L ’origine en est plus difficile à élucider.
La terrasse inférieure est une terrasse de comblement, qui s’étale
de plus en plus, au fur et à mesure qu’on descend et finit par former
la grande terrasse diluviale de la plaine valaque ; mais sa continuité
avec les terrasses des dépressions subkarpatiques n’est nulle part nettement
établie. Elle devrait correspondre à la terrasse inférieure de
Bumbesci. Quant à la terrasse supérieure, c’est une terrasse d’érosion
qui peut dater de l’époque où l’érosion a atteint son maximum d’intensité.
En adm ettant qu’on puisse généraliser les faits que l’étude
du Paringu nous a révélés 2, ce moment se placerait après la première
période glaciaire, c’est-à-dire à l’époque où l’alluvionnement a été
le plus intense dans les dépressions subkarpatiques et où s’est formée
la terrasse supérieure de Bumbesci 3. Cette période de creusement
aurait été suivie d’une période de comblement à laquelle on devrait
la terrasse inférieure. L ’ère actuelle est au contraire une ère de creusement
et l’activité de l’érosion est telle, qu’on voit dans la haute
vallée du Gilortu, des torrents former des cônes de déjection en débouchant
sur la terrasse supérieure.
Quoi qu’il en soit, on ne saurait trop exagérer l’importance géographique
de ces terrasses. Là sont les cultures ; les habitations sé
groupent généralement sur le flanc ou au pied de la terrasse supérieure,
partout où elle est entamée par un vallon. C’est à elles que les
larges vallées du Jiu, du Gilortu, de l’Oltefu doivent d’être la partie
vivante et riche de la région. Les hauteurs qui les séparent ne sont
souvent qu’une solitude boisée.
Les caractères généraux de la zone des collines d’Olténie sont en
somme très simples et l’on chercherait vainement ici la variété
d’aspects de la montagne, ou même celle des dépressions subkarpatiques.
On peut cependant noter quelques contrastes entre la partie
la plus voisine de la montagne et celle qui touche à la plaine. C’est
surtout à la première que s’applique la définition donnée de la zone
des collines. C’est une région très montueuse, où les collines
1. L. Mrazec. Quelques remarques sur le cours des rivières en Valachie, loc. cit.
et communication inédite.
. 2 . E. de Martonne. Sur la période glaciaire dans les Karpates méridionales,
CR. An. Sc.. 27 nov. 1899, et Contributions à l’étude de la période glaciaire, Bull.
Soc. Gêol. Fr., 1900.
8. Considérée comme pliocène par Mrazec. Contribution à l’histoire de la vallée
du Jiu, Bull. Soc. Sc. Bue. (1900).
atteignent jusqu’à 500 et 600 mètres, alternant avec des vallées de
180 mètres d’altitude en moyenne. Les dos de terrain qui séparent
les vallées sont presque entièrement couverts de taillis de chene
pédonculé et de Q. sessilMora. Sur les points les plus éleves on trouve
encore quelques hêtres et des bouleaux. Le sous-bois est formé par
des troènes, des nerpruns, des fusains. Les vallons où jaillissent des
sources sont déboisés et abritent des groupes de maisons, chacune
entourée de son petit champ de maïs. Ce sont les plus anciens centres
habités, car il fut un temps où le paysan fuyait les routes. Dans les
vallées inférieures à 200 mètres, la forêt a presque complètement
disparu. Dans les îles, sur les bords des cours d’eau, on trouve encore
des bouquets importants de chênaies, où domine une espèce commune
dans la plaine (Q. pubescens). La végétation est partout très riche,
les sources abondent à flanc de coteau, au contact des marnes et des
couches sableuses.
Le climat est d’ailleurs très humide. C’est là, particulièrement
entre le Gilortu et l’Oltu, qu’est la région la plus pluvieuse de toute
la Valachie, en dehors des Karpates, il y tombe plus d’un mètre d’eau
(Slavesci 967 Itoiesci, 1,143 m/m). Ces pluies sont surtout des
pluies de printemps x, très favorables au maïs. Dans les districts
de Gorj et de Vâlcea, le maïs représente les 4/5 des céréales cultivées.
Les étés relativement secs conviennent à cette culture.
Dans toute cette région qui s’étend à peu près jusqu’à une ligne
tirée de Strehaïa à Drâgâçani, la densité de la population varie entre
40 et 50 habitants par kilomètre carré. Les habitations sont plus
dispersées que partout ailleurs : chaque vallon a sa source, chaque
repli de terrain au voisinage des vallées cache un groupe de deux
ou trois maisons. Aucun centre important : à l’E. du Jiu, dans les
collines de Vâlcea, on sent l’attraction des marchés de Ranime,
Rîureni, Drâgâçani. A l’O., dans les collines de Gorju, c’est à Strehaïa
ou à Filia^i que se donnent rendez-vous les Olteani.
Ces deux bourgs qui prennent de plus en plus d’importance
marquent le commencement d’une nouvelle région où l’on peut voir
se perdre graduellement tous les traits qui caractérisent la zone des
collines. Là, plus de hauteurs dépassant 300 mètres. Les grandes
vallées s’étalent encore davantage. Celle du Jiu dépasse 6 kilomètres
de largeur ; la terrasse inférieure y prend de plus en plus d’impor-
1. Roesei : J. 45: F. 85; M. 151; Av. 175; M. 99; J. 179; Jt. 89; At. 38; S. 35; O. 61;
N. 87; D. 96 -j-.