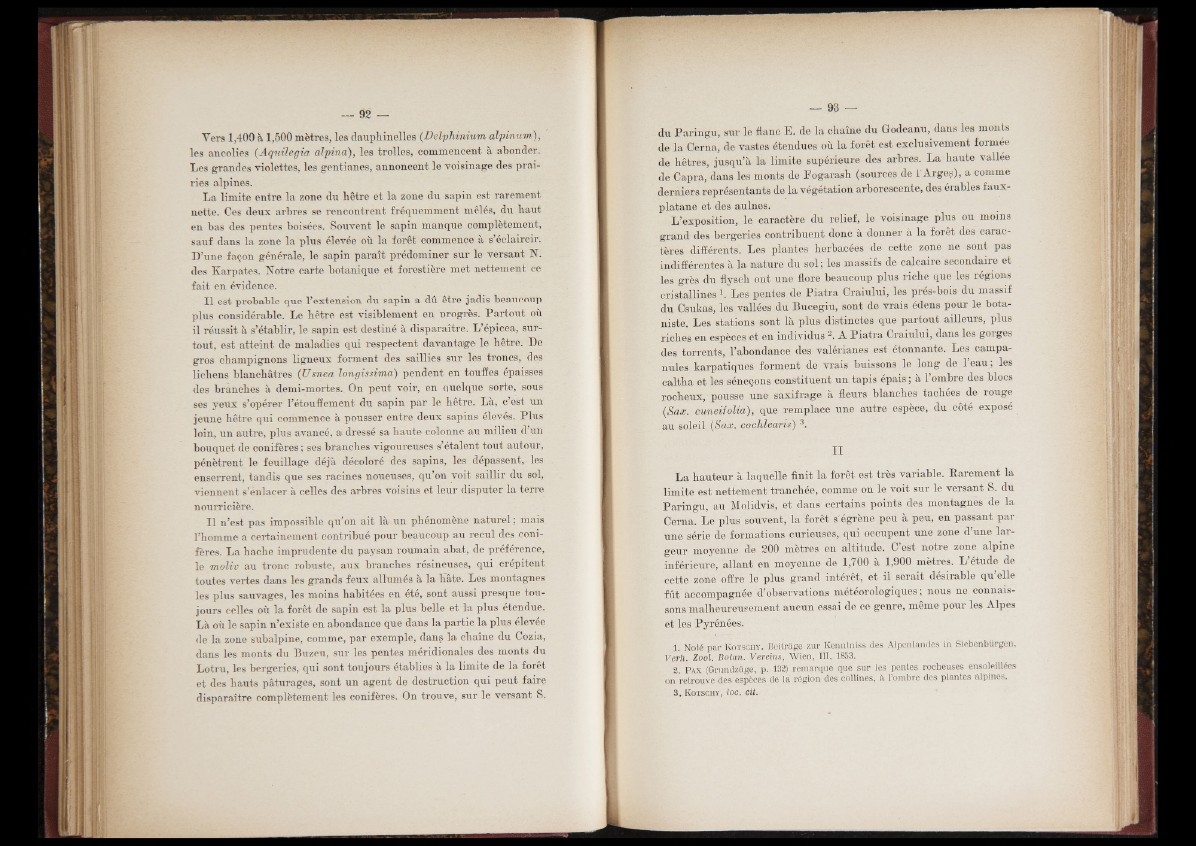
Yers 1,400 à 1,500 mètres, les dauphinelles (Delphinium alpinum),
les aneolies (AquUegm alpinà), les trolles, commencent à abonder.
Les grandes violettes, les gentianes, annoncent le voisinage des prairies
alpines.
La limite entre la zone du hêtre et la zone du sapin est rarement
nette. Ces deux arbres se rencontrent fréquemment mêlés, du haut
en bas des pentes boisées. Souvent le sapin manque complètement,
sauf dans la zone la plus élevée où la forêt commence à s’éclaircir.
D’une façon générale, le sapin paraît prédominer sur le versant N.
des Karpates. Notre carte botanique et forestière met nettement ce
fait en évidence.
Il est probable que l’extension du sapin a dû être jadis beaucoup
plus considérable. Le hêtre est visiblement en nrogrès. Partout où
il réussit à s’établir, le sapin est destiné à disparaître. L’épicéa, surtout,
est atteint de maladies qui respectent davantage le hêtre. De
gros champignons ligneux forment des saillies sur les troncs, des
lichens blanchâtres (Usnea longissima) pendent en touffes épaisses
des branches à demi-mortes. On peut voir, en quelque sorte, sous
ses yeux s’opérer l’étouffement du sapin par le hêtre. Là, c’est un
jeune hêtre qui commence à pousser entre deux sapins élevés. Plus
loin, un autre, plus avancé, ai dressé sa haute colonne au milieu d’un
bouquet de conifères ; ses branches vigoureuses s’étalent tout autour,
pénètrent le feuillage déjà décoloré des sapins, les dépassent, les
enserrent, tandis que ses racines noueuses, qu’on voit saillir du sol,
viennent s’enlacer à celles des arbres voisins et leur disputer la terre
nourricière.
Il n’est pas impossible qu’on ait là un phenomene naturel ; mais
l’homme a certainement contribué pour beaucoup au recul des conifères.
L a hache imprudente du paysan roumain abat, de préférence,
le moliv au tronc robuste, aux branches résineuses, qui crépitent
toutes vertes dams les grands feux allumés à la hâte. Les montagnes
les plus sauvages, les moins habitées en été, sont aussi presque toujours
celles où la forêt de sapin est la plus belle et la plus étendue.
Là où le sapin n’existe en abondance que dans la partie la plus élevée
de la zone subalpine, comme, par exemple, dans la chaîne du Cozia,
dans les monts du Buzeu, sur les pentes méridionales des monts du
Lotru, les bergeries, qui sont toujours établies à la limite de la forêt
et des hauts pâturages, sont un agent de destruction qui peut faire
disparaître complètement les conifères. On trouve, sur le versant S.
du Paringu, sur le flanc E. de la chaîne du Godeanu, dans les monts
de la Cerna, de vastes étendues où la forêt est exclusivement formée
de hêtres, jusqu’à la lim ite supérieure des arbres. L a haute vallée
de Capra, dans les monts de Eogarash (sources de 1 Arge§), a comme
derniers représentants de la végétation arborescente, des érables faux-
platane et des aulnes.
L ’exposition, le caractère du relief, le voisinage plus ou moins
grand des bergeries contribuent donc à donner à la forêt des caractères
différents. Les plantes herbacées de cette zone ne sont pas
indifférentes à la nature du sol ; les massifs de calcaire secondaire et
les grès du flysch ont une flore beaucoup plus riche que les régions
cristallines l. Les pentes de P iatra Craiului, les prés-bois du massif
du Csukas, les vallées du Bucegiu, sont de vrais édens pour le botaniste.
Les stations sont là plus distinctes que partout ailleurs, plus
riches en espèces et en individus 2. A P iatra Craiului, dans les gorges
des torrents, l’abondance des valérianes est étonnante. Les campanules
karpatiques forment de vrais buissons le long de l’eau ; les
caltha et les séneçons constituent un tapis épais ; à l’ombre des blocs
rocheux, pousse une saxifrage à fleurs blanches tachées de rouge
(,Sax. cuneifolia), que remplace une autre espèce, du côté exposé
au soleil (Sax. cochlearis) 3.
I I
La hauteur à laquelle finit la forêt est très variable. Rarement la
limite est nettement tranchée, comme on le voit sur le versant S. du
Paringu, au Molidvis, et dans certains points des montagnes de la
Cerna. Le plus souvent, la forêt s'égrène peu à peu, en passant par
une série de formations curieuses, qui occupent une zone d’une largeur
moyenne de 200 mètres en altitude. C’est notre zone alpine
inférieure, allant en moyenne de 1,700 à 1,900 mètres. L ’étude de
cette zone offre le plus grand intérêt, et il serait désirable qu’elle
fût accompagnée d'observations météorologiques ; nous ne connaissons
malheureusement aucun essai de ce genre, même pour les Alpes
et les Pyrénées.
1. Noté par K o ts c h y . Beitrage zur Kenntniss des Alpenlandes in Siebenbürgen,
Verh. Zool. Botan. Verelns, Wien, III, 1853.
2. Pax (Grundziige, p. 132) remarque que sur les pentes rocheuses ensoleillées
on retrouve des espèces de la région des collines, à l’ombre des plantes alpines.
3 . Kotschy, loc. cit.