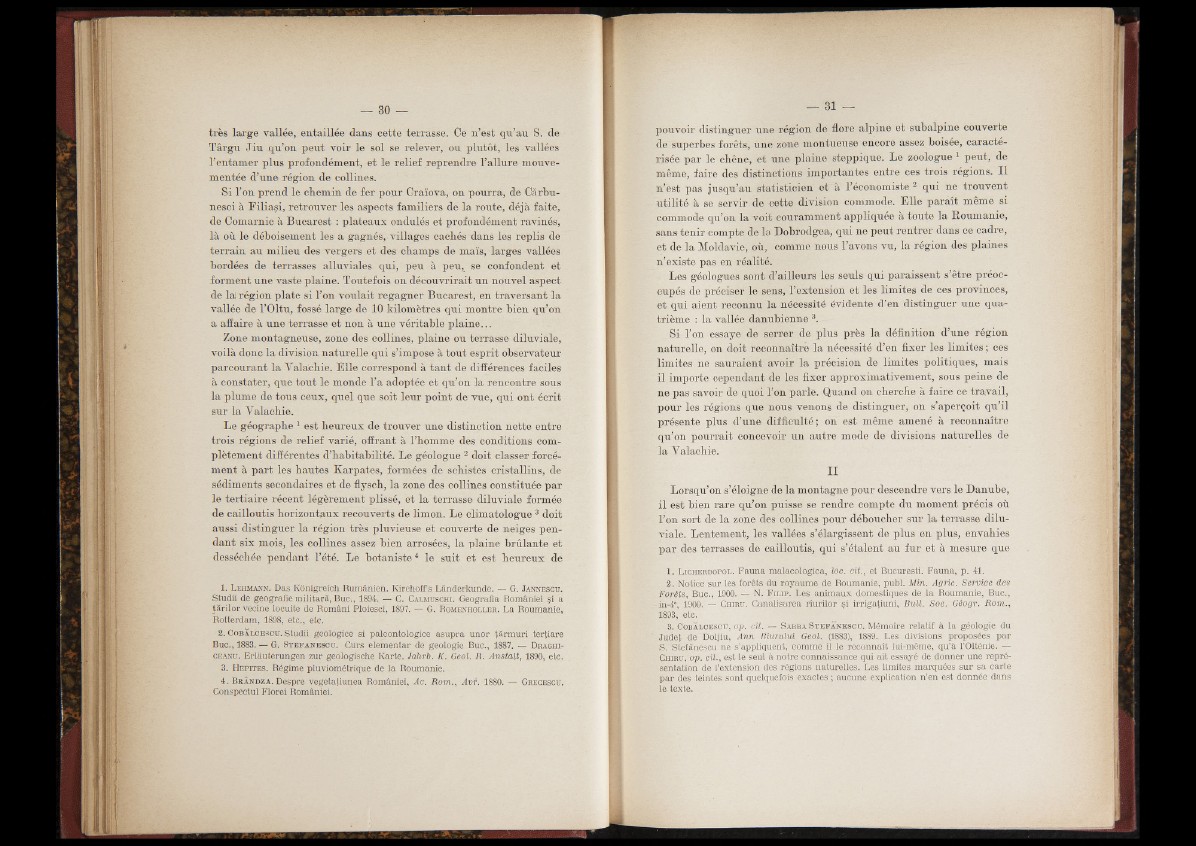
très large vallée, entaillée dans cette terrasse. Ce n’est qu’au S. de
Târgu Jiu qu’on peut voir le sol se relever, ou plutôt, les vallées
l’entamer plus profondément, et le relief reprendre l’allure mouvementée
d’une région de collines.
Si l’on prend le chemin de fer pour Craïova, on pourra, de Carbu-
nesci à Filiaçi, retrouver les aspects familiers de la route, déjà faite,
de Comarnic à Bucarest : plateaux ondulés et profondément ravinés,
là où le déboisement les a gagnés, villages cachés dans les replis de
terrain au milieu des vergers et des champs de maïs, larges vallées
bordées de terrasses alluviales qui, peu à peu, se confondent et
forment une vaste plaine. Toutefois on découvrirait un nouvel aspect
de lal région plate si l’on voulait regagner Bucarest, en traversant la
vallée de l’Oltu, fossé large de 10 kilomètres qui montre bien qu’on
a affaire à une terrasse et non à une véritable plaine...
Zone montagneuse, zone des collines, plaine ou terrasse diluviale,
voilà donc la division naturelle qui s’impose à tout esprit observateur
parcourant la Yalachie. Elle correspond à tant de différences faciles
à constater, que tout le monde l’a adoptée et qu’on la rencontre sous
la plume de tous ceux, quel que soit leur point de vue, qui ont écrit
sur la Yalachie.
Le géographe 1 est heureux de trouver une distinction nette entre
trois régions de relief varié, offrant à l’homme des conditions complètement
différentes d’habitabilité. Le géologue 2 doit classer forcément
à part les hautes Karpates, formées de schistes cristallins, de
sédiments secondaires et de flysch, la zone des collines constituée par
le tertiaire récent légèrement plissé, et la terrasse diluviale formée
de cailloutis horizontaux recouverts de limon. Le climatologue 3 doit
aussi distinguer la région très pluvieuse et couverte de neiges pendant
six mois, les collines assez bien arrosées, la plaine brûlante et
desséchée pendant l’été. Le botaniste4 le suit et est heureux de
1. Lehmann. Das Königreich Rumänien. Kirchoff’S Länderkunde. — G. Jannescu. Studii de geografie militarä, Buc., 1894. — C. Calmuschi. Geografla României çi a
tärilor vecine locuite de Romäni Ploiesci, 1897. — G. Romenholler. La Roumanie,
Rotterdam, 1898, etc., etc.
2. Co ba lc esc u . Studii geologicë si paleontologice asupra unor ¡.ärrnuri tertiäre
Buc., 1883. — G. St e f a n e so d . Curs elementar de geologie Buc., 1887. — Draghi-
ceanu. Erläuterungen zur geologische Karte. Jahrb. K.Geol. R. Anstalt, 1890, etc.
3. Hepit e s. Régime pluviométrique de la Roumanie.
4. Be Ân d z a . Despre vegetatiunea României, Ac. Rom., Avt.'lSSO. — Grecescu. Conspectul Florei României.
pouvoir distinguer une région de flore alpine et subalpine couverte
de superbes forêts, une zone montueuse encore assez boisée, caractérisée
par le chêne, et une plaine steppique. Le zoologue 1 peut, de
même, faire des distinctions importantes entre ces trois régions. Il
n’est pas jusqu’au statisticien et à l’économiste 2 qui ne trouvent
utilité à se servir de cette division commode. Elle paraît meme si
commode qu’on la voit couramment appliquée à toute la Roumanie,
sans tenir compte de la Dobrodgea, qui ne peut rentrer dans ce cadre,
et de la Moldavie, où, comme nous l’avons vu, la région des plaines
n’existe pas en réalité.
Les géologues sont d’ailleurs les seuls qui paraissent s’être préoccupés
de préciser le sens, l’extension et les limites de ces provinces,
et qui aient reconnu la nécessité évidente d’en distinguer une quatrième
: la vallée danubienne 3.
Si l’on essaye de serrer de plus près la définition d’une région
naturelle, on doit reconnaître la nécessité d’en fixer les limites ; ces
limites ne sauraient avoir la précision de limites politiques, mais
il importe cependant de les fixer approximativement, sous peine de
ne pas savoir de quoi l’on parle. Quand on cherche à faire ce travail,
pour les régions que nous venons de distinguer, on s’aperçoit qu’il
présente plus d’une difficulté ; on est même amené à reconnaître
qu’on pourrait concevoir un autre mode de divisions naturelles de
la Yalachie.
I I
Lorsqu’on s’éloigne de la montagne pour descendre vers le Danube,
il est bien rare qu’on puisse se rendre compte du moment précis où
l’on sort de la zone des collines pour déboucher sur la terrasse diluviale.
Lentement, les vallées s’élargissent de plus en plus, envahies
par des terrasses de cailloutis, qui s’étalent au fur et à mesure que
1. Licherdopol. Fauna malacologica, loc. cit., et Bucuresti. Fauna, p. 41.
2. Notice sur les forêts du royaume de Roumanie, publ. Min. Agric. Service des
Forêts, Buc., 1900. — N. Filip. Les animaux domestiques de la Roumanie, Buc.,
in-4", 1900. — Chiru. Canalisarea rîurilor çi irrigatiuni, Bull. Soc. Géogr. Rom.,
1893, etc.
3. G o b a lcescu , op. cit. — Sabba S t e f a n e s c ü . Mémoire relatif à la géologie du
Judet de D'oljiu, Ann Biurului Geol. (1883), 1889. Les divisions proposées par
S. Stefâneseu ne s’appliquent, comme il le reconnaît lui-même, qu’à l’Olténie. —
Chiru, op. cit., est le seul à notre connaissance qui ait essayé de donner une représentation
de l’extension des régions naturelles. Les limites marquées sur sa carte
par des teintes sont quelquefois exactes ; aucune explication n’en est donnée dans
le texte.