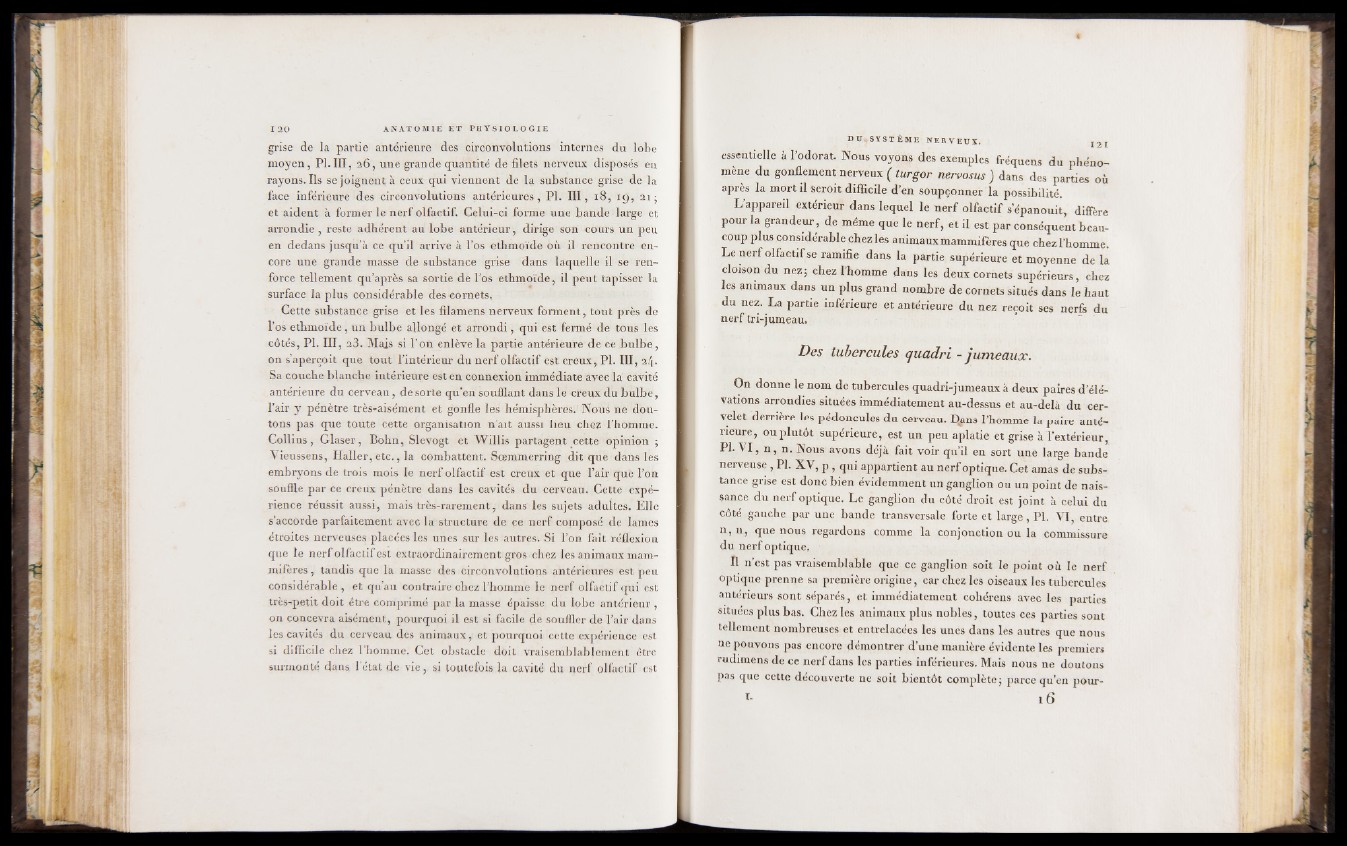
grise de la partie antérieure des circonvolutions internes du lobe
moyen, PI.III, 26, une grande quantité de filets nerveux disposés en
rayons. Ils se joignent à ceux qui viennent de la substance grise de la
face inférieure des circonvolutions antérieures, PI. III, 18, 19, 21;
et aident à former le nerf olfactif. Celui-ci forme une bande large et
arrondie , reste adhérent au lobe antérieur, dirige son cours un peu
en dedans jusqu’à ce qu’il arrive à l’os ethmoïde où il rencontre encore
une grande masse de substance grise dans laquelle il se renforce
tellement qu’après sa sortie de l’os ethmoïde, il peut tapisser la
surface la plus considérable des cornets,
Cette substance grise et les filamens nerveux forment, tout près de
l ’os ethmoïde, un bulbe allongé et arrondi, qui est fermé de tous les
côtés, PI. HI, a3. Mais si l'on enlève la partie antérieure de ce bulbe,
on s’aperçoit que tout l’intérieur du nerf olfactif est creux, PI. IB, 24.
Sa couche blanche intérieure est en connexion immédiate avec la cavité
antérieure du cerveau, de sorte qu’en soufflant dans le creux du bulbe,
l’air y pénètre très-aisément et gonfle les hémisphères.' Nous ne doutons
pas que toute cette organisation n’ait aussi lieu chez l’homme.
Collins, Glaser, Bohn, Slevogt et Willis partagent cette opinion ;
Vieussens, Haller, etc., la combattent. Scemmerring dit que dans les
embryons de trois mois le nerf olfactif est creux et que l’air que l’on
souffle parce creux pénètre dans les oavités du cerveau, Cette expérience
réussit aussi, mais très-rarement, dans les sujets adultes. Elle
s’accorde parfaitement avec la structure de ce nerf composé de lames
étroites nerveuses placées les unes sur les autres. Si l’on fait réflexion
que le nerf olfactif est extraordinairement gros chez les animaux mammifères
, tandis que la masse des circonvolutions antérieures est peu
considérable , et qu’au contraire chez l ’homme le nerf olfactif qui est
très-petit doit être comprimé par la masse épaisse du lobe antérieur ,
on concevra aisément, pourquoi il est si facile de souffler de l’air dans
les cavités du cerveau des animaux, et pourquoi cette expérience est
si difficile chez l’homme. Cet obstacle doit vraisemblablement être
surmonté dans l’état de vie, si toutefois la cavité du nerf olfactif est
D U « S Y S T ÈME NERVEU X .
essentielle à l’odorat. Nous voyons des exemples fréquens du phénomène
du gonflement nerveux ( turgor nervosm ) dans des parties où
après la mort il seroit difficile d’en soupçonner la possibilité.
L appareil extérieur dans lequel le nerf olfactif s’épanouit, diffère
pour la grandeur , de même que le nerf, et il est par conséquent beaucoup
plus considérable chez les animaux mammifères que chez l’homme.
Le nerf olfactif se ramifie dans la partie supérieure et moyenne de la
cloison du nez; chez l’homme dans les deux cornets supérieurs, chez
les animaux dans un plus grand nombre de cornets situés dans le haut
du nez. La partie inférieure et antérieure du nez reçoit ses nerfs du
nerf tri-jumeau.
Des tubercules cjuadri - jumeaux.
On donne le nom de tubercules quadri-jumeaux à deux paires d’élévations
arrondies situées immédiatement au-dessus et au-delà du cervelet
derrière les pédoncules du cerveau. Dans l’homme la paire antérieure,
ou plutôt supérieure, est un peu aplatie et grise à l’extérieur,
■ ÇïjljSl111 n- Nous avons déjà fait voir qu’il en sort une large bande
nerveuse , PI. XY, p , qui appartient au nerf optique. Cet amas de substance
grise est donc bien évidemment un ganglion ou un point de naissance
du nerf optique. Le ganglion du côté droit est joint à celui du
côté gauche par une bande transversale forte et large, PI. VI, entre
n, u, que nous regardons comme la conjonction ou la commissure
du nerf optique.
Il n’est pas vraisemblable que ce ganglion soit le point où le nerf
optique prenne sa première origine, car chez les oiseaux les tubercules
antérieurs sont séparés, et immédiatement cohérens avec les parties
situées plus bas. Chez les animaux plus nobles, toutes ces parties sont
tellement nombreuses et entrelacées les unes dans les autres que nous
ne pouvons pas encore démontrer d’une manière évidente les premiers
rudimens de ce nerf dans les parties inférieures. Mais nous ne doutons
pas que cette découverte ne soit bientôt complète ; parce qu’en pour-
I- 16