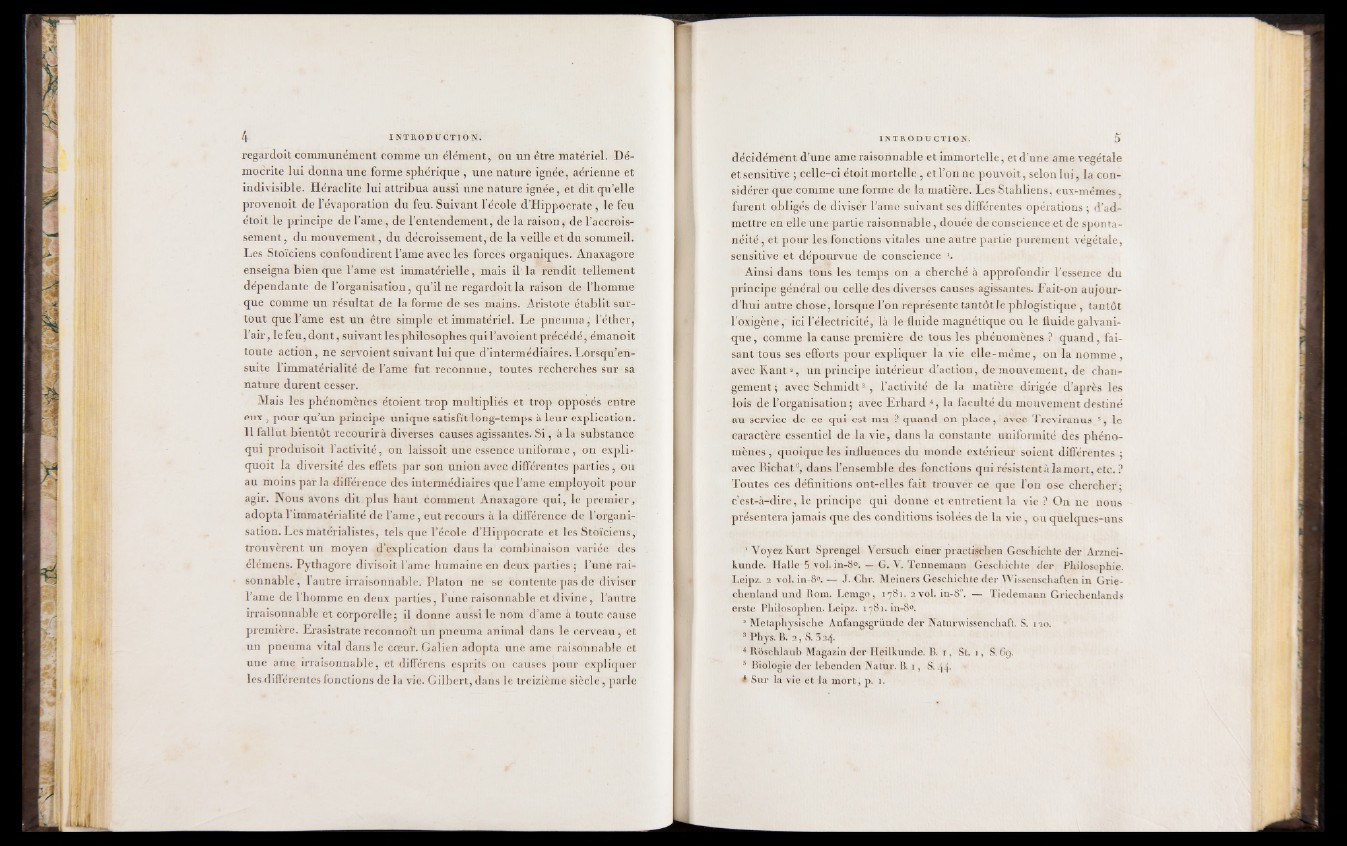
regardoit communément comme un élément, ou un être matériel. Dé-
mocrite lui donna une forme sphérique , une nature ignée, aérienne et
indivisible. Héraclite lui attribua aussi une nature ignée, et dit qu’elle
provenoit de l’évaporation du feu. Suivant l'école d’Hippocrate, le feu
étoit le principe de l’ame, de l’entendement, de la raison, de l’accroissement
, du mouvement, du décroissement, de la veille et du sommeil.
Les Stoïciens confondirent l’ame avec les forces organiques. Anaxagore
enseigna bien que l ’ame est immatérielle, mais il' la rendit tellement
dépendante de l ’organisation, qu’il ne regardoit la raison de l’homme
que comme un résultat de la forme de ses mains. Aristote établit surtout
que l’ame est un être simple et immatériel. Le pneuma, l’éther,
l’air, le feu, dont, suivant les philosophes qui l’avoient précédé, émanoit
toute action, ne servoient suivant lui que d’intermédiaires. Lorsqu’en-
suite l’immatérialité de l’ame fut reconnue, toutes recherches sur sa
nature durent cesser.
Mais les phénomènes étoient trop multipliés et trop opposés entre
eux, pour qu’un principe unique satisfit long-temps à leur explication.
11 fallut bientôt recourir à diverses causes agissantes. S i , à la substance
qui produisoit l’activité, on laissoit une essence uniforme, on expli-
quoit la diversité des effets par son union avec différentes parties, ou
au moins par la différence des intermédiaires que l ’ame employoit pour
agir. Nous avons dit plus haut comment Anaxagore qui, le premier,
adopta l'immatérialité de l’ame, eut recours à la différence de l’organisation.
Les matérialistes, tels que l’école d’Hippocrate et les Stoïciens,
trouvèrent un moyen d’explication dans la combinaison variée des
élémens. Pythagore divisoit l’ame humaine en deux parties ; l’unè raisonnable,
l’autre irraisonnable. Platon ne se contente pas de diviser
l’ame de l’homme en deux parties, l’une raisonnable et divine, l’autre
irraisonnable et corporelle; il donne aussi le nom d’ame à toute cause
première. Erasistrate reconnoît un pneuma animal dans le cerveau, et
un pneuma vital dans le coeur. Galien adopta une ame raisonnable et
une ame irraisonnable, et différens esprits ou causes pour expliquer
les différentes fonctions de la vie. Gilbert, dans le treizième siècle, parle
décidément d’une ame raisonnable et immortelle, et d’une ame végétale
et sensitive ; celle-ci étoit mortelle , et l’on ne pouvoit, selon lui, la considérer
que comme une forme de la matière. Les Stahliens, eux-mêmes,
furent obligés de diviser l’ame suivant ses différentes opérations ; d’admettre
en elle une partie raisonnable, douée de conscience et de spontanéité,
et pour les fonctions vitales une autre pallie purement végétale,
sensitive et dépourvue de conscience *.
Ainsi dans tous les temps on a cherché à approfondir l’essence du
principe général ou celle des diverses causes agissantes. Fait-on aujourd’hui
autre chose, lorsque l’on représente tantôt le phlogistique , tantôt
l ’oxigène, ici l’électricité, là le fluide magnétique ou le fluide galvanique,
comme la cause première de tous les phénomènes ? quand, faisant
tous ses efforts pour expliquer la vie elle-même, on la nomme,
avec Ranta, un principe intérieur d’action, de mouvement, de changement;
avec Schmidt3 , l’activité de la matière dirigée d’après les
lois de l’organisation ; avec Erhard 4, la faculté du mouvement destiné
au service de ce qui est mu ? quand on place, avec Treviranus 5, le
caractère essentiel de la vie, dans la constante uniformité des phénomènes
, quoique les influences du monde extérieur soient différentes ;
avec Bichat6, dans l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort, etc. ?
Toutes ces définitions ont-elles fait trouvër ce que l’on ose chercher;
c’est-à-dire, le principe qui donne et entretient la vie ? On ne nous
présentera jamais que des conditions isolées de la vie , ou quelques-uns
1 Voyez Kurt Sprengel Versuch einer practisehen Geschichte der Arznei-
kunde. Halle 5 vol. in-8°. — G. V. Tennemann Geschiclite der Philosophie.
Leipz. 2 vol. in-8°. — J. Clir. Meiners Geschichte der YV issenschaften in Grie-
chenland und Rom. Lemgo, 1781. 2vol. i n - S ”. — Tiedemann Griechenlands
erste Philosophen. Leipz. 1781.01-8°.
* Metaphysische Anfangsgriinde der Naturwissenchaft. S. 110.
3 Phys. B. 2, S. 824.
4 Rôschlaub Magazin der Heilkunde. B. 1, St. 1, S. 69.
5 Biologie der lehenden Natur. B. 1, S. .|.j.
* Sur la vie et la mort, p. 1.