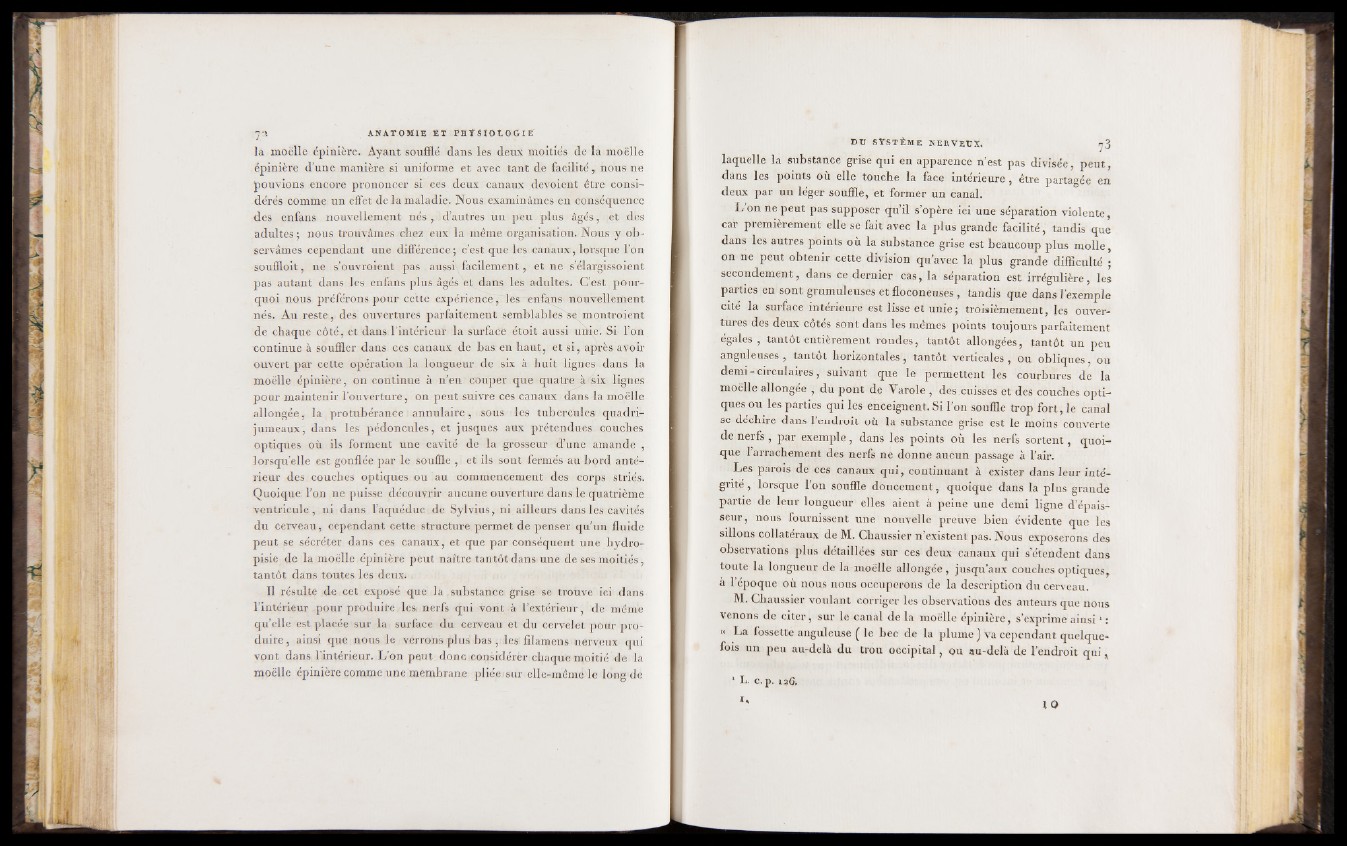
la moelle épinière. Ayant soufflé dans les deux moitiés de la moëlle
épinière d’une manière si uniforme et avec tant de facilité, nous ne
pouvions encore prononcer si ces deux canaux dévoient être considérés
comme un effet de la maladie. Nous examinâmes en conséquence
des enfans nouvellement nés, d’autres un peu plus âgés, et des
adultes; nous trouvâmes chez eux la même organisation. Nous y observâmes
cependant une différence; c’est que les canaux, lorsque l’on
souffloit, ne s’ouvroient pas . aussi1 facilement, et ne s’élargissoient
pas autant dans les enfans plus âgés et dans les adultes. C’est pourquoi
nous préférons pour cette expérience, les enfans nouvellement
nés. Au reste, des ouvertures parfaitement semblables se montroient
de chaque côté, et dans l'intérieur la surface étoit aussi unie. Si l’on
continue à souffler dans ces canaux de bas en haut, et si, après avoir
ouvert par celte opération la longueur de six à huit lignes dans la
moëlle épinière, on continue à n’en couper que quatre à/six lignes
pour maintenir l’ouverture, on peut suivre ces canaux dans la moëlle
allongée, la protubérance annulaire, sous les tubercules quadrijumeaux,
dans les pédoncules, et jusques aux prétendues couches
optiques où ils forment une cavité de la grosseur d’une amande ,
lorsqu’elle est gonflée par le souffle , et ils sont fermés au bord antérieur
des couches optiques ou au commencement des corps striés.
Quoique l’on ne puisse découvrir aucune ouverture dans le quatrième
ventricule, ni dans l’aquéduc de Sylvius, ni ailleurs dans les cavités
du cerveau, cependant cette structure permet de penser qu’un fluide
peut se sécréter dans ces canaux, et que par conséquent une hydro-
pisie de la moëlle épinière peut naître tantôt dans une de ses moitiés,
tantôt dans toutes les deux.
Il résulte de cet exposé que la substance grise se trouve ici dans
l’intérieur pour produite les, nerfs qui voiit à l’extérieur, de même
quelle est placée sur la surface du cerveau et du cervelet pour produire
, ainsi que nous le verrons plus bas , les: filamens nerveux qui
vont dans l'intérieur. L ’on peut donc considérer chaque moitié de la
moëlle épinière comme une membrane pliée i sur elle-même le long de
laquelle la substance grise qui en apparence n’est pas divisée, peut,
dans les points où elle touche la face intérieure, être partagée en
deux par un léger souffle, et former un canal.
L on ne peut pas supposer qu’il s’opère ici une séparation violente,
car premièrement elle se fait avec la plus grande facilité, tandis que
dans les autres points où la substance grise est beaucoup plus molle,
on ne peut obtenir cette division qu’avec la plus grande difficulté ;
secondement, dans ce dernier cas, la séparation est irrégulière, les
parties en sont grumuleuses et floconeuses, tandis que dans l ’exemple
cite la surface intérieure est lisse et unie; troisièmement, les ouvertures
des deux côtes sont dans les mêmes points toujours parfaitement
égales, tantôt entièrement rondes, tantôt allongées, tantôt un peu
anguleuses, tantôt horizontales, tantôt verticales, ou obliques, ou
demi-circulaires, suivant que le permettent les courbures de la
moëlle allongée , du pont de Varole , des cuisses et des couches optiques
ou les parties qui les enceignent. Si l ’on souffle trop fort, le canal
se déchiré dans l’endroit où la substance grise est le moins couverte
de nerfs , par exemple, dans les points où les nerfs sortent, quoique
1 arrachement des nerfs ne donne aucun passage à l’air.
Les parois de ces canaux qui, continuant à exister dans leur intégrité
, lorsque l’on souffle doucement, quoique dans la plus grande
partie de leur longueur elles aient à peine une demi ligne d’épaisseur
, nous fournissent une nouvelle preuve bien évidente que les
sillons collatéraux de M. Chaussier n’existent pas. Nous exposerons des
observations plus détaillées sur ces deux canaux qui s’étendent dans
toute la longueur de la moëlle allongée, jusqu’aux couches optiques,
à l’époque où nous nous occuperons de la description du cerveau.
M. Chaussier voulant corriger les observations des auteurs que nous
venons de citer, sur le canal de la moëlle épinière, s’exprime ainsi1 :
« La fossette anguleuse ( le bec de la plume ) va cependant quelquefois
un peu au-delà du trou occipital, ou au-delà dp l ’endroit qui,
1 L. c. p. ia6,
*' 10