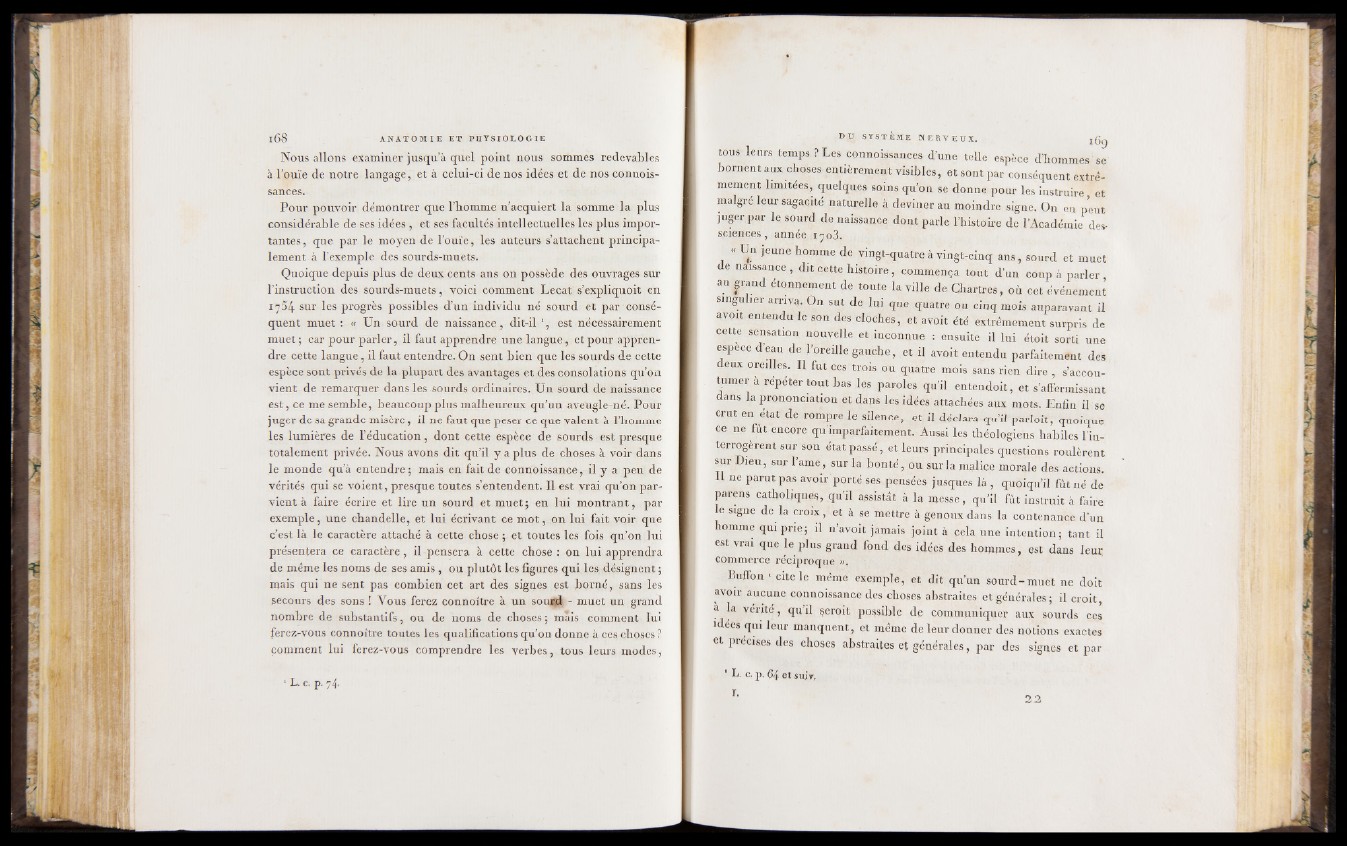
Nous allons examiner jusqu’à quel point nous sommes redevables
à l’ouïe de notre langage, et à celui-ci de nos idées et de nos connois-
sances.
Pour pouvoir démontrer que l’homme n’acquiert la somme la plus
considérable de ses idées , et ses facultés intellectuelles les plus importantes,
que par le moyen de l ’ouïe, les auteurs s’attachent principalement
à l ’exemple des sourds-muets.
Quoique depuis plus de deux cents ans on possède des ouvrages sur
l ’instruction des sourds-muets, voici comment Lecat s’expliquoit en
1754 sur les progrès possibles d’un individu né sourd et par conséquent
muet : « Un sourd de naissance, dit-il 1, est nécessairement
muet; car pour parler, il faut apprendre une langue, et pour apprendre
cette langue, il faut entendre. On sent bien que les sourds de cette
espèce sont privés de la plupart des avantages et des consolations qu’on
vient de remarquer dans les sourds ordinaires. Un sourd de naissance
est, ce me semble, beaucoup plus malheureux qu’un aveugle-né. Pour
juger de sa grande misère, il ne faut que peser ce que valent à l’homme
les lumièfes de l’éducation, dont cette espèce de sourds est presque
totalement privée. Nous avons dit qu’il y a plus de choses à voir dans
le monde qu’à entendre ; mais en fait de connoissance-, il y a peu de
vérités qui se voient, presque toutes s’entendent. Il est vrai qu’on parvient
à faire écrire et lire un sourd et muet; en lui montrant, par
exemple, une chandelle, et lui écrivant ce mot, on lui fait voir que
c’est là le caractère attaché à cette chose ; et toutes les fois qu’on lui
présentera ce caractère, il pensera à cette chose : on lui apprendra
de même les noms de ses amis , ou plutôt les figures qui les désignent ;
mais qui ne sent pas combien cet art des signes est borné, sans les
secours des sons ! Vous ferez connoître à un sourd - muet un grand
nombre de substantifs, ou de noms de choses ; mais comment lui
ferez-vous connoître toutes les qualifications qu’on donne à ces choses ?
comment lui ferez-vous comprendre les verbes, tous leurs modes,
' L. e, p. 74.
tous leurs temps ?Les Connoissances d’une telle espèce d’hommes se
bornent aux choses entièrement visibles, et sont par conséquent extrêmement
limitées, quelques soins qu’on se donne pour les instruire et
malgré leur sagacité naturelle à deviner au moindre signe. On en peut
juger par le sourd de naissance dont parle l’histoire de l ’Académie dessciences
, année 1708,
« Un jeune homme de vingt-quatre à vingt-cinq ans, sourd et muet
de naissance, dit cette histoire, commença tout d’un coup à parler,
au grand étonnement de toute la ville de Chartres, où cet événement
singulier arriva. On sut de lui que quatre ou cinq mois auparavant il
avoit entendu le son des cloches, et avoit été extrêmement surpris de
cette sensation nouvelle et inconnue : ensuite il lui étoit sorti une
espèce d’eau de l’oreille gauche, et il avoit entendu parfaitement des
deux oreilles. Il fut ces trois ou quatre mois sans rien dire , s’accoutumer
à répéter tout bas les paroles qu’il entendoit, et s’affermissant
dans la prononciation et dans les idées attachées aux mots. Enfin il se
crut en état de rompre le silence, et il déclara qu’il parloit, quoique
ce ne fût encore qu imparfaitement. Aussi les théologiens habiles l’in-
terrogerent sur son état passé, et leurs principales questions roulèrent
sur Dieu, sur l’ame, sur la bonté, ou sur la malice morale des actions.
Il ne parut pas avoir porté ses pensées jusques là , quoiqu’il fût né de
parens catholiques, qu’il assistât à la messe, qu’il fût instruit à faire
le signe de la croix, et à se mettre à genoux dans la contenance d’un
homme qui prie; il n’avoit jamais joint à cela une intention; tant il
est vrai que le plus grand fond des idées des hommes, est dans leur
commerce réciproque »,
Buffon 1 cite le même exemple, et dit qu’un sourd-muet ne doit
avoir aucune connoissance des choses abstraites et générales; il croit,
a la vérité, qu il seroit possible de communiquer aux sourds ces
idées qui leur manquent, et même de leur donner des notions exactes
et précises des choses abstraites et générales, par des signes et par
1 L. c, p. 04 et suiv.