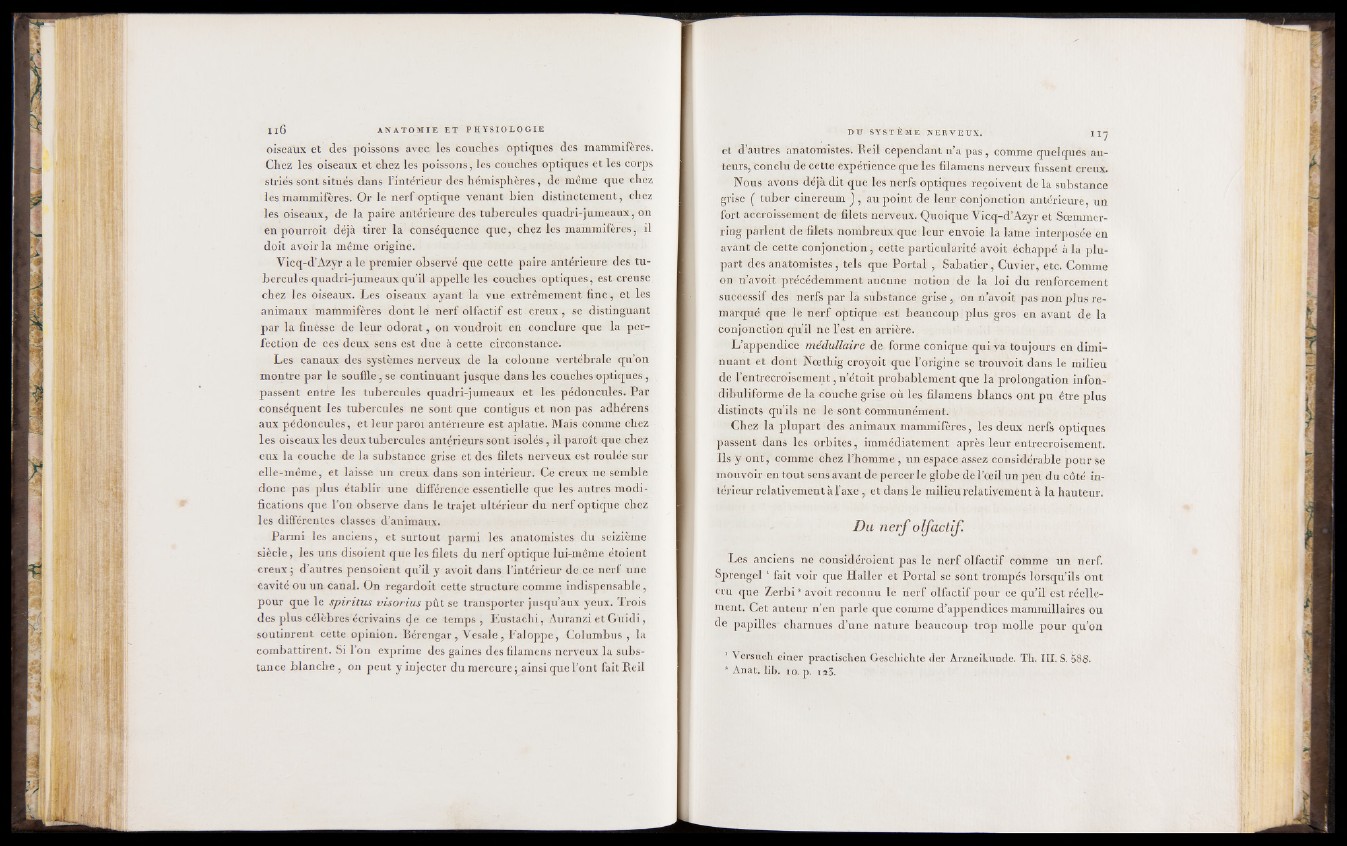
oiseaux et des poissons avec les couches optiques des mammifères.
Chez les oiseaux et chez les poissons, les couches optiques et les corps
striés sont situés dans l’intérieur des hémisphères, de même que chez
les mammifères. Or le nerf optique venant bien distinctement, chez
les oiseaux, de la paire antérieure des tubercules quadri-jumeaux, on
en pourroit déjà tirer la conséquence que, chez les mammifères, il
doit avoir la même origine.
Vicq-d’Azyr a le premier observé que cette paire antérieure des tubercules
quadri-jumeaux qu’il appelle les couches optiques, est creuse
chez les oiseaux. Les oiseaux ayant la vue extrêmement fine, et les
animaux mammifères dont le nerf olfactif est creux, se distinguant
par la finesse de leur odorat, on voudrait en conclure que la perfection
de ces deux sens est due à cette circonstance.
Les canaux des systèmes nerveux de la colonne vertébrale qu’on
montre par le souffle, se continuant jusque dans les couches optiques,
passent entre les tubercules quadri-jumeaux et les pédoncules. Par
conséquent les tubercules ne sont que contigus et non pas adhérens
aux pédoncules, et leur paroi antérieure est aplatie. Mais comme chez
les oiseaux les deux tubercules antérieurs sont isolés , il paraît que chez
eux la couche de la substance grise et des filets nerveux est roulée sur
elle-même, et laisse un creux dans son intérieur. Ce creux ne semble
donc pas plus établir une différence essentielle que les autres modifications
que l ’on observe dans le trajet ultérieur du nerf optique chez
les différentes classes d’animaux.
Parmi les anciens, et surtout parmi les anatomistes du seizième
siècle, les uns disoient que les filets du nerf optique lui-même étoient
creux; d’autres pensoient qu’il y avoit dans l’intérieur de ce nerf une
cavité ou un canal. On regardoit cette structure comme indispensable,
pour que le spiritus visorius pût se transporter jusqu’aux yeux. Trois
des plus célèbres écrivains de ce temps, Eustachi, Auranzi et Gûidi,
soutinrent cette opinion. Bérengar, Yesale, Faloppe, Columbus , la
combattirent. Si l’on exprime des gaines des filamens nerveux la substance
blanche , on peut y injecter du mercure ; ainsi que l’ont fait Reil
!
et d’autres anatomistes. Reil cependant n’a pas, comme quelques auteurs,
Conclu de cette expérience que les filamens nerveux fussent creux.
Nous avons déjà dit que les nerfs optiques reçoivent de la substance
grise ( tuber cinereum ) , au point de leur conjonction antérieure, un
fort accroissement de filets nerveux. Quoique Vicq-d’Azyr et Scemmer-
ring parlent de filets nombreux que leur envoie la lame interposée en
avant de cette conjonction, cette particularité avoit échappé à la plupart
des anatomistes, tels que Portai , Sabatier, Cuvier, etc. Comme
on n’avoit précédemment aucune notion de la loi du renforcement
successif des nerfs par la substance grise , on n’avoit pas non plus remarqué
que le nerf optique est beaucoup plus gros en avant de la
conjonction qu’il ne l’est en arrière.
L ’appendice médullaire de forme conique qui va toujours en diminuant
et dont Noethig croyoit que l’origine se trouvoit dans le milieu
de l’entrecroisement, n’étoit probablement que la prolongation infon-
dibuliforme de la couche grise où les filamens blancs ont pu être plus
distincts qu’ils ne le sont communément.
Chez la plupart des animaux mammifères, les deux nerfs optiques
passent dans les orbites, immédiatement après leur entrecroisement.
Ils y ont, comme chez l’homme , un espace assez considérable pour se
mouvoir en tout sens avant de percer le globe de l ’oeil un peu du côté intérieur
relativement à l’axe, et dans le milieu relativement à la hauteur.
Du nerf olfactif.
Les anciens ne considéroient pas le nerf olfactif comme un nerf.
Sprengel 1 fait voir que Haller et Portai se sont trompés lorsqu’ils ont
cru que Zerbia avoit reconnu le nerf olfactif pour ce qu’il est réellement.
Cet auteur n’en parle que comme d’appendices mammillaires ou
de papilles- charnues d’une nature beaucoup trop molle pour qu’on
1 Versuch einer practischen Gescliichte der Arzneikunde. Th. III. S. 588.
* Ànat. lib. 10. p. ia5.